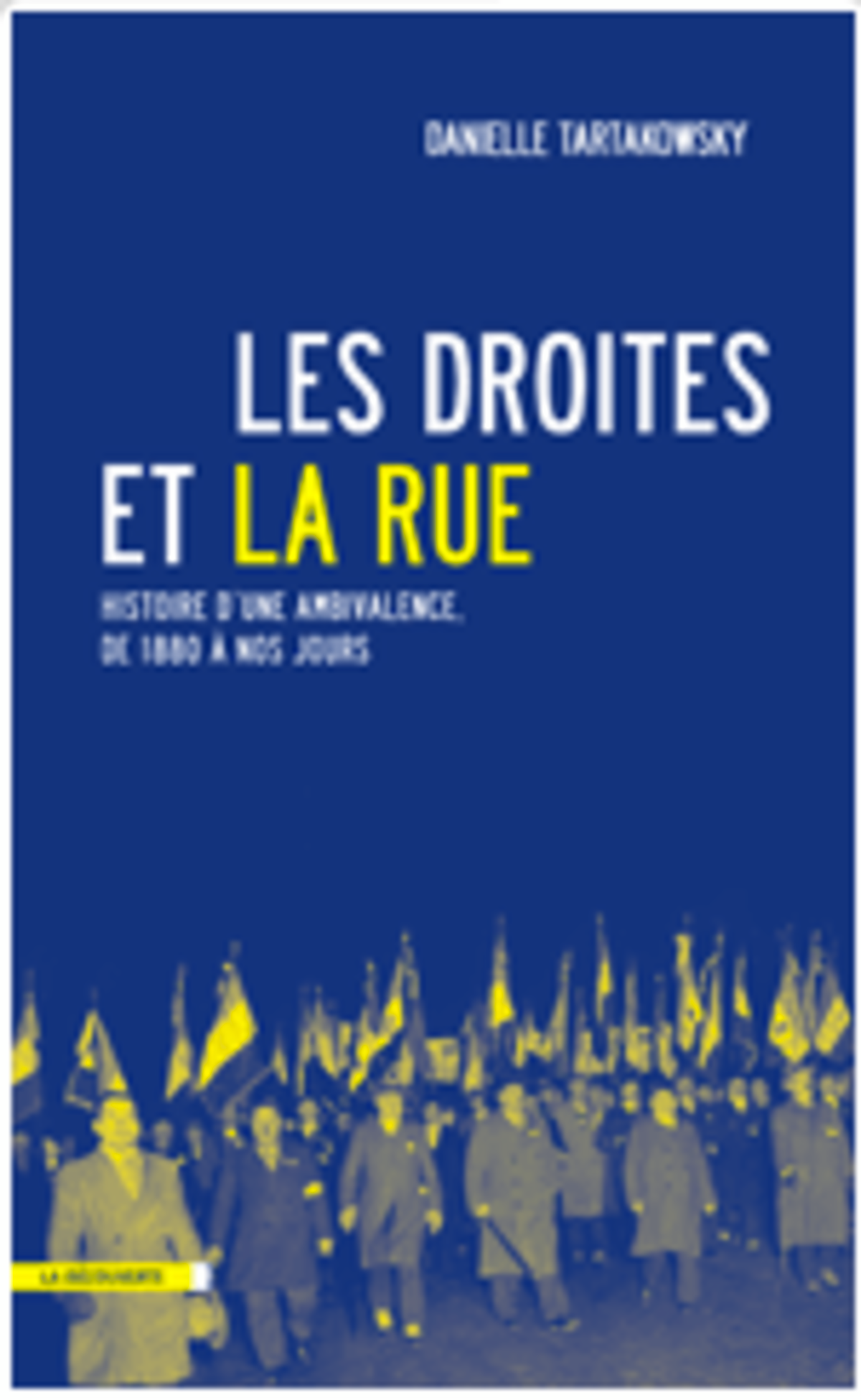
Le 30 mai 1968, un énorme cortège remontant les Champs-Élysées prétendit mettre fin à la « chienlit » des semaines précédentes. Il était surtout gaulliste mais toutes les droites s’y retrouvaient. À cette occasion, Paris Match publia deux photos en contraste. Sur l’une, on voyait une belle fille défilant dans une manif étudiante et arborant un drapeau rouge, sur l’autre, une belle fille défilant sur les Champs et brandissant le drapeau français. Si les photos eussent été parlantes, on eût entendu la première demoiselle chanter l’Internationale et la seconde entonner la Marseillaise. Toute une symbolique se résumait ainsi en deux clichés et toute une histoire. C’est l’histoire que raconte pour partie au moins Danielle Tartakowsky dans son récent Les Droites et la Rue qui narre un siècle et demi de manifs.
Mais pourquoi les droites seulement dès le titre ? C’est que l’auteure, vigilante historienne des défilés populaires, veut rompre avec l’idée que la « manif » est de gauche comme par nature, ce que démentent les faits. Occasion également pour elle de voir ce qui, de période en période, a pu définir la manifestation de droite, qu’elle soit processionnelle ou insurrectionnelle. En réalité, le mythe bourgeois selon lequel le peuple a depuis longtemps fait de la rue son domaine réservé pour y semer le désordre est fortement démenti par la constance avec laquelle des groupes ou des foules appartenant à l’autre camp ont mené des actions — et parfois violentes — dans les rues des villes. La grande différence vient de ce que les manifs de gauche accompagnent le plus souvent des actions de grève et de revendication là où celles d’en face prétendent rétablir l’ordre et une souveraineté de classe.
Toujours est-il que, de 1880 à aujourd’hui en France, une série de temps forts vont scander l’appropriation de la rue par les forces réactionnaires et donner différents sens à cette captation. Dans l’après-guerre 14-18 et pour vingt ans, des mouvements d’anciens combattants majoritairement conservateurs font du défilé de rue tout à la fois des formes de commémoration et des actes de défense de la patrie (en opposition au parti communiste par exemple). Parallèlement, Action française et ligues (les Croix-de-feu du colonel de la Rocque !) conduisent le pays au bord de l’insurrection avec notamment ce sommet que fut le 6 février 1934 qui fit plusieurs morts. Après quoi, avec le Front populaire comme avec la Résistance, les manifs de droite se mettent en veilleuse. Mais, au lendemain de la seconde guerre, le gaullisme va s’emparer de l’espace public sur un mode inédit. C’est que le Général se fait plébisciter par de grands rassemblements que perturbent malaisément PCF et CGT. Vient ensuite ce temps où la scène de l’Histoire se déplace de Paris à Alger : là-bas le coup d’État menace mais à Paris il n’atteint qu’en partie son but. Viennent ensuite les années 1980 qui voient les catholiques de retour et se mobilisant contre la loi Savary et pour la défense de l’école libre. Ce qui nous conduit tout droit à la récente « Manif pour tous » qui défend les « valeurs chrétiennes » (école privée, famille) mais dans un style qui se veut étrangement « postmoderne ».
Tout au long de la trajectoire que l’on vient de rappeler, le rôle des droites n’est pas mince dans la reconnaissance de l’espace public comme lieu d’expression des opinions. C’est après février 34 que les défilés obtiennent un statut, les limitant pour les autoriser. Et c’est en interprétant la Constitution de la Cinquième que de grandes manifestations collectives tendent à se faire passer pour des référendums d’initiative populaire. « C’est paradoxalement, écrit Danielle Tartakowsky, le nouveau cadre constitutionnel défini par le général de Gaulle qui permet à la droite de penser la manifestation en des termes redéfinis et d’en légitimer implicitement l’usage , à partir des années 1980. » (p. 167)

D’un bout à l’autre, l’étonnant est que le traditionalisme de droite ne trouve guère, en dehors d’un 11 novembre qui appartient à tous, à se réclamer de grands moments d’histoire et de leurs hauts symboles là où les gauches se réfèrent à 89, à la Commune ou au Front Populaire et font du Premier Mai un grand moment universel. Avec Le Pen fêtant Jeanne d’Arc le 1er mai, on a clairement à faire à un détournement symbolique abusif.
À de tels symboles justement, l’ouvrage de Tartakowsky y est attentif et par exemple à la question des lieux manifestaires préférés par les deux camps. Défilant de l’Étoile à la Concorde, les partis ou groupes de droite se savent proches des beaux quartiers et des lieux de pouvoir. Plus spécifiquement, les catholiques aiment à se retrouver au Champ-de-Mars. Pendant ce temps, les manifs de souveraineté populaire menées par la gauche se retrouvent fidèlement d’époque en époque dans le triangle République-Bastille-Nation dont la signification n’est plus à dire.
Au total, l’ouvrage de Danielle Tartakowsky est remarquable de rigueur alors qu’il ne cache pas ses sympathies de gauche. Aimant à évaluer succès et échecs des mouvements collectifs, il le fait avec une tranquille objectivité. Il donne à lire par ailleurs une extrême richesse de faits et de dates voulant que l’on se perde dans ses lacis à de certains moments et qu’une chronologie en fin de volume n’eût pas été un luxe.
- Danielle Tartakowsky, Les Droites et la Rue. Histoire d’une ambivalence, de 1880 à nos jours, La Découverte, "Cahiers libres", 208 p., 18 € (disponible en version numérique)



