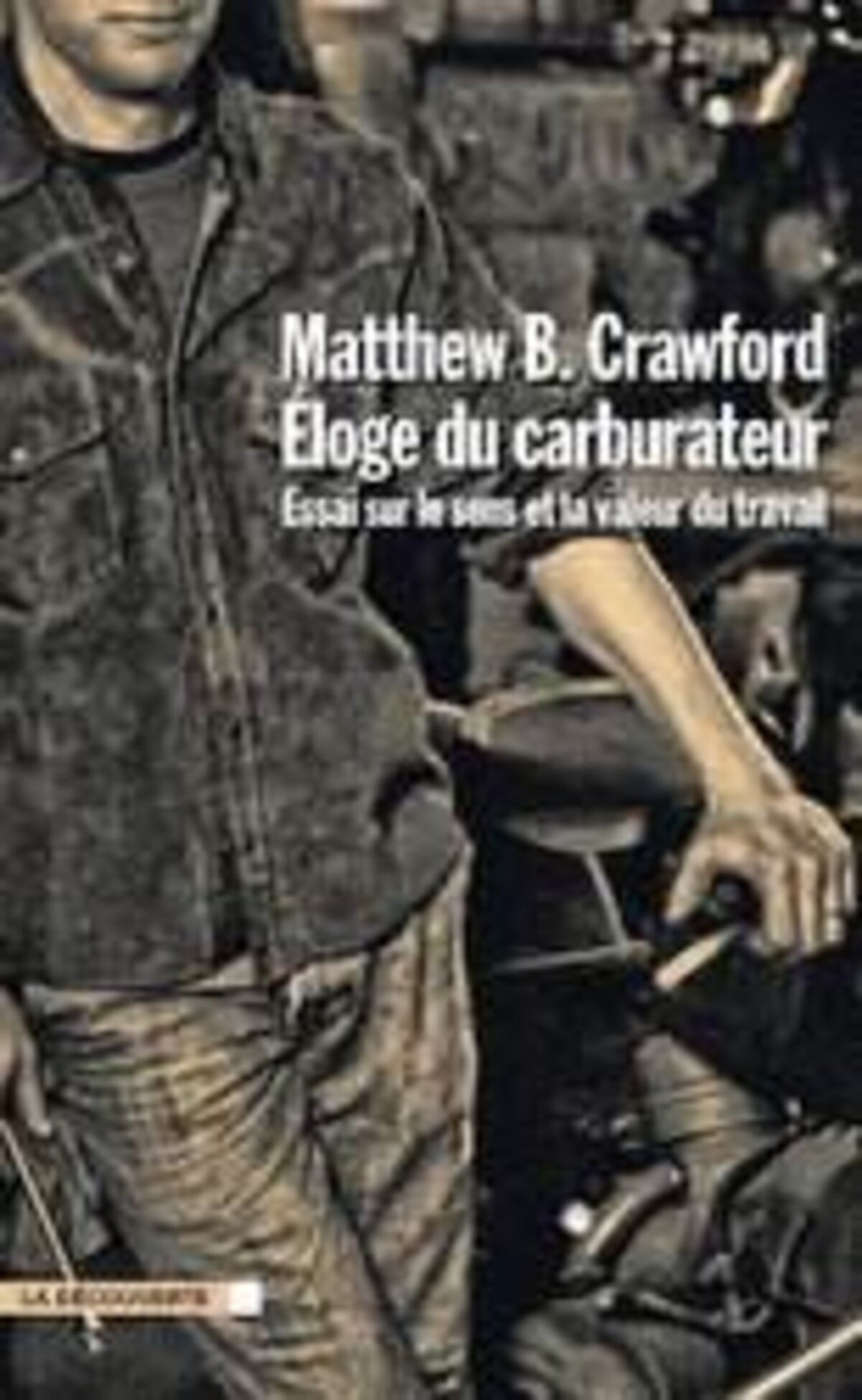
Philosophe de formation, Matthew G. Crawford a d'abord travaillé dans un think tank californien puis, passionné de motos, a été attiré par ces petits garages qui, aux Etats-Unis, se vouent à la réparation de vieux deux roues que les amateurs aiment à bricoler. Dans ces lieux de la elles rétablissent le lien avec le monde des choses, qui est en même temps rapport direct avec le monde des usagers ; elles sortent même l'individu de son narcissisme pour la raison qu'il s'implique totalement dans ce qu'il fait. Voici notre philosophe au travail - de la tête et des mains : « Une petite tige tordue bloque la circulation de l'huile, entraînant une surchauffe excessive et le calage du moteur. Telle est la Vérité, et elle est la même pour out le monde. Mais l'identification de cette vérité requiert une certaine disposition de l'individu, une certaine capacité d'attention accompagnée d'un sentiment de responsabilité envers la moto. Le réparateur doit intégrer le bon fonctionnement du véhicule, en faire un objet de préoccupation intense. » (p.115)
Est-ce à dire pour autant que Matthew Crawford prône un retour illusoire à quelque artisanat ? Pas le moins du monde. Mais il met en cause une évolution qui, partant d'un taylorisme capitaliste mais aussi soviétique (Staline était un fan de Taylor), nous conduit jusqu'à notre société du virtuel. En celle-ci, il n'est place que pour un travail abstrait et dépersonnalisé. En même temps y est prônée par le management d'aujourd'hui une stimulation de la créativité des agents qui s'avère être un parfait bluff. On ne devient pas créatif sur commande et dans n'importe quelle conditions, estime l'auteur, mais seulement au terme d'un patient apprentissage et d'accumulation des connaissances. « L'identification entre créativité et liberté, écrit encore Crawford, est typique du nouveau capitalisme ; dans cette culture, l'impératif de flexibilité exclut qu'on s'attarde sur une tâche spécifique suffisamment longtemps pour y acquérir une réelle compétence. Or, ce type de compétence est la condition non seulement de la créativité authentique, mais de l'indépendance dont jouit l'homme de métier. » (p. 63) Dans le monde du virtuel, tout est en fait simulation. Cela commence avec des enseignements universitaires qui font passer les signes du classement et de la réussite bien avant les vraies connaissances et cela conduit à tous ces appareils surchargés de gadgets dont ne savent que faire les hommes de l'art.
Bref, de page en page, le philosophe défend des attitudes de vie et des pratiques de travail qui ont gardé leurs liens avec le réel et demeurent attachées aux valeurs d'usage. Ajoutons qu'il le fait en assaisonnant sa démonstration de pas mal de traits d'humour et d'une part non négligeable de concret repris de ses aventures en différents lieux. On se dit le lisant que des cours techniques seraient les bienvenus dans les universités et tout spécialement dans ces départements de communication qui fabriquent des « consultants en gestion ». Dépourvus de toute expertise spécifique, ces derniers, comme on sait, ont vocation d'apprendre aux autres de purs simulacres d'action sortis d'on ne sait où.
Mathew B. Crawford, Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail. Traduit de l'anglais par M. Saint-Upéry. Paris, La Découverte, « Cahiers libres », 2010. 19 €.



