Dans La dernière leçon de Michel Foucault, Geoffroy de Lagasnerie analyse les rapports de Foucault à la pensée néolibérale. Le cours donné en 1979 par celui-ci au Collège de France, publié en 2004 sous le titre Naissance de la biopolitique, fut en grande partie consacré au néolibéralisme, ce qui a pu produire certains contresens : Foucault est-il devenu néolibéral ?

Agrandissement : Illustration 1
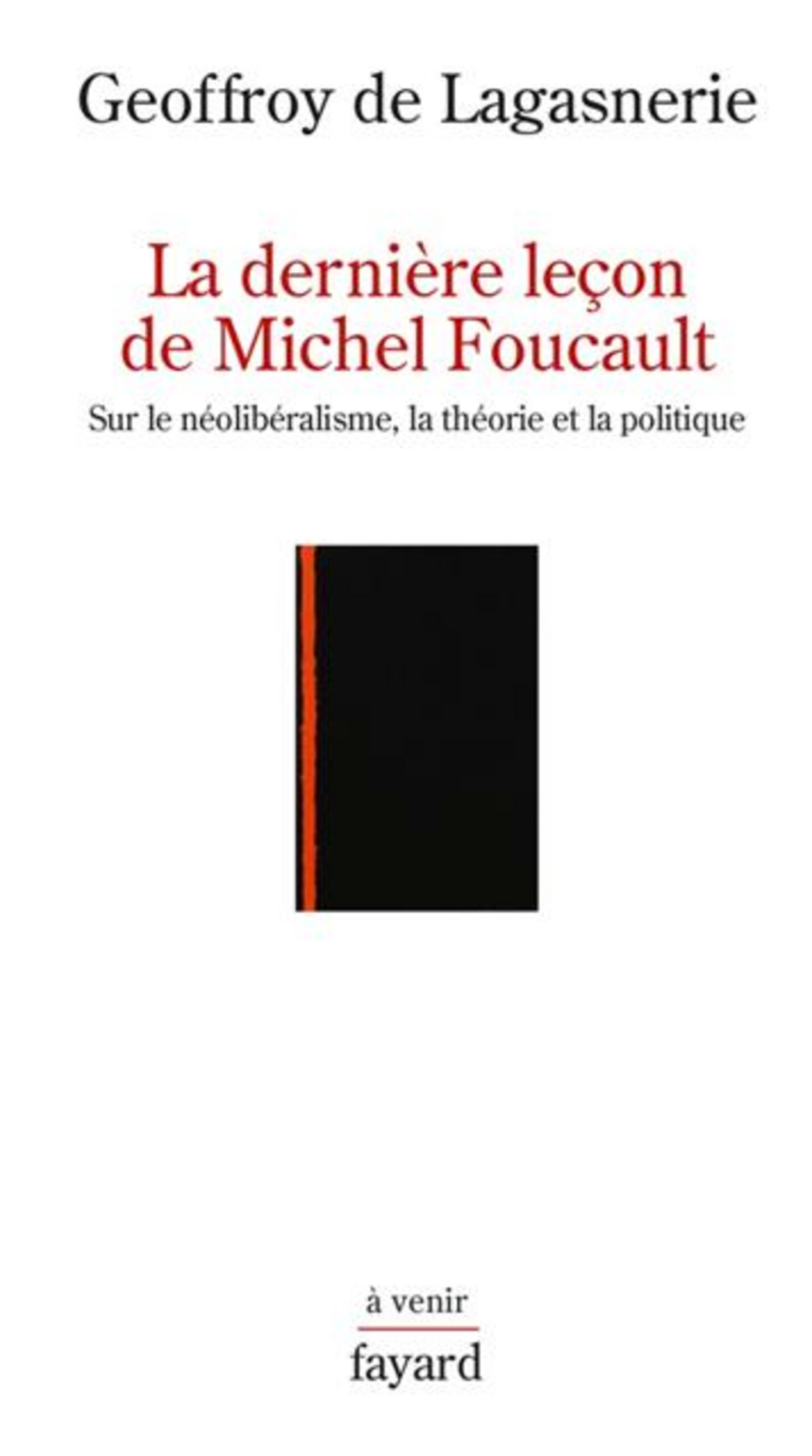
Cet intérêt paraitrait d’autant plus ambigu que les analyses qu’il y développe sortent des points de vue à partir desquels la pensée néolibérale est habituellement abordée à gauche (ce qui ne devrait pas étonner puisque le travail de Foucault se définit comme un effort pour s’extraire des discours dominants, qui sont aussi des discours de la domination).
« Au cours des soixante dernières années s’est […] construit une sorte de mur entre l’espace théorique légitime ou dominant, d’un côté, et, de l’autre, le néolibéralisme. Les auteurs néolibéraux ont été constitués comme des auteurs infréquentables, que l’on n’aurait l’idée ni de citer ni même de lire en philosophie politique […] – à moins que ce ne soit en tant que repoussoir ». Or, Foucault s’intéresse à la pensée néolibérale pour en faire un usage critique et produire à partir d’elle une mise en question de la philosophie politique. Il utilise les penseurs néolibéraux pour réinterpréter et réévaluer une tradition philosophique et politique prégnante, ainsi que les notions qui semblent impliquées par le discours émancipateur de gauche, mais dont il montre qu’elles structurent un type de gouvernement basé sur l’assujettissement.
L’idée de Foucault consiste « […] à se servir du néolibéralisme comme d’un test, à l’utiliser comme un instrument de critique de la réalité et de la pensée […] afin d’entreprendre une analyse de nous-mêmes. Car se confronter à cette doctrine qui a été constituée comme le ‘négatif’ de notre espace habituel de réflexion revient, d’une certaine manière, à se confronter à notre inconscient, aux limites de notre propre réflexion ». Cette utilisation des néolibéraux n’est évidemment pas synonyme d’adhésion naïve à leurs thèses, qui font l’objet d’un regard critique, ni à la réalité du néolibéralisme. De plus, l’intérêt pour ces théories apparaît comme le moyen d’un dépassement des clichés avec lesquels elles sont appréhendées, donc comme la condition de leur critique véritable. Foucault insiste sur la singularité du néolibéralisme, sa différence avec le libéralisme classique et les formes connues du capitalisme : le discours passéiste de la gauche politique et intellectuelle ayant tendance à confondre ces pensées rate sa cible lorsqu’il croit critiquer les politiques néolibérales.
Le cours de 1979 correspondrait à un questionnement politique précis : dans quelle mesure la gauche met-elle en place des processus d’assujettissement ? Une question proche organisait La Volonté de savoir, publié en 1976 : ce qui se présente comme libérateur n’est-il pas aussi porteur d’une stratégie de domination ? Et déjà, l’Histoire de la folie montrait que l’émergence de l’asile psychiatrique ne « libère » les aliénés des prisons que pour mieux les enfermer dans une autre forme de prison. Spinoza demandait : pourquoi les humains combattent-ils pour leur servitude comme s’il s’agissait de leur salut ? Foucault traite cette question en montrant que la domination doit être repensée selon diverses stratégies historiques : irréductible à l’idée de violence ou de contrainte manifestes, elle implique aussi une forme de gouvernement des hommes s’appuyant sur des schémas et discours émancipateurs.
La philosophie politique moderne développe des catégories (Etat, citoyen, intérêt général, etc.) supposées réunir les conditions d’une véritable liberté politique, alors qu’elles impliquent en elles-mêmes une forme d’assujettissement. La gauche postmarxiste reproduit ces catégories sans les soumettre à un examen critique. C’est cet examen que pratique Foucault en s’appuyant sur les penseurs néolibéraux, dans un geste provocateur et non dénué d’humour : il n’est pas question de basculer dans le camp néolibéral, mais de se servir de ce qui est rejeté à gauche pour forcer à sortir de la bonne conscience et lutter contre ce qui, dans le camp autoproclamé de l’émancipation, pourtant asservit (on retrouve ici un mouvement qui traverse l’œuvre de Foucault : s’appuyer sur ce qui est exclu pour penser ce qui exclut et le type d’exclusion qui est en jeu).
La notion la plus couramment liée au courant néolibéral est celle de marché. Foucault insiste sur l’orientation particulière de cette notion développée par les néolibéraux : là où le libéralisme hérité d’Adam Smith affirmait la nécessité d’une frontière entre l’Etat et la rationalité économique, le néolibéralisme pose celle d’une marchandisation totale garantie par l’Etat : l’Etat et le marché ne sont plus séparés mais le premier est au service du second. Les Etats deviennent les points d’appui d’une dérégulation généralisée utilisant les moyens de l’Etat – c’est-à-dire paradoxalement la régulation – pour développer sa logique propre : « pour se réaliser, l’utopie néolibérale suppose la mise en place d’un véritable interventionnisme politique et juridique ». N’a-t-on pas dans Naissance de la biopolitique une formulation claire de ce qui, sous couvert de crise économique, se déroule sous nos yeux actuellement, plus de trente ans après les cours de Foucault ?
Si les théoriciens néolibéraux affirment la nécessité d’une extension illimitée de la logique du marché, ce n’est pas uniquement pour des raisons économiques ni pour défendre la liberté absolue de l’individu. Cette nécessité se rattache d’abord à une façon singulière de concevoir la société centrée sur la notion de pluralité. Conformément à l’idée d’Adam Smith, les échanges sont compris par les néolibéraux comme un ensemble de rapports entre intérêts particuliers, sans intérêt général et supérieur, ces rapports s’appuyant sur des contrats locaux, relatifs. L’ensemble de ces rapports produit le tissu social formé de différences qui coexistent, entrent en rapport sans que cette coexistence découle d’une unité des intérêts, sans que les contrats s’appuient sur une instance transcendante. C’est à partir de la généralisation de cette logique que les néolibéraux conçoivent l’idée de marchandisation totale et le nouveau rôle qu’ils attribuent à l’Etat.
Foucault s’intéresse donc surtout à la conception sociale et politique qui sous-tend ce qui est couramment retenu pour définir le néolibéralisme (logique marchande généralisée). Il en retient l’idée que la société n’est pas une mais plurielle, coexistence de différences non réductibles à une unité ou identité : « La spécificité de ce paradigme, c’est de nous forcer à nous demander ce qu’implique et veut dire de vivre dans une société composée d’individus ou de groupes qui expérimentent des modes d’existence divers ». La pluralité dont il est question est claire : pluralité des modes d’existence, des représentations, des aspirations, des intérêts, des valeurs, des récits, etc. — la pluralité ici désignant l’existence simultanée de différences autonomes, hétérogènes, ce que signale mieux la notion de multiplicité. Ce que Foucault retrouve chez les néolibéraux et leurs prédécesseurs philosophes est l’idée que « la pluralité du monde social et culturel est irréductible ; elle doit constituer un point d’arrivée, et non le point de départ contre lequel devrait nécessairement se définir une théorie politique ». La conception politique qui découle de ceci se définit par le fait « d’inventer des dispositifs permettant de protéger et de faire proliférer les différences », non par l’homogénéisation de ces différences ni leur soumission à un type de mode de vie unique et unifiant.
Même si Geoffroy de Lagasnerie n’en parle pas, on peut penser que l’affirmation de la société comme multiplicité de modes de vie et le refus qui l’accompagne d’une réduction de cette multiplicité — réduction qui est l’effet d’un pouvoir à interroger — trouvent également leur occasion dans la fréquentation par Foucault des milieux et mouvements gays américains des années 70, dans les discours et pratiques politiques et éthiques qui y étaient développés, ce que montrent d’ailleurs certains des textes ou interviews que l’on retrouve dans les Dits et Ecrits. Ces développements de la pensée de Foucault, loin de traduire une conversion au diable néolibéral, s’articulent parfaitement à l’expérience des minorités et sembleraient clairs à ceux qui en font partie tout en subissant un modèle général qui ne leur correspond pas, une forme de pouvoir dont les schémas de la philosophie politique moderne, de la gauche républicaine ou du marxisme orthodoxe non seulement ne peuvent rendre compte mais contribuent à exercer. L’homogénéité de la société n’a de sens que pour le point de vue qui, sous couvert de rationalité ou de républicanisme, veut cette homogénéité et veut l’imposer, cette volonté n’étant pas inhérente à l’exercice du gouvernement mais appartenant à une de ses représentations philosophiquement et historiquement circonscrite, à une pratique du pouvoir de l’Etat tributaire d’une « vision unificatrice » – idée et pratique qui en tant qu’objets d’une critique possible sont transformables.
Pourquoi valoriser l’hétérogénéité de la société, mettre en avant la primauté de la multiplicité ? C’est parce qu’il y a là le moyen d’une libération qui ne soit pas un instrument pour la domination et ses stratégies actuelles. Selon Foucault, les théories développées par la philosophie politique moderne reposent sur une logique qui soutient ces stratégies de manière paradoxale : elles apparaissent comme l’énoncé des conditions de la liberté politique alors qu’elles font reposer cette liberté sur des conditions qui assujettissent et d’individus assujettis. « Si la charge antiétatiste à l’œuvre dans le néolibéralisme intéresse Foucault, c’est parce qu’elle ouvre la voie à une déconstruction du paradigme qui […] fabrique de l’obéissance dans les sociétés contemporaines : la philosophie politique, la théorie du droit, la croyance dans l’Etat ».
Les philosophes des Lumières et les théoriciens du contrat veulent fonder rationnellement les principes du droit politique, les conditions de la légitimité politique. Mais ces principes sont développés « au détriment de ce qui relèverait de l’individuel, du particulier, du local », à partir « d’une hantise de la pluralité et de la diversité » (hantise que l’on retrouve aujourd’hui dans l’alibi du « communautarisme »). Pour les théoriciens du contrat la pluralité est présociale et la société, par définition, doit exclure cette pluralité – exclusion qui est posée comme une des conditions de la forme légitime du pouvoir politique et de la liberté commune : « Comme s’il fallait toujours […] inventer des dispositifs qui réguleraient et encadreraient la pluralité sociale, afin de limiter la multiplicité des modes d’existence pour produire de l’ordre, de l’unité et du collectif ». Autrement dit, dans le cadre de ces théories, le différent, le divergent est exclu ou, mais c’est la même chose, intégré dans la mesure où il se maintient dans les limites de ce qui est défini comme volonté générale et intérêt général – volonté et intérêt qui ne sont généraux que par l’exclusion des différences, des divergences, de la pluralité. Le général ne serait donc finalement qu’un autre nom pour le majoritaire, qu’un autre masque pour le plus fort.
Si la pluralité de la société est la tache aveugle de la philosophie politique moderne, si son refoulement est la condition de l’édification de cette philosophie, on comprend que l’insistance de cette pluralité soit perçue comme une menace. Mais cette menace ne concerne pas la société : elle menace un certain type de société, une certaine pratique politique, une forme de gouvernement dont Foucault montre qu’elle n’est qu’une forme possible et d’autant plus problématique qu’elle implique l’assujettissement des individus, la soumission à une unité qui ne tient que par la négation des modes d’existence divergents. Et Geoffroy de Lagasnerie souligne le fait que, selon Foucault, la pensée de Marx ne rompt pas avec cette ambition homogénéisante et totalisante : « le marxisme est une doctrine insuffisante car insuffisamment critique » ; « le problème essentiel du marxisme est de n’avoir pas interrogé la forme-totalisation : il a entièrement repris à son compte l’ambition de construire une vision unificatrice de la réalité – c’est-à-dire de ramener ce qui se passe dans la société à un certain nombre de principes élémentaires et prédéterminés. Ce faisant, au moment même où cette doctrine prétend fournir des armes contre la domination, elle exerce à son tour des effets de pouvoir, d’autorité, de censure ».
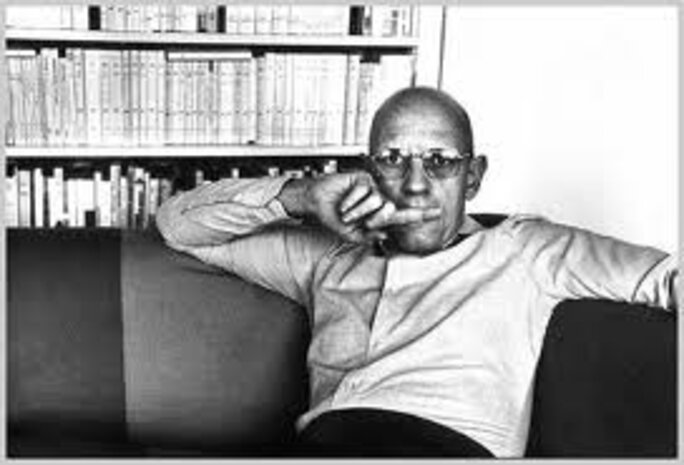
Geoffroy de Lagasnerie, à partir de là, suit de manière détaillée l’usage que fait Foucault des néolibéraux pour déconstruire de manière stimulante les présupposés et conséquences de cette volonté totalisante et le type d’aliénation qu’elle implique : critique de l’idée de citoyen, d’Etat, d’intérêt général, critique des prétentions illusoires de la raison, de l’idée de communauté, immanence des normes, développement de relations sociales transversales et non centralisées, etc. Il insiste surtout sur les conséquences pratiques de cette déconstruction. En effet, le travail historique et philosophique de Foucault montre comment « la pratique de l’histoire a pu (et peut donc encore) être utilisée stratégiquement comme une arme contre le souverain. La politique ne représente pas les citoyens au-delà de leurs intérêts particuliers. Elle n’est pas le domaine du commun, mais de la conquête […] : les lois, le droit, l’Etat s’inscrivent dans une bataille originelle qu’ils prolongent. Leur objectif est de maintenir le rapport de force initial en faveur des vainqueurs ». Comprendre ceci n’est pas du tout synonyme d’un rejet du politique ni n’entraîne un scepticisme stérile. Il s’agit plutôt d’un point de départ pour un nouveau type d’engagement et d’action politiques nettoyés des illusions émancipatrices habituelles, des notions empêchant un renouvellement de la pratique et de la pensée politiques. Ces analyses, d’ailleurs, contrairement à ce que l’on entend, n’entrainent pas un oubli de l’Etat mais plutôt, à la fois, comme Foucault le savait bien, l’idée d’un usage stratégique de l’Etat et du droit autant que celle d’une nécessaire affirmation persistante des modes d’existence pluriels.
Une autre conséquence concerne la compréhension de la désobéissance politique, le rapport aux « discours de résistance à la logique étatique ». Ceux-ci sont volontiers soutenus par un certain discours politique de gauche ou par une partie des intellectuels se réclamant de la gauche. Cependant, le plus souvent, s’ils sont soutenus c’est à condition de s’appuyer sur les schémas établis, d’user des notions reconnaissables, c’est-à-dire à condition de reprendre la logique de la souveraineté moderne en s’inscrivant dans l’horizon d’une totalisation, en s’intégrant à l’ordre d’une société – voire d’une humanité – homogène, identique à elle-même. Par là, « [on] se condamne à demeurer à l’intérieur du régime de la souveraineté : [on] s’oppose à un état donné des rapports de pouvoir, mais pas aux rapports de pouvoir en tant que tels. Bref, [on] s’adosse à un système assujettissant qu’[on] ne met pas en question ». Et l’on pense ici à Gilles Deleuze qui, de manière proche, invitait déjà à ne pas confondre la « révolution » et le « devenir-révolutionnaire ». Pour Foucault, de même, les contestations, résistances, et affirmations de modes de vie « alternatifs » ont leur sens en elles-mêmes, sans devoir être rapportées à des principes transcendants, totalisants, homogénéisants. Ce qui implique pour l’intellectuel un autre rapport et un autre intérêt pour ces mouvements, une position locale et non totalisante, au plus près de l’événement.
La troisième conséquence serait la plus simple et la plus évidente : comprendre que la réalité politique qui est la nôtre, que la philosophie politique moderne et les pratiques politiques qui lui sont liées, impliquent notre assujettissement ne doit-il pas conduire à l’idée d’une nécessaire contestation de cette réalité, à l’idée d’une nécessaire invention d’une autre réalité ?
Le livre de Geoffroy de Lagasnerie est ainsi important non seulement car il éclaire un des aspects mal compris de la pensée de Foucault qu’il expose de manière précise et détaillée, mais aussi parce qu’il met en évidence les implications pratiques de cette pensée qui sont ceux, sans doute, qui importaient le plus à Michel Foucault. Si Foucault pose des questions qui sont les nôtres, c’est parce qu’il a su faire apparaître avant nous des problèmes qui sont les nôtres. Pensée donc on ne peut plus actuelle, c’est-à-dire inactuelle tant elle préfigure encore les conditions d’une sortie de la pensée qui majoritairement, encore, domine. Le mérite de ce livre est de montrer qu’un des penseurs les plus importants pour nous maintenant n’est pas mort le 25 juin 1984.
Geoffroy de Lagasnerie, La Dernière Leçon de Michel Foucault, éditions Fayard, « à venir », octobre 2012, 17 € (11 € 99 en format numérique)
Le livre de Geoffroy de Lagasnerie a également été chroniqué par Jacques Dubois, le 30 novembre 2012, dans ce même Bookclub. Lire ici — Ces deux perspectives sur un même livre illustrent ce que nous souhaitons tous faire de cette édition : un espace de lectures croisées, via les textes publiés ou les commentaires (CM).



