
La Cité des oiseaux est le premier roman de l’écrivain américain Adam Novy. Le titre anglais, The Avian Gospels, serait traduisible par « Les Evangiles aviaires » ou les « Gospels aviaires », puisque dans le roman se trouvent des références aux Evangiles ainsi qu’au gospel et que les oiseaux y sont omniprésents. Un des personnages, Morgan, pourrait être un nouveau messie qui commande aux oiseaux, dénonce le monde tel qu’il existe, est vénéré par les Gitans, adorateurs des oiseaux. Son rapport singulier aux oiseaux rappellerait tout autant Saint François d’Assise, porteur du message de paix, d’amour et de justice qu’il pensait avoir lu dans les Evangiles et qu’il délivrait aussi aux oiseaux, qui lui obéissaient.
On peut également trouver dans le roman des éléments renvoyant au gospel puisque le livre met en scène l’oppression violente et raciste du peuple des Gitans, la révolte contre cette oppression, l’espoir d’une justice, l’appel à une divinité bienveillante. On pourrait en même temps reconnaître un emprunt au chant choral du gospel dans le sujet de la narration qui est un « nous », un collectif qui n’est pas vraiment nommé et reste indéterminé.
Des millions d’oiseaux ont envahi une ville qui n’est pas située, porteuse des stigmates d’une guerre passée dont les traces sont partout bien qu’elle ne soit ni décrite ni explicitée. Saturée des signes de la violence guerrière, la ville n’en est pas moins organisée selon un ordre également violent, l’ordre raciste et meurtrier subi par les Gitans, l’ordre tout aussi violent qui sépare les faubourgs aisés des quartiers miséreux d’un ghetto où survivent les Gitans : parmi les rats, au milieu du délabrement général, ceux-ci ont construit une économie parallèle et illégale, ils ont inventé des moyens précaires de survie et ont créé une ville souterraine dans les égouts, une ville-labyrinthe qui est le double, à la fois inverse et identique, de celle qui s’étend à la surface, faite de tout et n’importe quoi, ville où ils sont « libres », inséparable de la décrépitude, de la destruction, du désordre.
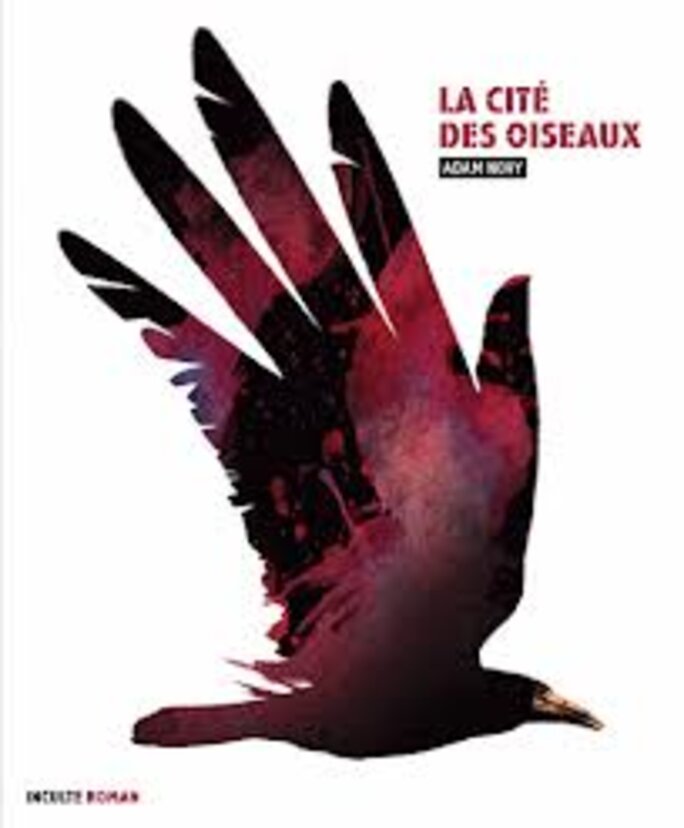
Dans le roman, les rapports sociaux sont inégalitaires et meurtriers. Les opprimés n’ont d’autre possibilité, face à la violence qu’ils subissent, qu’une violence identique. Si on lit ce roman comme une critique de la société américaine actuelle, de la façon dont les grands centres urbains américains (auxquels l’organisation spatiale et économique de la cité imaginée par Novy fait penser) matérialisent cette société, on ne peut qu’être frappé par le constat que l’auteur semble faire et sa vision du futur : violence, destruction, mort. On peut tout autant identifier ces rapports à ceux qui distinguent les grands centres mondiaux, au premier rang desquels figurent les USA, d’une sorte de ghetto dispersé à travers le monde, où l’on meurt de la barbarie des guerres, de la misère et d’un abandon qui doit autant à une logique économique et politique qu’à une forme de discrimination raciste. Quel avenir pour ce monde, sinon la violence et la destruction ? Le livre d’Adam Novy peut se présenter comme un diagnostic de notre temps accompagné d’un pronostic sans espoir, l’expression d’une souffrance actuelle mais sans « bonne nouvelle » ni promesse d’avenir : un gospel qui tournerait à vide, l’inverse des Evangiles. Le livre, simplifiant et grossissant ce qui compose la réalité américaine autant que la nôtre, en montrerait aussi le futur (qui est déjà notre présent) : racisme, haine, ségrégation, conflits, violence. Le « nous » narrateur ne renvoie-t-il pas alors aux survivants de ce futur destructeur, voire aux morts d’une humanité anéantie, morts dont les âmes, d’après la croyance des Gitans du roman, sont présentes dans le corps des oiseaux ? Les Evangiles des oiseaux seraient des Evangiles de la mort, énoncés par les cadavres qui sont déjà là et, par millions, encore à venir.

Agrandissement : Illustration 3

De fait, le roman de Novy montre des traces de notre monde, des signes de notre histoire mais selon des relations paradoxales, désarticulées. Le pays où a lieu la narration est dirigé par un tyran qui est aussi, ironiquement, un juge, chef de l’armée-milice des « RougeNoirs », dont le nom évoque autant les chemises brunes fascistes que les bataillons communistes. Le pays, qui n’est pas nommé, est situé à l’intérieur d’une géographie aberrante : « toutes les nations voisines – Chine, Bolivie, Angola, Oklahoma, Kwakutil, Onandago, Susquehanna et, bien sûr, la terrible Hongrie – nous considéraient comme leur ennemi ». Les Gitans écoutent et jouent du ska en permanence, ils chantent des « prières ska » et ajoutent de « faux diamants à leurs dreadlocks ». Les jeunes des faubourgs aisés s’enthousiasment pour la musique gitane, adoptent comme mode la façon de s’habiller des Gitans du ghetto qui sont dans le même temps affamés et massacrés : « Pendant les récréations, ils imitaient les danses gitanes, tournoyant sur leur tête tels des jouets juifs. Certains montaient même des groupes de ska […]. Les vêtements gitanisants de ces enfants le surprenaient ; des copies branchées et hors de prix des habits du ghetto ». On peut aussi jeter « un sortilège vaudou-gitan ». L’époque est indéterminée, le seul renseignement étant que le roman est situé après une guerre dévastatrice contre la Hongrie : il n’y a ni voitures, ni avions, ni trains et ceux qui le peuvent se déplacent en carrosse blindé ou à cheval.
Ainsi, le roman multiplie les aberrations temporelles et géographiques, il construit des séries de relations paradoxales entre des réalités qui ressemblent à ce que nous connaissons tout en les configurant selon des liens nouveaux et, pour nous, absurdes. On peut lire ce travail de reconfiguration comme le moyen d’une critique de notre monde, mais aussi de destruction. Le roman de Novy montre notre monde mais doublement détruit : détruit dans un avenir dont on voit mal pourquoi il ne correspondrait pas à ce que l’auteur semble en prévoir, en même temps qu’en lui-même détruit puisque n’en sont montrés que des signes incohérents, des lambeaux mélangés, absurdes. Le livre produit, de manière performative, cette destruction du monde et double par là la révolte incendiaire des Gitans autant que la violence aveugle des RougeNoirs. La violence qui traverse tout le roman se propage aussi par l’écriture qui rejoint le désordre que les oiseaux apportent avec eux et libère un chaos recouvrant notre monde reconfiguré, mélangé, en ruines : « Tous […] nous avions vu des immeubles s’effondrer, des pavés voler, des vaches projetées dans le ciel par des explosions, des cochons planer, des fragments des maisons voisines traverser nos murs ».
Le chaos se diffuse d’autant plus que les identités sont ambiguës, tout s’inversant, étant mobile et transformable. La ville se double d’une cité souterraine qui en est l’image et l’envers. Des rapports complexes se construisent entre la terre, la ville et les personnages d’un côté et ce qui parait en être l’opposé : le ciel, les oiseaux, le soleil, les nuages, en particulier à travers les images faites de milliers d’oiseaux composées dans le ciel par Morgan et son père. Les lieux sont autre chose que ce qu’ils sont ou ont l’air d’être : les égouts sont une ville mais qui échappe à toute topographie fixe et établie (« Des régions entières de ces tunnels existaient sans démarcations précises, elles coulaient les unes dans les autres comme des mers dans d’autres mers, impossible de tout cartographier ») ; les frontières géographiques ne sont pas claires et on ne peut se les représenter ; un WC public ou un placard sont aussi des portes d’entrée pour la cité souterraine ; etc.
De même, les situations et personnages se métamorphosent, s’inversent ou sont en relation avec leur contraire, deviennent autre : « Jane et Morgan arrivèrent à une arène où des Gitans priaient des oiseaux […]. Des barbus en costumes d’oiseaux chantaient du rocksteady religieux sur scène […]. D’autres roulaient sur le sol en grognant et en crachant, et même si ce n’étaient pas des prières, ils étaient parfois en proie à des crises d’épilepsie et personne ne voyait la différence ». Morgan forme un duo d’opposés avec son père. Il pourrait être un nouveau messie mais est aussi un imposteur, un menteur chronique, un banal éjaculateur maladroit, une idole révolutionnaire peu convaincue, etc. Il est surtout de plus en plus attiré par l’autre côté, celui de son ennemi. Mike, le fils du tyran, semble n’être qu’un débile violent alors qu’il se révèle capable d’amitié avec les Gitans ennemis, effrayé par la mort et la violence, porteur d’une sensibilité qui l’identifie peu à peu à un autre personnage, son propre frère mort à la guerre. La douce Katherine se transforme en braqueuse de banques et le doux poète – bien que RougeNoir – est envahi par une volonté destructrice totale. Morgan et son père sont pris pour des Gitans alors qu’ils sont Suédois et les Gitans eux-mêmes sont en fait des Norvégiens…
Perpétuellement mobile, composé de différences qui se télescopent, s’agencent, pénètrent les unes dans les autres, le monde évoqué par Adam Novy est sans identités, les frontières et limites ne cessent de s’y défaire et se recomposer pour d’autres destructions, autres compositions éphémères porteuses de leur propre disparition (« Rien n’est réel ici, pensa-t-il, et surtout pas moi »). Ce monde est identique aux images que les oiseaux réalisent dans le ciel, images métamorphiques sans cesse en mouvement, comme celles d’un kaléidoscope qui ne se fixerait pas. Par delà le mouvement incessant et l’absence d’identités, un tel monde implique une absence de sens : il naît d’un dynamisme destructeur qui sans cesse le désarticule, le compose en même temps qu’il le décompose, rien n’étant jamais suffisamment arrêté ou défini pour être porteur d’une signification (« […] les mots, en fait, n’ont pas de sens. Ils ne font que clignoter, disait-il, comme des lumières sous-marines »). C’est à cette suspension du sens que participent la logique des aberrations géographique et chronologiques, l’indétermination des lieux, des situations, des raisons de ce que le roman met en scène. Le seul sens qui habite ce monde serait la destruction, la mort, le néant qui en sont les forces fondamentales. Que peut alors faire l’écrivain sinon exhiber ce chaos, y enfoncer son écriture pour en extraire des images chaotiques, comme celles des spectacles d’oiseaux de Morgan qui dans le récit sont identifiées à des œuvres d’art ? Morgan prend conscience qu’il aime le chaos – « il transformait sa rage inarticulée en intelligence, avec le feu comme écriture ».
L’utilisation particulière des procédés du réalisme magique mais aussi l’humour que l’on trouve dans ce roman vont dans le même sens d’une suspension de la signification et du développement d’un dynamisme constructeur autant que destructeur. La polysémie complexe avec laquelle est traitée la figure plurielle des oiseaux réalise la même logique. Source de désordre autant que d’admiration enthousiaste, ils représentent une menace destructrice autant qu’ils sont protecteurs. Leur présence est énigmatique, personne n’en connait la cause. Ils portent avec eux le souvenir de la guerre et des morts dont ils sont peut-être les âmes. Ils représentent l’aspiration à la liberté, la libération de la terre, des égouts, de la domination. L’aspiration à l’amour aussi, à la beauté. Mais ils incarnent en même temps un chaos destructeur, celui d’une multiplicité innombrable qui envahit tout, compose incessamment des figures éphémères au-dessus de la ville, hante le ciel, les paysages, les maisons, les esprits comme une fatalité obsessionnelle et mortelle.
Il est remarquable que la riche et complexe symbolique qui est traditionnellement rattachée à l’oiseau soit reprise par l’auteur mais d’une façon telle qu’en même temps il la subvertit. La présence massive des oiseaux demeure énigmatique, sa signification reste ouverte. Ils incarnent le chaos contre lequel les habitants de la cité veulent lutter mais sans succès puisqu’il s’agit aussi du chaos qui recouvre leur propre réalité, le destin auquel ils ne peuvent se soustraire. Mais ils sont en même temps vénérés par les Gitans-Norvégiens du ghetto, âmes des morts et divinités. Les oiseaux seraient aussi les signes d’un langage céleste, divin : « Evidemment, nous nous occuperons des oiseaux […] ; c’est grâce à eux que nous savons qu’il est temps de s’installer ici, c’est un signe ». Mais ce signe n’est pas clair : il peut être aussi celui d’une sorte de punition (« nous méritions les oiseaux ») ou bien rester muet, signe de quelque chose, mais de quoi ? Signe peut-être de rien, du néant, et signe du chaos, de la destruction que ces millions d’oiseaux incarnent immédiatement. Signe du silence aussi : si Dieu parle avec des signes d’oiseaux, il est aussi vrai que « la voix de Dieu est silence, le silence par-delà le silence » – silence qui est celui du retrait de Dieu (« Il a fait le monde tel que nous le connaissons comme un bouclier derrière lequel Il se cache ») autant qu’il peut être celui de son inexistence. Comme tout dans ce roman, les oiseaux sont tantôt ceci, tantôt cela, et ils le sont aussi en même temps, désignant des significations qui s’effacent aussitôt, des significations obscures, évanescentes, clignotant « comme des lumières sous-marines » puisque les signes-oiseaux sont indissociables d’un silence fondamental, d’une absence de signification, d’un chaos qu’ils affirment et qui détruit, entrainant tout dans un mouvement incessant de recomposition et de mort. L’écriture du roman de Novy est faite de tels signes affirmant l’absence, la dispersion du sens, le chaos et la mort.
Le roman se termine sur un cri, « un cri effroyable » qui est peut-être celui d’un vautour, peut-être celui d’un humain (dans le roman, en un sens, les humains sont aussi des oiseaux). Ce cri est le signe d’une force violente, brute, inarticulée, et il est le signe d’un futur. Lequel ? Que dit le signe ? En lui-même rien. Ce qu’il dit est immédiatement obscur, est immédiatement l’affirmation d’une force destructrice, d’un chaos sans limites opposé à la volonté d’un ordre stable qui est celle du pouvoir. Mais ce cri, en réalité, dit peut-être la fin totale et irréversible. A moins que, et en même temps, il ne dise la promesse d’un futur, une nouvelle composition éphémère produite par le mouvement incessant du chaos, indissociable de la mort mais qui n’est pas la mort – un futur vivant. C’est peut-être cela, la « bonne nouvelle ».
Adam Novy, La Cité des oiseaux, traduit de l'américain par Maxime Berrée, éditions Inculte, 2013, 359 p., 20 €.



