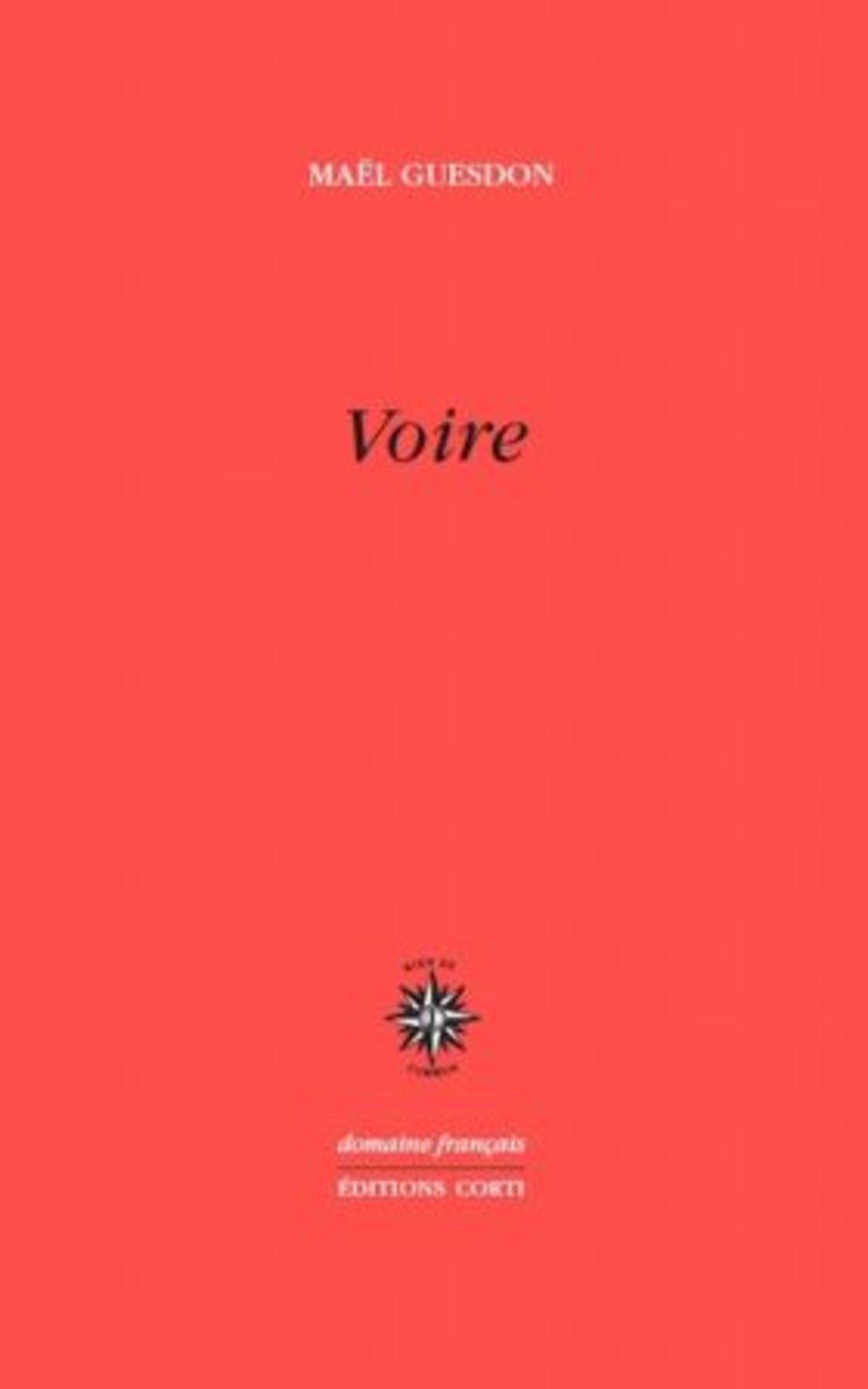
Voire, de Maël Guesdon, présente une poésie que l’on pourrait qualifier de « poésie de la poésie ». Le sujet de cette poésie serait elle-même, l’expérience de la poésie. Par cette ouverture de la poésie d’abord à soi, dans ce livre, la poésie est aussi ouverture à autre chose que soi, ne se dissociant pas d’un dehors qu’elle implique. L’expérience de la poésie est en même temps une expérience du monde, de la pensée, du corps, du langage, mais en rapport avec une altérité par laquelle ils deviennent toujours autres.
Parler de l’expérience de la poésie revient à parler de la poésie comme expérience, pour reprendre ici le titre d’un livre de Philippe Lacoue-Labarthe. Cette expérience s’accompagne d’une faillite du récit, d’une déchirure, un brouillage de l’ordre du récit. Il y a dans Voire des traces d’un récit, des fragments déchirés – une impossibilité du récit, de sa cohérence, de sa clarté, de son explicitation. Quelque chose s’est passé, peut-être relatif à l’enfance – « souvenir des heures à jouer, de chaleur et d’ennui » –, une baignade dans un lac, une robe déchirée, les aboiements d’un chien, un hurlement, un fond trop profond pour avoir pied, peut-être un danger. On ne sait ni ce qui s’est passé ni à quoi ces rares éléments correspondent – et on ne le saura pas. Quelque chose s’est passé, dont il semble rester un souvenir, un souvenir qui n’en est pas un, qui demeure en lambeaux et ne prend pas la forme habituelle du récit. Le récit correspond à un certain ordre du langage que la mémoire de ce qui s’est passé empêche – empêchant toute langue claire, narrative, logique, tout l’ordre habituel de la langue. C’est par cet effondrement de la langue que la poésie advient – elle est cet effondrement, l’ordre de ce désordre.
L’expérience de la poésie serait l’expérience d’une impossibilité liée à la langue mais aussi au monde et à la pensée. Il devient impossible de rassembler la langue et la pensée dans un récit par lequel les choses seraient nommables, cohérentes, mises à distance. Comme il devient impossible d’ordonner le monde selon l’ordre temporel habituel, selon une répartition identifiable des causalités. Comme il est impossible pour un sujet de se situer dans l’ordre reconnu de la grammaire, dans la logique d’un monde dont il serait le centre, le synthétiseur par définition. Le monde se défait en fragments incohérents, non totalisables ni unifiés par les synthèses du sujet. La pensée s’enfonce dans le trou noir d’une mémoire sans souvenir, sans sujet, kaléidoscopique.
Voire s’ouvre sur une phrase énigmatique qui définit le mouvement général du livre, celui de l’écriture poétique : « Toutes choses creuses, méconnaissables, par cercles ouverts sous l’action du vent ». « Toutes choses » n’est pas telle chose, telles choses précises et en particulier, mais l’ensemble indéterminé des choses, les choses en tant qu’ensemble vague, à l’intérieur duquel rien n’existe de précis et circonscrit, tout étant sans contours, sans identité, dilué. S’affirme un mouvement par lequel chaque chose est ouverte, devient ouverte, perd les frontières par lesquelles elle existe habituellement, identifiée comme ceci ou cela, distincte de ceci ou cela. Les lignes se brisent, les contours deviennent poreux à un dehors qui envahit et efface ce qui semblait donné, identifié, évident. C’est un autre être du monde qui advient, un être par lequel ce qui était n’est plus, où l’être n’est plus, le monde devenant méconnaissable : non un autre monde, mais le monde comme autre, le dehors qu’il est lui-même. Le monde perd sa géométrie pour un grand vent destructeur, un chaos qui ouvre, déplace, transforme l’être en un devenir que l’on ne peut refermer ni enfermer.
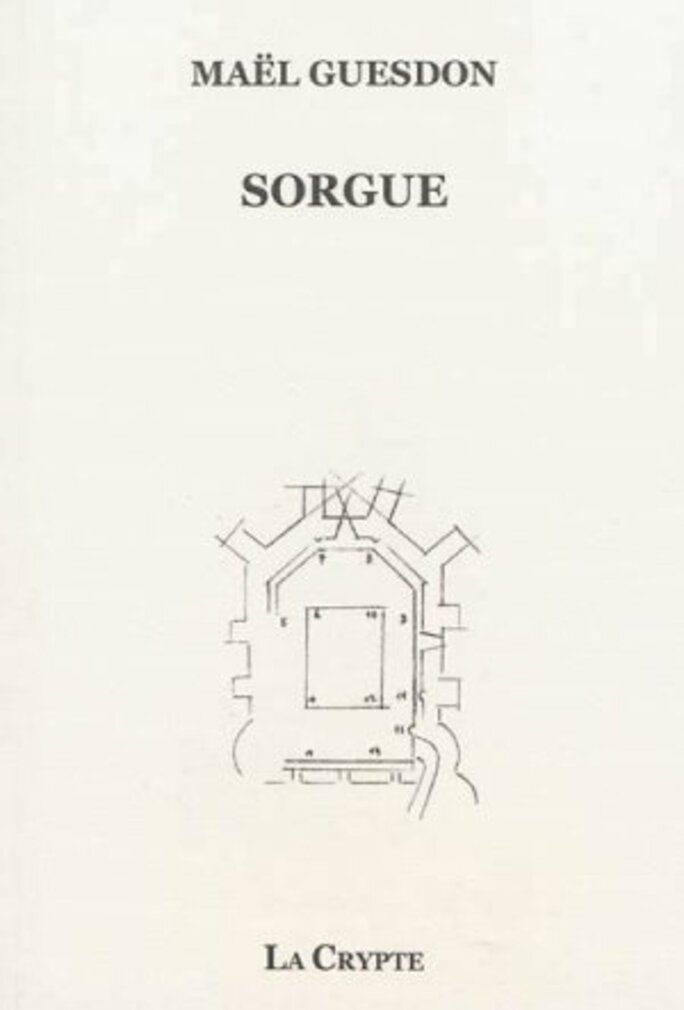
C’est ce surgissement répété du dehors, ce chaos sans fin, qui traverse le livre de Maël Guesdon et implique la logique de son écriture singulière. Le principe de cette écriture – du chaos – est d’abord l’indétermination, l’échappée hors des identités. Rien n’est, tout devient, pris dans le mouvement d’une vie impersonnelle qui est celle du monde, de la pensée, du corps, de l’écriture – devenant, « comme des êtres mouvants », autre chose que le monde constitué, autre chose que la pensée, le corps, l’écriture : « Toutes choses devenues. Jamais là qui les fonde », « Toutes choses disparues. C’est un lieu pour vivre : coupes où le flux n’a pas de reprise ». Maël Guesdon peut écrire que « Le monde se lit dans l’eau », puisque le monde n’est plus que celui, liquide, du devenir, monde de multiplicités mobiles, anonymes, vivantes, dont l’eau est l’écriture insaisissable, illisible, visible non pour un œil ouvert mais pour celui, aveugle, qui se noie. Ne pas avoir pied, sentir que le monde est sans fond, s’enfoncer dans la profondeur sombre du monde, valent pour l’expérience de la poésie qui est une expérience du monde, du langage, de la pensée – une expérience de noyé, coulant à pic dans les abysses du devenir.
Il est évident que cette expérience n’est pas celle d’un sujet et ne se réduit pas aux formes du vécu. Dans Voire, les pronoms personnels sont soit absents, soit changeants, soit encore situés, de manière aberrante, à la fin de la proposition, ou dans une autre proposition que celle dans laquelle ils devraient se trouver (« Reprend l’impossible pour lui de dire la phrase partant d’il »). De manière générale, nous ne savons pas à qui ces pronoms renvoient, puisqu’ils ne semblent en réalité renvoyer à personne sauf à des présences vagues, indéfinissables, sans identité, présences non présentes – comme celles de fantômes, devinés mais jamais vus – qui signalent seulement des points éphémères, évanouissants et mobiles, dans le flux général du devenir. Il en est de même pour les autres types de pronoms qui, du fait de leur mobilité et indétermination, tendent tous vers l’indéfini qui est le régime général de l’écriture de Voire. Il s’agit moins d’évoquer un souvenir, de construire un récit avec ses protagonistes, son déroulement, que de faire exister la mémoire la plus obscure de ce qui s’est passé, une mémoire sans images, sans personne ni pour la dire ni pour la vivre.
Cette impersonnalisation de la mémoire, de ce qui s’est passé, est aussi celle du texte, de l’écriture qui tend elle-même vers l’indéfini, l’indéterminé : écriture sans personne pour l’écrire, sans monde à représenter, écriture sans images et en ce sens abstraite, mais d’une abstraction qui est la vie la plus vivante, celle des mouvements du devenir par lesquels rien n’est mais tout devient sans cesse – toute chose étant autre chose, comme l’écrit Michaux. L’écriture est rendue à son chaos, la pensée à son obscurité, le monde à son délire. Le texte de Maël Guesdon tend, dans toutes ses dimensions, vers une écriture sans images qui est l’écriture d’une expérience sans vécu, sans sujet, sans langage, sans pensée : expérience de la poésie qui est l’expérience du devenir. Par là, dans ce texte, Maël Guesdon croise les œuvres de Duras ou de Blanchot, précisément centrées sur ce rapport à ce qui dans la mémoire échappe au souvenir, à ce qui dans la langue échappe au récit, orientées vers une écriture sans images qui est l’écriture même.
Dans Mille plateaux, Deleuze et Guattari font de la question « qu’est-ce qui s’est passé ? » la question par définition de la nouvelle littéraire, étant entendu que cette question peut aussi être celle du romancier. Maël Guesdon reprend cette question pour en faire celle de l’écriture poétique. Mais par cette question il s’agit moins d’interroger le passé que ce qui dans le présent n’est jamais présent, ce qui dépasse le sujet, la perception, le corps, et n’existe que là où ils sont impossibles : pour une pensée sans sujet, un corps sans organes, un imperceptible qui n’affecte pas moins la pensée et le corps, et qui est l’événement. L’indétermination qui traverse Voire fait que tout y est événement, que rien ne s’accomplit selon les formes emprisonnantes du sujet, de la langue, de la perception qui n’est que reconnaissance. Tout y surgit et disparaît dans le même temps : le feu, l’eau, les arbres, un pied, une main, les murs, le miroir, le jardin – tout y est insaisissable, jamais effectivement présent. En ce sens, Maël Guesdon propose avec ce livre une œuvre qui se soustrait à la représentation, puisqu’il n’y a de représentation que de ce qui est présent, pour privilégier l’événement, la vie du devenir : « Nos régions dites fantômes jamais ne se présentent. / Et cela doit suffire puisque le vent a lieu ».
Ce n’est pas un hasard si le thème de l’œil et du regard – déjà central, par homophonie, dans le titre – se répète à travers certaines pages, un œil qui ne voit pas mais devine, pour des choses qui « n’ont pas besoin d’être vues » – un œil aveuglé par l’obscurité des profondeurs du lac, qui ne voit plus que cette obscurité et les événements qui la traversent : un regard qui ne voit plus ce que voient les yeux mais voit, dans le visible, ce qui échappe au visible. Et de même une pensée qui pense ce qui, dans la pensée, échappe à la pensée. Si le titre Voire renvoie au regard, au fait de voir, il renvoie également à l’adverbe qui sert de conjonction ainsi qu’à exprimer le doute : voir devient le fait d’un regard en suspens, incertain et indéterminé, qui ne voit pas ce qu’il voit pour voir l’autre invisible de ce qui est, l’autre de l’être, le surgissement ininterrompu des événements à travers le monde délirant du devenir.

Ce qui s’est passé, l’événement, fuit l’ordre de la pensée, du corps, de la langue, du sujet, l’ordre ontologico-policier du monde. Et la mémoire de ce qui s’est passé évoque moins un passé que ce qui, dans la pensée, le corps, la langue, le monde, n’est jamais présent, n’existe, si l’on peut dire, qu’en tant qu’événement et devenir. Deleuze et Guattari soulignaient que la nouvelle et la question « qu’est-ce qui s’est passé ? » impliquent toujours un secret : quelque chose s’est passé, on ne sait pas précisément quoi. Mais le secret dont il s’agit ici est moins un secret à découvrir et dévoiler, un fait caché ayant eu lieu et que l’on pourrait dire, énoncer en pleine lumière, que la forme du secret, un secret qui ne renvoie peut-être à rien. C’est cette dimension du secret que l’on retrouve dans Voire : quelque chose a eu lieu, ou semble avoir eu lieu, mais qui n’est pas dit. Et cette forme du secret contamine l’ensemble du livre : les mots sont là, avec leur sens, mais celui-ci est suspendu, incertain – voire –, comme les éléments évoqués, ou encore les gestes, les lieux. Si ce qui existe implique un secret qui demeure tel, ce qui existe perd alors son évidence, son sens commun, et se dédouble selon des dimensions inaccessibles, autres que celles qui existent ici et maintenant. Ce qui est implique autre chose, une altérité qui échappe au présent et à la définition, au récit. Ce qui est implique ou enveloppe une altérité qui échappe à la langue, à la perception, à la pensée, par laquelle ce qui est n’est pas, s’échappe dans un devenir sans terme.
Qu’est-ce qui s’est passé ? Peut-être rien. Et même sans doute rien, puisque l’événement en tant que tel n’est jamais ce qui arrive, si l’on entend par là ce qui arrive à une conscience, à un sujet, à un corps. L’événement est toujours ce qui n’est pas arrivé, le non vu, le non perçu, le non pensé dont la poésie implique l’expérience et qui est donc toujours, en même temps, l’expérience d’une rupture, d’une altérité par laquelle le monde n’est plus mais devient, ainsi que le corps, la pensée, le langage. La poésie est ainsi l’expérience paradoxale, car non vécue, d’une altérité radicale du monde, de la pensée, du corps, de la langue – l’expérience d’une altérité qui les traverse et par laquelle ce qui est s’écroule. N’existe plus que le murmure silencieux du secret du monde – le bruit du vent.
Maël Guesdon a su créer une langue pour ce silence en créant dans la langue d’étranges postures, en faisant de la langue un ensemble de signes et mouvements énigmatiques. La langue y est désarticulée, construite comme un kaléidoscope incessamment mobile. Si la plupart des pronoms personnels sont absents ou situés de manière aberrante, c’est que les propositions sont centrées autour des verbes, c’est-à-dire de mouvements que la syntaxe n’emprisonne pas mais au contraire libère et laisse à leurs devenirs. La syntaxe y est elle-même moins une combinaison logique qu’une syntaxe de l’écart, du discontinu et du mélange : les phrases ne sont pas des phrases mais des fragments asyntaxiques, agrammaticaux, souvent sans sujet, qui s’interrompent brutalement ou conjoignent des propositions hétérogènes. Ou bien elles peuvent se continuer ailleurs, dans une autre proposition, une autre page. Les phrases, comme « toutes choses », sont ainsi ouvertes, elles ne sont qu’ouverture au mouvement qui les défait, au flux du devenir qui les fragmente sans cesse, aux événements qui les constituent.
On pourrait penser, à la lecture du livre, à André du Bouchet ou à Cummings, ou encore à Paul Celan, ces trois auteurs, aux œuvres si différentes, ayant pourtant en commun cette même aspiration à une langue radicalement asyntaxique, agrammaticale, elliptique, tendue vers ce qui dans la langue n’est pas dit mais existe par et dans elle : le devenir, le chaos, l’événement. Un silence dans la langue, donc, par lequel la langue est défaite et laissée à ce que son ordre habituel empêche. Une telle écriture, qui est celle de Maël Guesdon, tend ainsi non vers un récit, non un sens, mais une existence qui est à peine une existence, celle d’un murmure deviné, d’un monde trop mobile pour être vu, d’une pensée trop chaotique pour être pensée. Par cette écriture, finalement, ce qui est se voit débordé et effacé par le temps paradoxal du devenir et de l’événement, temps qui donne son rythme à l’écriture poétique qui est le rythme du chaos, le cœur battant de la vie.
Maël Guesdon, Voire, Editions José Corti, 2015, 84 pages, 14 €.
Maël Guesdon sur Médiapart : http://blogs.mediapart.fr/edition/gilles-deleuze-aujourdhui/article/260115/premieres-lecons-d-etisme-par-marie-de-quatrebarbes-et-mael-guesdon



