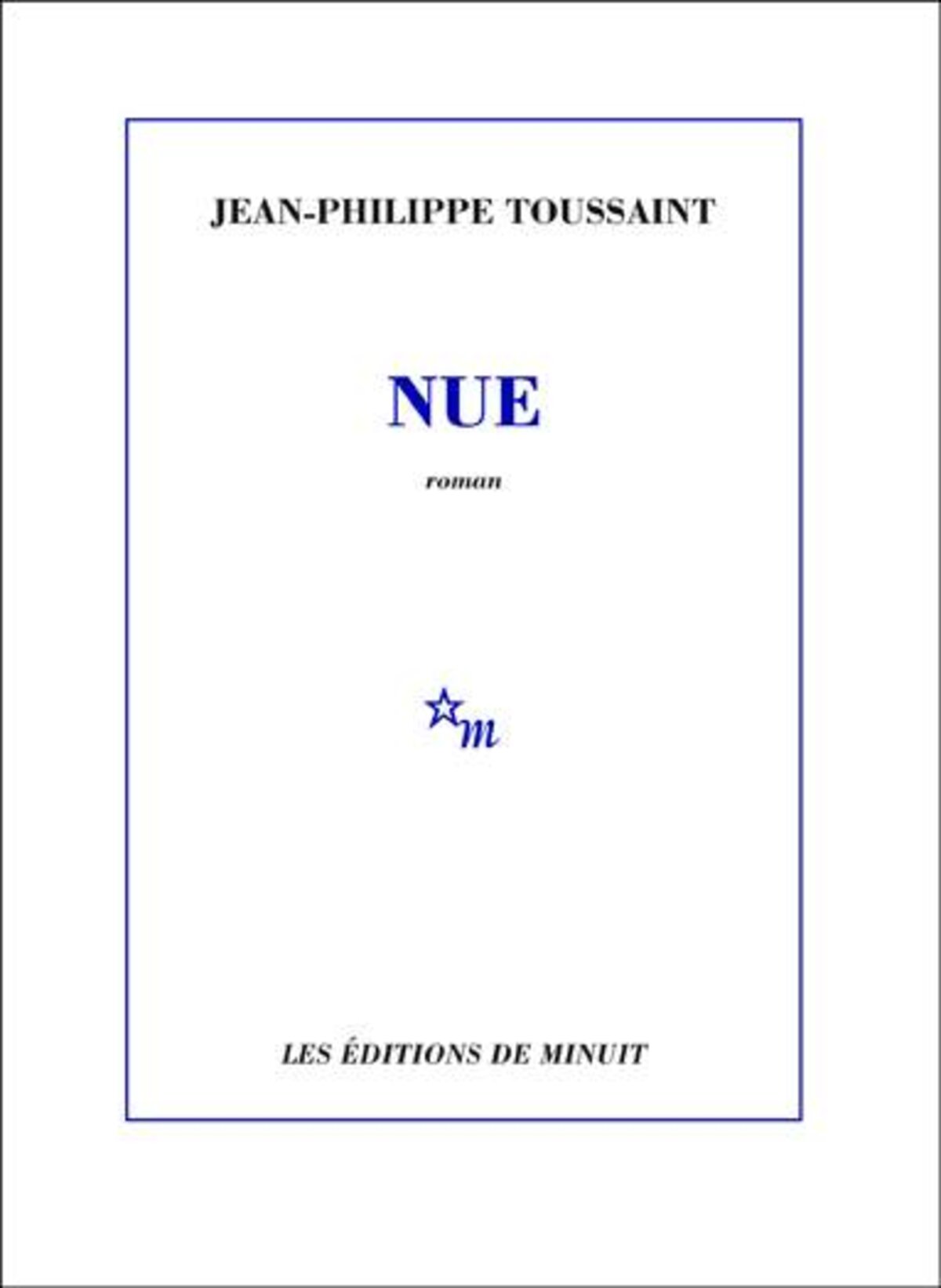
Voici Nue, le dernier volet du “cycle de Marie” que clôt ainsi avec éclat Jean-Philippe Toussaint. Mais nue vraiment ? La belle héroïne qu’est Marie, styliste inventive jusqu’au délire, y apparaît bien plus vêtue qu’à l’accoutumée. Mais c’est que la nudité chez elle est plus un état d’âme qu’un fait matériel : la jeune femme est dans une telle adéquation avec le monde que le narrateur lui prête joliment une “disposition océanique”.
Et il est vrai que nous retrouvons cette Marie, qui nous est familière depuis Faire l’amour (premier volet, 2002), en prise étroite avec les éléments et en particulier dans cette île d’Elbe où elle est venue enterrer Maurizio, le fidèle intendant de son père. Tous les romans du cycle “Marie Madeleine Marguerite de Montalte” (oui, c’est ainsi qu’il se nomme) sont d’ailleurs remarquablement cosmiques : Marie aime l’eau certes mais s’entend à manier la terre, à coexister avec le feu, à humer l’air odorant, — où l’on retrouve ainsi la nymphe que nous connaissons bien. Et ce feu et cet air fournissent d’ailleurs une des plus belles séquences de Nue puisque, sur l’île, une chocolaterie a été incendiée et si bien que l’atmosphère entière de la région est chargée de fragrances chocolatées variant selon les moments et enrobant littéralement la belle visiteuse. Toussaint, autant le dire, se confirme ici en grand artiste de la sensation, une sensation lestée de féerie et de mythe.
Mais ce bain de chocolat un peu fantastique n’est pas le plus important, on s’en doute. L’essentiel est la relation difficile qu’entretiennent Marie et son amant-narrateur — qui dit “je” mais qui, comme le narrateur proustien, révèle peu de lui-même. Il y eut ainsi la rupture au Japon, sur laquelle Nue revient largement dans un épisode drôlatique ; il y eut l’été des retrouvailles un peu ratées sur l’île ; il y a un retour à Paris où le couple se sépare sans un mot ; et il y a l’émouvante rencontre dans un bistrot pluvieux de la place Saint-Sulpice. “J’ai quelque chose à te dire” (p. 87), a annoncé Marie. Mais elle se tait et il faudra attendre cent pages et
le voyage sur l’île pour que vienne la révélation (une annonciation, autant le dire), préludant à cette phrase finale : “Mais, tu m’aimes, alors ?” (p.170)
Les romans du cycle disent donc un longue relation amoureuse intermittente. Et Nue plus que les autres. Mais pour autant rien de sentimental ou de psychologisant dans le propos. Un homme, une femme se cherchent, se trouvent, se perdent, et c’est presque tout. L’homme guette la femme, l’attend, l’accompagne dans ses foucades. Il dit ce qui les sépare et ce qui les rapproche. Il rapporte sans pathos des états mentaux suscités par les événements et les choses. Avec juste parfois l’affleurement imprévu d’un geste et d’une phrase dite : “Toi, dès que ta main m’effleure, mmmhhhh.” (p. 30).
Flux et reflux du désir. Sourdine des élans dans le tohu-bohu d’un voyage.
Car il y a beaucoup ce séjour dans l’île. Automnal et tout empreint de mélancolie funèbre. Le couple est venu assister à un enterrement. Il assiste surtout à un incendie criminel, à l’arrestation d’un homme, fils du défunt et sans doute racketteur. Et il transporte avec lui le poids d’un amour qui se délite comme aussi la lourdeur du secret de Marie. Mais étrangement, c’est comme si ce même couple se régénérait à tout ce deuil qui l’entoure.
Car si, chez Toussaint, l’émotion est retenue, diffuse, elle n’en est pas moins là, prenante comme l’odeur de chocolat répandue sur la ville. Elle atteint d’ailleurs un pic vers la fin, là où, dans l’étreinte, l’océanique Marie se répand en pleurs : “Marie […] pleurait dans mes bras, je ne voyais pas son visage dans l’obscurité, je ne le sus pas avec les yeux, qu’elle pleurait, je le sus avec la langue, je sentais ses larmes dans ma bouche. Tout était humide aqueux, fluide, ses larmes et nos salives qui se mêlaient dans le noir. Ne pleure pas, lui disais-je” (p. 169).
Émotion donc mais émotion qui rappelle sans trêve qu’elle naît de l’art et de la fiction. La somptueuse avant-scène du roman le dit assez, qui voit défiler sur un podium à Tokyo un modèle vêtu d’une robe de miel (sans coutures !) et poursuivie d’un essaim d’abeilles. Quel morceau de bravoure ! Quel raffinement patient de l’écriture, — à l’égal de celui que Marie elle-même met à faire toute chose. Quelle percée dans l’imaginaire aussi ! À cette performance en succède une autre consacrée au vernissage de l’exposition au musée de Shinagawa, vernissage que le narrateur ne pourra suivre que depuis un hublot du toit… Cette fois, nous glissons vers le burlesque : de son perchoir, le héros suit une scène où un bellâtre nommé Jean-Christophe de G. est victime d’un affreux quiproquo. Mais, au fait, ce Jean-Christophe n’est-il pas mort auprès de l’héroïne dans La Vérité sur Marie (2009) ? C’est que Toussaint ne déteste pas embrouiller le lecteur au gré de temporalités télescopées.
C’est dire que la vigilance active de ce même lecteur est sollicitée sans trêve. Ainsi de Nue, qui certes se lit très bien de façon autonome, mais s’enrichit clairement de la mémoire des autres récits du cycle. Car, étant passé d’un roman à l’autre et ayant gardé le souvenir de chacun, ledit lecteur se trouve pris dans une chambre d’échos, où tant d’éléments renvoient à tant d’autres. Aussi Jean-Philippe Toussaint nous apparaît-il en grand maître du temps qui circule entre présent et passé et aime à mettre en rapport et en équivalence des scènes apparentées. En superposition, celles-ci procurent à l’auteur, au personnage et au lecteur la matière intime d’une plongée dans la conscience et l’imagination qui sous-tend tout le reste.
Jean-Philippe Toussaint, Nue, Paris, Éditions de Minuit, 14 € 50



