En 2002, Daniel Lindenberg publiait au Seuil un ouvrage rapidement bouclé et intitulé Le Rappel à l’ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires. Cette appellation, abrégée en néo-réactionnaires, allait demeurer.
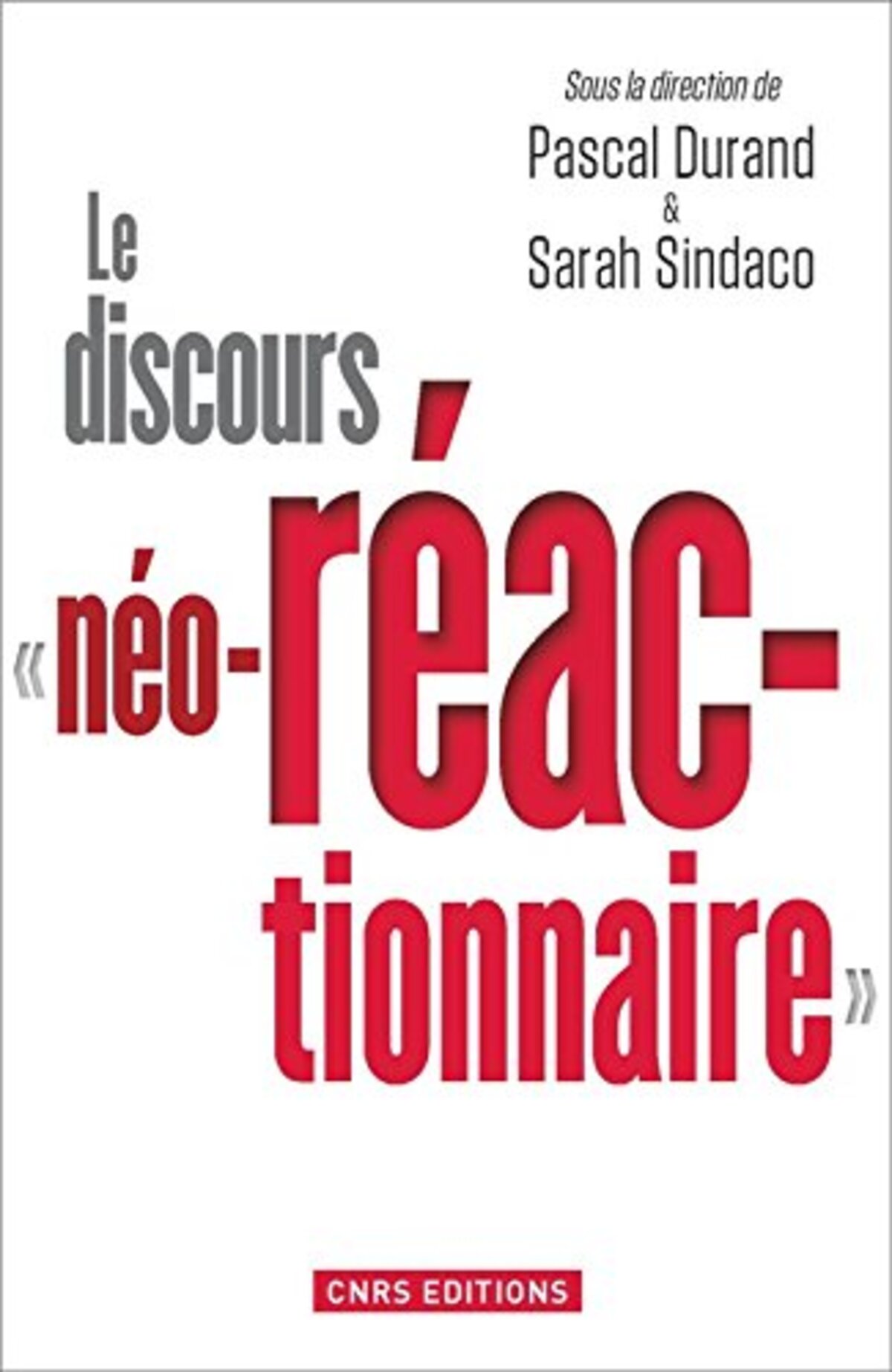
Elle permettait d’identifier une constellation d’écrivains et de polémistes qui, après la liquidation de mai 68 et la chute brutale du communisme soviétique, retrouvait la morgue impatiente de la droite râleuse et rageuse telle que la France l’a connue du temps de Charles Maurras et de Henri Béraud. Nombre des auteurs ainsi désignés allaient répliquer à Lindenberg, l’accusant de tous les maux. Mais s’agissait-il d’une seule et même mouvance ou au moins de quelque personnage collectif ? Ou plutôt avait-on à faire à autant d’interventions singulières et dispersées ? En tout cas, à travers ces réactionnaires de tout poil, une idéologie se donnant pour réfractaire aux valeurs régnantes et au “politiquement correct” se manifesta clairement et profita des échos qu’elle obtenait dans les tribunes médiatiques pour faire de sa position minoritaire et de son discours hétérodoxe un levier puissant et qui ne trouvait pas de véritable équivalent dans le camp dit progressiste.
Après Lindenberg, ce phénomène de la nouvelle réaction n’allait pas faire l’objet d’une investigation méthodique jusqu’au jour tout récent où, sous la houlette de Pascal Durand et de Sarah Sindaco, un groupe d’universitaires choisit de produire, en un fort volume de 25 chapitres, des analyses du Discours néo-réactionnaire. Soit une série de dissections attentives préférant l’étude des cas particuliers aux vues d’ensemble ou aux parcours thématiques.
Le lecteur pouvait craindre qu’une enquête aussi dense distille quelque ennui. Mais il n’en est rien et pour deux raisons. C’est d’abord que le volume parcourt forcément l’actualité des dernières années tout en évoquant des personnalités que la télé a rendues familières : Zemmour ou Finkielkraut ne sont-ils pas devenus, sur petit écran, des sortes de « guignols de l’info » ? C’est ensuite que la polémique qui domine chez ces essayistes a toujours quelque chose de plaisant pour autant qu’elle soit dûment déconstruite. Ainsi des démontages du discours Rioufol par Christine Servais, du discours Muray par Francesca Lorandini, du discours Houellebecq par Dominique Rabaté, du discours Millet par Jérôme Meizoz ou du discours Fumaroli par Philippe Roussin ou bien encore des trajectoires parallèles de ces “repentis” que sont Glucksmann et Bruckner par Sarah Sindaco. Autant d’analyses qui ne manquent ni d’allant ni de saveur. Et puis il y a encore, mais c’est déjà moins drôle, que les cibles des différents réactionnaires sont à peu près toujours les mêmes, comme le notent les directeurs du volume dans leur Introduction. Ainsi les néos-réacs n’en finissent pas de ressasser le thème du grand déclin français en diversifiant peu les critiques : « critique de mai 68 et notamment de la libération des mœurs et d’un féminisme institué en dogme ; critique de l’égalitarisme démocratique et des phénomènes de nivellement, de massification et de relativisme culturel qu’il induirait ; critique du droit-de-l’hommisme et du primat accordé aux minorités ; critique de la société “métissée” et de “l’antiracisme institutionnel”, etc. » (p. 13).
Cependant, beaucoup des cas examinés ne sont pas simples et s’illustrent par des contradictions positionnelles qui viennent par exemple de l’origine des écrivains-journalistes et des journalistes-écrivains dont quelques-uns ont un passé de gauche, dans lequel, étant donné leur option nouvelle, ils se prennent facilement les pieds. On peut penser à Taguieff (analysé par Jean-François Savang), qui défend une démocratie ouverte tout en dénonçant un progressisme entre illusion et imposture. On peut penser à Houellebecq qui s’affirme de droite tout en défendant des vues égalitaires. On peut penser à ceux qui, comme Henri Pena-Ruiz, prennent en charge une laïcité qui tourne à un laïcisme métaphysique et que pointe à bon escient Marc Jacquemain. On peut penser avec Édouard Delruelle à tout ce trajet qui va de Dufour à Lacan et défend une théorie du Tiers symbolique faisant de la prétendue défection des pères un drame de civilisation. Dans ces cas, les messages sont passablement brouillés et dissimulent les intentions véritables.
Le volume contient encore quelques articles plus ensemblistes qui sont les bienvenus. C’est le chapitre inaugural de Gisèle Sapiro montrant que des années 30 à aujourd’hui la répartition de la droite réactionnaire en trois types (notables, esthètes et polémistes) se retrouve et se reproduit. C’est aussi le chapitre dû à Mohamed Aït Aarab faisant utilement apparaître que l’antiaméricanisme du temps de Georges Duhamel se nourrissait de topiques qui ne sont plus ceux de Finkielkraut et de la culture Disneyland qu’il incrimine. Enfin, s’agissant du mariage pour tous et de l’attitude des juristes de droite à son endroit, Nicolas Thirion pointe au gré d’une démonstration brillante un retour consternant au droit naturel et à une réification des concepts juridiques qui est en soi un déni de démocratie.
Par-delà la qualité de ses études particulières et ce qu’elles ont d’excitant, Le Discours néo-réactionnaire nous restera comme une grille de lecture précieuse des idéologies les plus actuelles en même temps que les plus inquiétantes. Il sera désormais difficile d’identifier la nouvelle réaction sans son secours.
Le Discours « néo-réactionnaire ». Transgressions conservatrices, sous la direction de Pascal Durand et de Sarah Sindaco, Paris, CNRS éditions, 2015, 364 pages. € 25.



