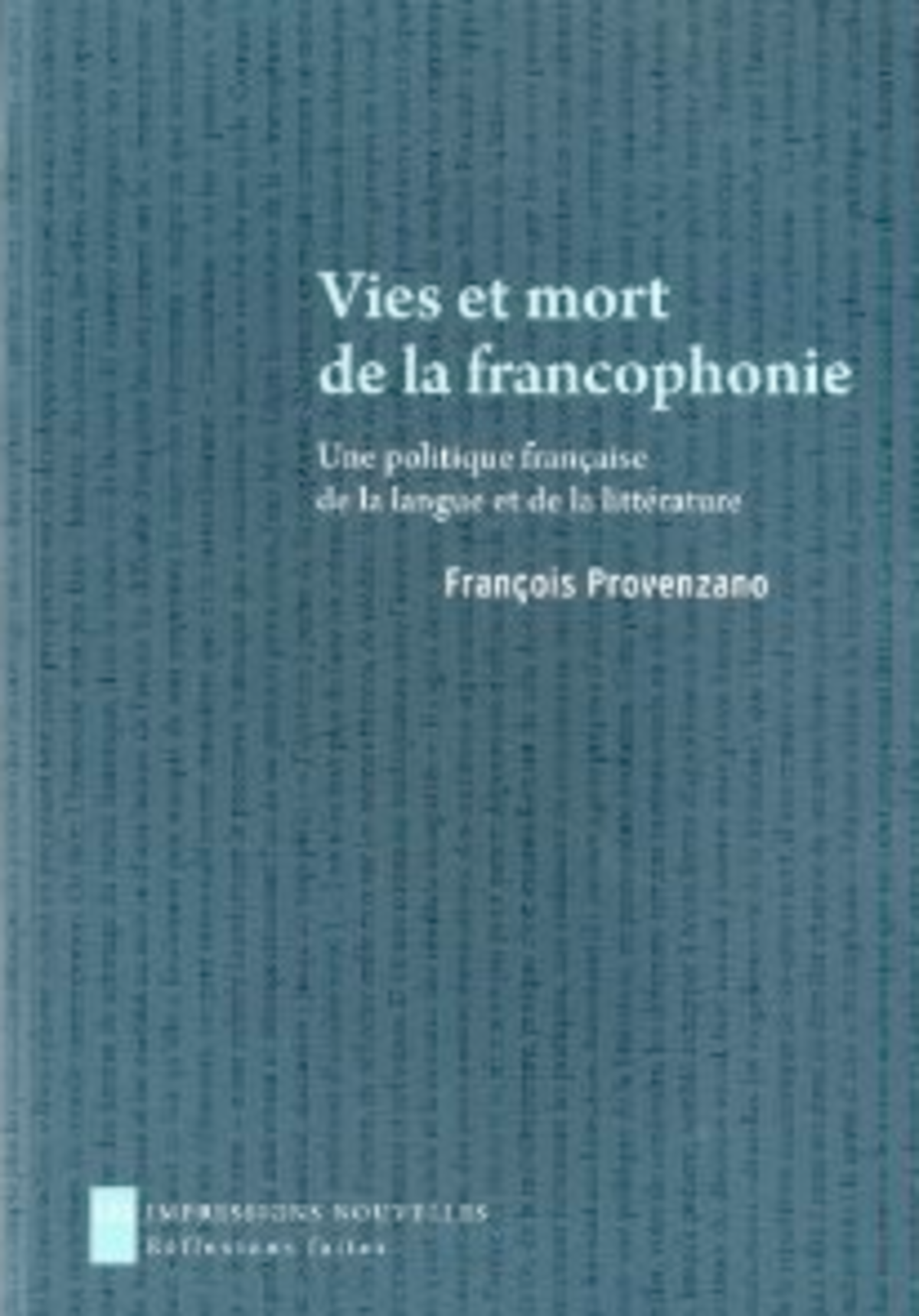
Dans un ouvrage aussi récent que substantiel, Vies et Mort de la francophonie, François Provenzano s'est attaché à analyser et à démonter une «région» singulière de la grande doxa multiforme. Il s'agit d'un discours de la francophonie qui est certes aujourd'hui en recul –Nicolas Sarkozy lui a substitué le thème de l'identité française– mais dont le fonctionnement, avec ce qu'il peut avoir de mystificateur, a valeur d'exemple. C'est que ce discours promeut l'existence d'une réalité largement fantasmée –quelque chose comme une supernation française–, dont les véritables raisons d'être, politiques et stratégiques, sont occultées en permanence.
Cette francophonie ou «francodoxie» (comme dit Provenzano) a toute une histoire puisqu'on la voit émerger dès la fin du XIXe siècle avec Onésime Reclus, frère du géographie Élisée Reclus, pour venir aboutir dans le dernier quart du XXe à la création des «études francophones» en milieu universitaire. Son enjeu principal est la langue telle qu'elle est censée rassembler les pays où le français est parlé. La francophonie est institution d'un côté (organismes et réunions de caractère international) et champ littéraire de l'autre. Mais l'objet essentiel de la présente analyse est de lier incessamment la première instance à la seconde, à travers «l'ensemble des discours qui tissent un lien entre ces deux grands ensembles, c'est-à-dire qui construisent une forme de connaissance sur la littérature de langue française en référence à des valeurs promues par des institutions extra-littéraires» (p. 55).
À coup sûr, le discours francodoxe possède ses arrière-plans politiques inquiétants. Outre qu'il fleure bon l'entreprise néo-coloniale (de la France vis-à-vis de ses anciennes possessions), il tente de façon plus avouée de compenser la grandeur perdue du français en coalisant, autour de la République, régions périphériques (le trio Québec, Suisse romande, Belgique wallonne) et nations africaines ou asiatiques où le français demeure langue de culture. Et, par là, de faire pièce à la domination anglo-saxonne.
Mais ce qui occupe vraiment François Provenzano est ailleurs encore. Il est de montrer plus abstraitement comment de nombreuses représentations sont mobilisées pour accréditer l'idée qu'il existe une grande famille supranationale à fondement linguistique à l'intérieur de laquelle, au nom d'un intérêt supérieur, les contradictions s'annuleraient. Dans l'entreprise, le littéraire joue tout son rôle puisqu'il s'agit d'intégrer des espaces nationaux minoritaires à la prestigieuse littérature française en mal de rayonnement. Avec la mauvaise foi de tous les idéalismes, les francodoxes de service entrent alors en action et imaginent les solutions les plus discutables. Ainsi chacune de leurs interventions vise à renouer avec une universalité qui, au total, n'a jamais été qu'imaginaire.
Tout un discours métalittéraire s'attelle donc à la tâche, sollicitant les forces disponibles pour célébrer la gloire du français éternel. Et l'on verra par exemple dans tel ouvrage la «négritude» d'un Aimé Césaire être francophonisée avec le secours d'Arthur Rimbaud, en complet déni de l'engagement radical qui fut celui du poète antillais. «L'ensemble des lettres francophones, écrit Provenzano, devient ainsi lisible à large échelle, comme manifestation unanime de l'esprit français dans le monde» (p. 171). Certes, au fil du temps, le discours francophone a réussi à se défaire de ses connotations impérialistes. Mais, s'il est sorti de ses mythologies premières (la supériorité d'un français de vocation cartésienne, par exemple), il n'en est pas moins resté un discours d'autolégitimation plus que suspect.
Tout au long de son livre, François Provenzano démonte avec une tranquille assurance et beaucoup de subtilité les présupposés de ce discours-là et de ses manœuvres. Il prolonge ainsi, avec des méthodes nouvelles d'analyse, le travail qui, en France, fut initié par un Roland Barthes. Il nous rappelle par là que la démystification des discours doxiques est une tâche sans fin.
François Provenzano, Vies et mort de la francophonie. Une politique française de la langue et de la littérature. Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, « Réflexions faites », 2011. 20 €.



