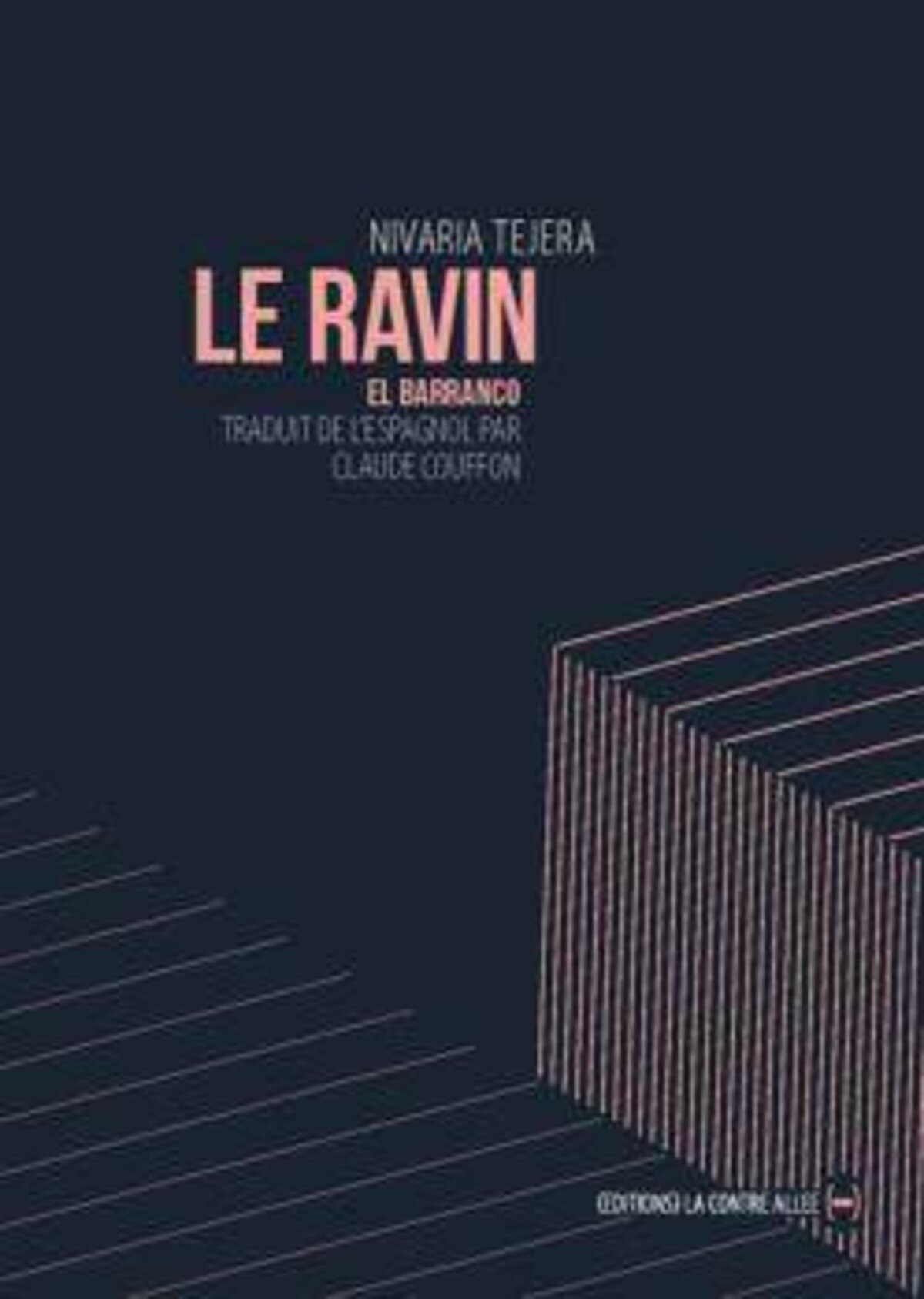
C’est en 1955 que le traducteur et chroniqueur à la revue mensuelle Les Lettres Nouvelles, Claude Couffon, reçoit le manuscrit de Nivaria Tejera : El Barranco (Le Ravin). Il le dévore en quelques heures, le traduit, et le confie à Maurice Nadeau qui en assure la première édition française en 1958. Unanimement salué par la critique, il sera réédité en 1986 par Actes Sud.
L’éditeur Benoît Verhille qui republie le texte en février 2013 a compris l’amitié puissante, « parfois orageuse », qui lia immédiatement le traducteur et l’auteure comme un ciment, les versions française et originale. Il faut dire qu’à La Contre Allée, chaque livre témoigne d’une aventure humaine : pas question donc de retraduire pour retraduire. L’éditeur a d’abord rencontré l’auteure par le biais de lectures à voix haute d’un autre texte Fuir la spirale — bien avant la création de la maison d’édition — puis par sa poésie. « Nous avons attendu d’avoir les reins assez solides pour rééditer Nivaria », nous confiera-t-il. Cinq ans plus tard, toute la modernité et la fougue sensible du Ravin nous sont à nouveau données à lire.
Et c’est un tourbillon.
« Aujourd’hui, la guerre a commencé. A moins que ce ne soit il y a longtemps. »
Voici les premiers mots de la petite fille de 7 ans, narratrice et témoin du début de la guerre d’Espagne aux Canaries, dans sa maison familiale où vivent plusieurs générations, dont son père, républicain et militant, qui sera violemment enlevé au reste de la famille par l’armée dès le début du récit. La petite voit son monde s’effondrer, amputée des conditions d’épanouissement affectif minimales, confrontée à la pauvreté, à la prison, au tribunal, à la peur du peloton, à l’angoisse de voir un jour le nom de son père inscrit sur la liste des disparus.
« Je sais maintenant qu’on appelle « peloton » un groupe de prisonniers qu’on a conduits au Tanqueabajo. Le tanqueabajo est un ravin immense, couvert de végétation, où l’on jette les cadavres des animaux et les ordures de toute la ville. Après les avoir tués, on les y abandonne et ils restent à pourrir là sans que leurs familles soient prévenues. »
La brutalité et l’éclatante absurdité de la guerre surgissent par la bouche d’une enfant sacrifiée sur l’autel des idéologies. Il n’est pas question d’héroïsme ici : la naïveté de la petite, son innocence profonde ne lui permettent pas de toute façon de saisir les idées abstraites, dont elle perçoit les signes au travers des cloisons sans en saisir la portée, jusqu’à ce que « république » ou « liberté » riment avec « absence », « enfermement » et « privation ». C’est la vérité nue de la guerre, le trauma qu’elle inscrit au plus profond des corps dont il est ici question et qui rend illusoire toute justification rationnelle. Elle martèle les mots des grands, qui vont toujours par deux : « La guerre-la guerre », « Circulez-circulez », quand l’absurdité de l’injonction occupe la place pour deux, sur la page même.
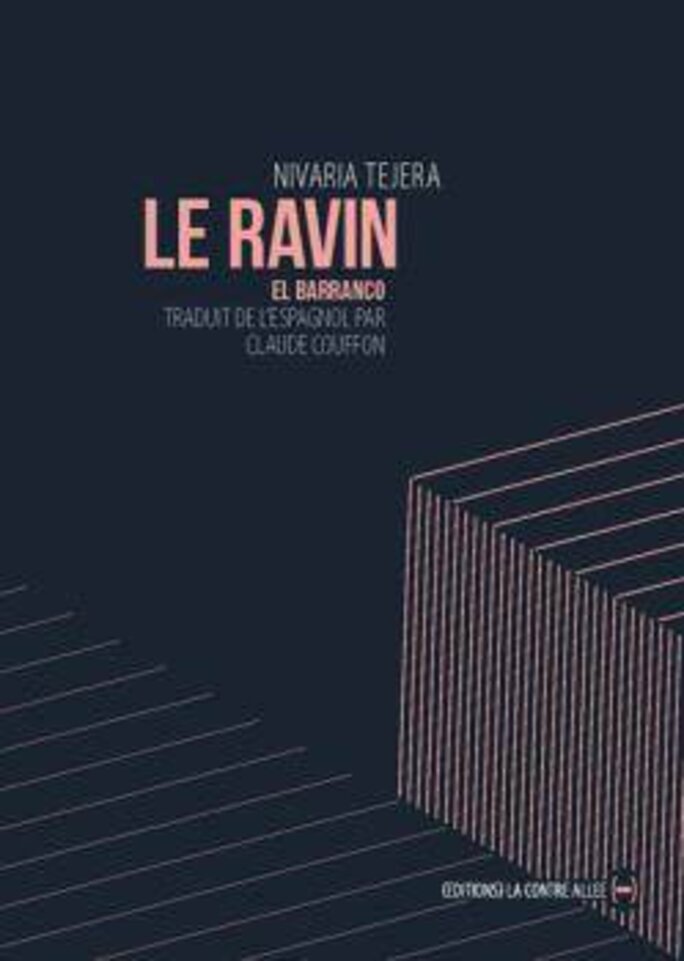
À l’âge où la perception du monde s’aiguise, où les lancinants « pourquoi ? » enfantins signent le début de la pensée abstraite et de l’induction, la guerre impose à l’enfant d’accepter la plus impalpable des souffrances psychiques, jour après jour. Pourquoi papa n’est plus là ? C’est le jugement d’existence même qui est ici questionné et malmené : sa conception naissante du monde se constitue autour d’un vide, qu’elle doit pourtant comprendre et combler seule, sans savoir comment, pour survivre. Quel mal a-t-il donc été fait, qui mérite ce châtiment ? Il doit forcément exister un moyen de se racheter…
Esseulée et perdue parmi les signes de la guerre, l’enfant est percutée de sensations, que seule la prose poétique de l’auteure est à même de transmettre. La petite interprète, projette, comme tous les enfants de son âge, mais les matériaux à la disposition de son imagination ont ceci de cruellement singulier qu’ils ne peuvent déjà plus être le terreau d’un enchantement le monde. Ils s’imposent à elle et à sa sensibilité meurtrie. Les grilles de la prison sont des lignes, les grilles sont froides, la prison est froide, papa deviendra froid. La ligne est une perception récurrente, elle sépare : elle est démarcation, porte de prison, barreaux... Mais elle est aussi la ligne de chemin de fer, continue et au bout de laquelle elle le retrouvera, peut-être. La conception métonymique de la réalité fonde son rapport à elle, elle tente de tisser des liens, de faire surgir le sens des choses, d’une couleur de peau à la maladie, du dehors qui s’immisce violemment dans le domestique, de l’uniforme rayé au père, du ventre rond au petit frère qui arrivera bientôt, de la ligne au ravin.
« "Ne sors pas hors de la ligne, petite sotte ; tu as mal visé, tu ne sais pas lancer, tu ne sais pas…" Et Samarina se met à énumérer tout ce que je ne sais pas faire pour bien jouer à la marelle. »

Le Ravin est aussi une figure ambiguë. Le corps de l’enfant devient le lieu de la lutte, entre la guerre et la paix, elle concentre à elle seule tout le fossé, l’infranchissable : entre deux temps — celui de l’enfance et le temps adulte, le temps de la sensation vécue et celui du souvenir — et entre deux espaces : le monde conçu comme un autre que soi, qui s’offre à l’intelligence humble et naïve, et le monde comme réalité malléable, que l’on plie à l’envi selon son appétence au pouvoir. Ces deux temps et ces deux espaces se mêlent pourtant comme les deux faces d’une même pièce, dans le ravin et ses versants. La petite est le ravin, ses berges et son gouffre. Lieu de préservation du souvenir mais aussi lieu d’amnésie, d’oubli du père et de soi. Tout ramène au ravin, à un trou noir, à la nuit de la guerre.
« La guerre continue, mais chaque jour elle devient plus intime et mieux organisée. "Elle s’apprivoise" prétend grand-père. Elle a cessé d’être le brouhaha assourdissant des premières heures de soulèvement ou ces interminables journées de pluie durant lesquelles les fusils des soldats grattaient nos fenêtres. Elle est devenue un secret dont chacun s’est fait en quelque sorte le complice, tout en conspirant contre elle. »
La modernité du texte, qui avait frappé Claude Couffon en 1955, n’a rien perdu de son actualité : du récit poétique aux scènes de tribunal scandées de dialogues réinterprétés par la petite, à la forme chorale des gamines derrière leurs grilles qui font figure d’hydre semi bienveillante, les multiples formes qu’adopte le texte servent l’expression d’une sensibilité foisonnante et tumultueuse.
« Je ne voulais pas les nommer non, mais j’ai eu l’impression d’obéir à un ressort. »
Nivaria Tejera réussit parfaitement le double défi qu’elle semble s’être imposée : faire percer au travers du récit de son héroïne des bribes d’elle même adulte sans perturber la cohérence de la voix enfantine. En cela, la densité du texte est phénoménale. L’auteure nous dit certainement ce qui persiste en elle, et peut-être en nous également, si nous sommes touchés à ce point : ce rapport à la réalité non encore obstrué de démarcations, que nous n’exprimons plus car nous avons perdu la poésie de l’enfance, celle qui précède la perception catégorique du monde. Peut-être Nivaria Tejera le fait-elle même ré-exister en nous, en le nommant, ou du moins certainement, lui donne t-elle le souffle qui le ravive.
Nivaria Tejera, Le Ravin, traduction Claude Couffon, éd. La Contre-Allée, "La Sentinelle", 242 p., 18 € 50
L’auteur
Nivaria Tejera est née en 1930 dans la ville de Cienfuegos à Cuba, de mère cubaine et de père espagnol. Marquée par les thématiques du déracinement, de la dictature et de la révolte, Nivaria Tejera, qui aura traversé plusieurs fois les océans, a construit une œuvre poétique et romanesque dont l’exil et l’errance forment le motif principal. Elle passe son enfance à Tenerife, aux îles Canaries où la guerre civile surprend sa famille. Son père est emprisonné dans les geôles franquistes jusqu’en 1944. Le voyage du retour à Cuba se fera sans lui. Elle y publiera en 1948 son premier recueil de poésies Luces y piedras.
Quittant sa ville natale pour Paris en 1954, elle y revient en 59 lors de la révolution socialiste, elle sera d’abord secrétaire d’État à la culture de ce pays, puis attaché culturel à Paris, à Rome, avant de rompre définitivement avec Cuba lors de l’avènement du Parti unique en 1960. Découverte par Maurice Nadeau et Claude Couffon, c’est en 1958, qu’elle publie aux Lettres nouvelles son premier roman, Le Ravin. En 1971, elle obtient le Prix Biblioteca Breve pour Somnambule du soleil - traduit par Adélaïde Blasquez -, également paru aux Lettres nouvelles. Empreint de son exil de Cuba dans les années soixante, ce roman raconte l’errance d’un jeune mulâtre dans La Havane.
En 1987 paraîtra également Fuir la spirale (Actes Sud), traduit par Saint Lu, roman métaphysique dont le personnage en proie au dédoublement erre à travers l’espace de l’exil parisien mais surtout à travers le Temps… L’écriture de Nivaria Tejera se caractérise par le goût de l’expérimentation, le décloisonnement des genres et la radicalité politique comme forme de liberté.



