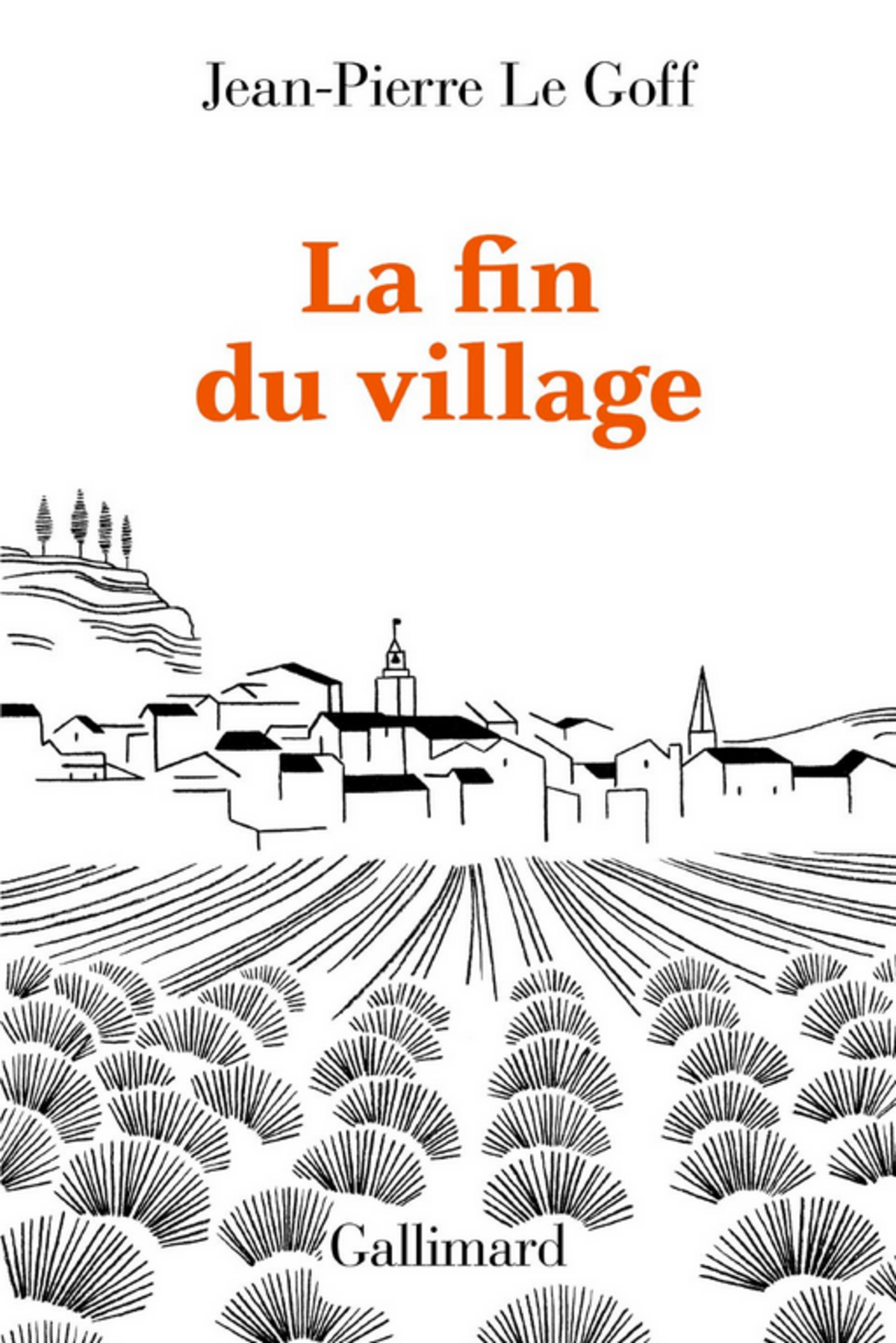
Agrandissement : Illustration 1
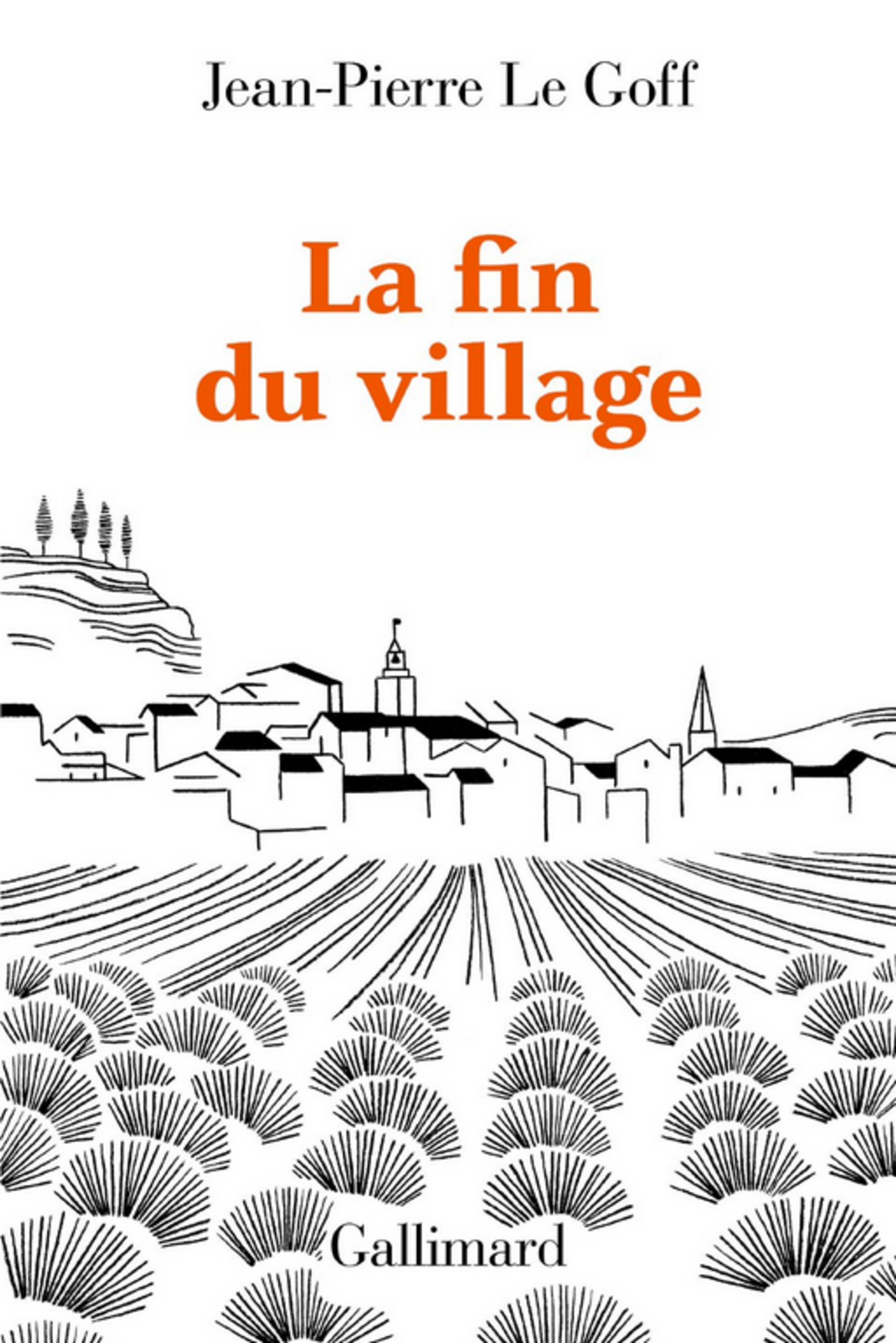
Il n’arrive pas qu’une ville disparaisse. Mais un village, oui, si ses habitants l’abandonnent pour s’installer ailleurs. Ce n’est pourtant pas le cas qu’évoque Pierre Le Goff dans le beau La Fin du village qu’il vient de publier. Cette fin, pour lui, est celle d’une forme sociale telle qu’elle survit essentiellement dans notre imaginaire mais qui, en pratique, a cessé d’être.
Pour illustrer le propos, Le Goff prend l’exemple de Cadenet, village typiquement provençal au sud du Lubéron. C’est que le sociologue a fait dans ce coin de Provence de nombreux séjours estivaux et jusqu’à transformer le site de ses vacances en objet d’étude. Cela donne aujourd’hui un bel ouvrage de 500 pages qui raconte la société de Cadenet telle qu’elle a évolué au cours d’un bon demi-siècle. Cette tranche de sociologie descriptive peut rappeler le Plodémet de Morin ou, mieux encore, le Roussillon de l’Américain Laurence Wyllie, deux villages brillamment décrits dans les années 1960.
Comme il nous est rappelé, le Cadenet ancienne manière fut jusqu’au milieu du XXe siècle un village de 2 000 habitants, tous petits paysans ou vanniers pauvres. La sociabilité y était forte autour des cafés ou de la boulangerie. Les fêtes étaient traditionnelles et la chasse au gibier du dimanche tenait lieu de sport pour les hommes. À Cadenet, par ailleurs, on était rouge depuis longtemps et, après la dernière guerre, on y vota solidement PCF. Pourtant, comme l’indique un plan des lieux, si le bourg compte sa rue Ledru-Rollin et son cours Voltaire, il n’a ni boulevard Jaurès ni avenue Lénine. C’est qu’il s’agissait alors d’un communisme villageois, soucieux de solidarité immédiate plus que de dictature du prolétariat et qui vit s’éteindre le temps des vanniers : « La cellule de Cadenet regroupait alors [en 1977] en son sein des fortes personnalités et des militants dont les origines reflétaient l’ancien et le nouveau monde : quelques agriculteurs, des petits commerçants, des techniciens, un médecin, un artiste, une intellectuelle. » (p. 191)
S’est ainsi produit le virage des années 1970, au cours duquel un nouveau village est né de l’ancien. En termes d’atmosphère, on se croirait aisément dans un roman comme L’Été meurtrier de Sébastien Japrisot qui déjà disait fort bien la coexistence de deux époques en une à l’intérieur d’un petit bourg. Ce qui accéléra le mouvement à Cadenet, ce fut moins cependant l’accès au cinéma puis à la télévision que l’arrivée au village de nouvelles catégories sociales, faisant doubler le volume de la population. Vont ainsi apparaître hippies et gauchistes qui, se tenant en périphérie, introduisent de nouvelles façons d’être. Puis viendront des citadins – avec villas et piscines – pour lesquels le village est facilement un dortoir. Suivront les immigrés, venus du Maghreb et plutôt bien intégrés, en dépit du racisme ordinaire. Ces populations vont avoir, quoi que l’on tente, du mal à fusionner, encore que l’école laïque assure le brassage. Tout cela faisant que le sociologue peut parler d’une culture bariolée qui s’est superposée à l’ancienne identité provençale et l’a fortement minorisée.
Parmi les chapitres les plus intéressants de l’ouvrage, on retiendra ceux qui évoquent une vie associative abondante qui s’est développée sur les ruines de l’ancienne convivialité. Cela va de la création d’une crèche à un club de lecture en passant par l’entretien d’un musée de la vannerie. Et c’est comme si, à travers ses cinquante associations, une communauté tentait un peu désespérément de se retrouver. Mais la tâche est rude pour les animateurs : comment créer des accords dans ce tohu-bohu d’appartenances ? Ce qui marque ainsi la « fin du village », est, par-delà un état d’esprit dont ne subsiste que la nostalgie, la coexistence de différents groupes sociaux dont les intérêts sont « normalement » divergents. Soit l’exemple de la chasse dans sa version populaire : elle postule chez ses pratiquants une liberté de circulation par routes et chemins qui ne saurait convenir aux nouveaux installés, soucieux de protéger leurs villas et piscines.
Se construit ainsi au fil des chapitres une belle analyse, toute en empathie et qui, loin des théories, collecte observations et témoignages pour les ordonner selon une intelligence vive des enjeux locaux. Si vous passez donc par Cadenet, imitez Le Goff. Une fois bu le pastis au « Bar des Boules », où l’on a toujours la galéjade facile, demandez-vous ce qui subsiste dans ce Lubéron-là d’une certaine humanité.
Jean-Pierre Le Goff, La Fin du village. Une histoire française. Paris, Gallimard, 2012. 26 €.



