Jacques Lacarrière, qui fut tour à tour homme de théâtre, journaliste, puis écrivain, est surtout connu comme spécialiste de la Grèce, pays auquel il a consacré beaucoup de son temps, de son énergie, de sa passion et la majeure partie de son œuvre. Disparu en 2005, à l’aube de ses quatre-vingts ans, il aurait été un témoin privilégié et un défenseur acharné de la Grèce et des Grecs, dans les circonstances actuelles. En août 1971, Jacques Lacarrière décida de faire en France ce qu’il avait si souvent fait en Grèce, marcher. Il partit donc à pied de Saverne, dans les Vosges, pour arriver en novembre à Leucate, dans les Corbières, en évitant soigneusement les routes, les grands axes, autant que possible, en privilégiant les chemins, les sentiers, les sentes et les layons, et en dormant tantôt chez l’habitant accueillant, tantôt à la belle étoile, tantôt dans des granges ou des auberges de fortune. Cette aventure singulière devint un livre, publié en 1974, aux éditions Fayard, sous le titre Chemin Faisant, mille kilomètres à pied à travers la France d’aujourd’hui, ré-édité en 1997 avec une post-face intitulée La mémoire des routes, compilation des échanges épistolaires faits entretemps entre l’auteur et les lecteurs assidus. Ce même ouvrage a été ré-édité en 2014, toujours chez Fayard.
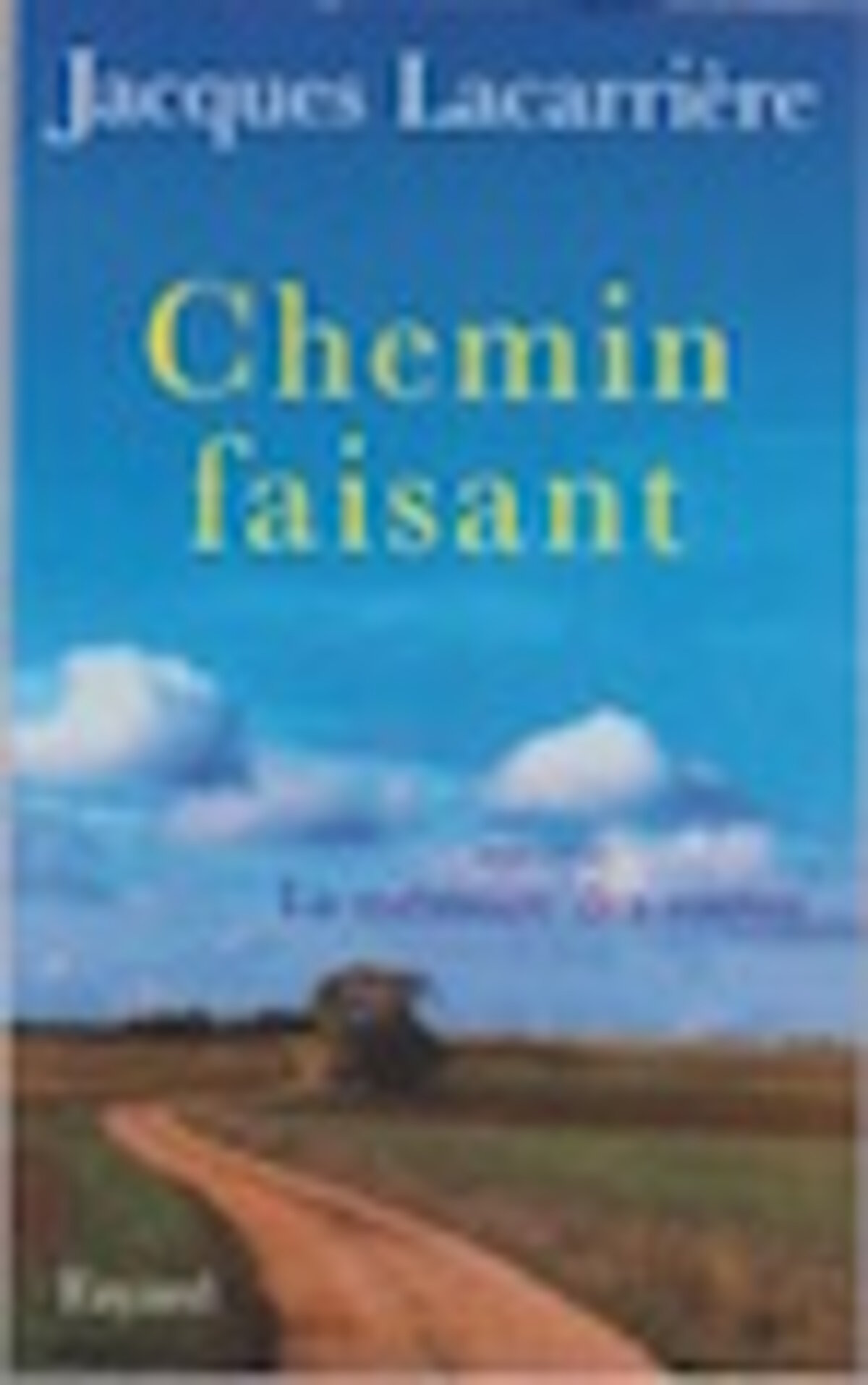
Après avoir lu, relu maintes fois — et relu encore en cet été 2015 — on est tenté non seulement de conseiller vivement à qui ne connaît pas Chemin Faisant sa lecture dans les meilleurs délais, mais aussi de le classer dans la catégorie des chefs-d’œuvre atypiques. Parti, comme il l’indique dans sa première préface, avec un bagage léger, le marcheur-écrivain explique : (1974 : III) … j’ai allégé mon sac à dos de tout ce qui m’est apparu inutile. J’ai donc éliminé la tente, trop lourde à porter, pour ne garder qu’un sac de couchage, suffisant pour les nuits sans pluie et les granges des fermes. Le reste ? Quelques vêtements de rechange, un peu de pharmacie, une torche électrique, un couteau, des provisions succinctes, un gros carnet de notes, des cartes d’état-major et une bouteille plate de whisky que par la suite j’emplis consciencieusement de rhum à chaque étape. On n’oubliera pas, dans cet inventaire insolite, l’imperméable acheté à Paris sous l’étiquette « dernier cri », expression désuète et décalée sur laquelle Lacarrière va ironiser tout au long de son chemin. Le but de l’écrivain était simple, voir, écouter les gens, les animaux et scruter les paysages. Le résultat est une merveille de fraternité, d’observations déroulées à travers un style magnifique — le talent de Jacques Lacarrière est connu et reconnu depuis fort longtemps — et des phrases ciselées et savoureuses qui conduisent à donner à cet ouvrage une place de choix dans une bibliothèque personnelle.
Entre autres exemples de son style, sa nuit passée dans une jasserie, dans la Haut Forez, à Pierre-sur-Haute, près d’Ambert, qui n’a rien d’une partie de plaisir mais qui est décrite avec un humour décapant : (1974 : 124) Je suis allongé dans le grenier à foin, au-dessus de l’étable, tassé dans les herbes sèches. Par les fentes du plancher, montent le bruit des vaches ruminant, les niagaras de leurs urines, le plouf étouffé de leurs bouses et une odeur suffocante de purin. Toujours enthousiaste et chaleureux, Lacarrière ne sombre pas dans l’angélisme et avertit ses disciples potentiels : (1974 : 120) Quiconque envisage une marche à pied à travers la France (ailleurs que sur des sommets dénudés, des forêts impénétrables ou des déserts perdus) doit savoir que son problème n° un ne sera ni la faim, ni la soif, ni la fatigue, ni les entorses, ni les marécages, ni les récifs à marée haute, ni la mort par épuisement dans les forêts, mais LES CHIENS. On n’imagine pas le nombre de chiens qu’il peut y avoir en France. Cette opinion ne sera nullement atténuée au fil des kilomètres, au point que Lacarrière va rapidement s’équiper d’un solide bâton. D’autant que, dans sa traversée du Massif Central, sera évoquée la présence de loups, sujet tabou, et cette pérégrination — vocable approprié puisque pour l’auteur le pays natal lui demeurait étranger — date de quarante-quatre ans !
Le regard que Lacarrière pose sur la nature, sur les gens et sur les choses est tour à tour tendre et corrosif, comme l’est ce jugement hautement jubilatoire et sans appel sur les petits hôtels de province (à propos desquels il n’est pas sûr qu’il y ait eu une évolution majeure depuis 1971) : (1974 : 16) Qui dira, chantera, psalmodiera jamais l’ennui des petits hôtels-pensions de province ? Petits hôtels avec leurs odeurs de chats incontinents, de poussière, d’encaustique rancie, de bouillon dix fois réchauffé, de poules au pot néolithiques. Avec leur lits en fer aux ressorts épuisés et maussades grinçant au moindre geste, leurs lavabos où l’eau chaude ne fonctionne jamais, où l’eau froide geint à travers des canalisations atteintes d’une artériosclérose irrémédiable. Lacarrière constate, dépeint, décrit l’inexorable ennui d’adolescents et d’adultes jeunes et moins jeunes. En 1971, il n’y avait ni tablettes, ni portables, mais le triste café du village avec son incontournable « flipper », catalyseur du mal de vivre ou de la difficulté d’être. Au cours de son passage à Sacy, dans l’Yonne, son village d’adoption et celui de ses ancêtres, Lacarrière rend hommage à un natif célèbre de ce même village, Rétif de la Bretonne, dont il rapporte une conversation à la fois réaliste (et lugubre pour quiconque arrive dans cette tranche d’âge…) avec un vieillard : (1974 : 70) Quelle chance vous avez, père Brasdargent, d’avoir vu tant de choses et de vous en souvenir ! … Mon enfant n’envie pas mon sort ni ma vieillesse. Il y a quarante ans que j’ai perdu le dernier des amis de mon enfance et que je suis comme un étranger au sein de ma patrie et de ma famille : mes petits-enfants me considèrent comme un homme de l’autre monde.
Partout où il passe, Jacques Lacarrière réfléchit sur ses semblables, sur l’origine des noms de lieux traversés, sur l’histoire. C’est une fresque magnifique, non dénuée de constatations amères, les graffitis racistes, le régionalisme, la frénésie de la chasse qui, dans la partie sud du pays, pousse à tirer sur tout ce qui vole ou tout ce qui va sur quatre pattes. Dans la post-face de 1997, un lecteur, marcheur lui aussi, regrette que, parmi tous les bruits de la nature qu’il a relatés avec son immense talent, il ait oublié de parler de la « plainte de l’animal esclave », une autre lectrice le gronde gentiment de façon rétrospective d’avoir, en novembre, emprunté des chemins (qu’elle connaît de toute évidence) dangereux parce qu’enneigés. Voilà résumé le sel de ce livre inclassable malgré tout, les liens souvent très forts, notamment dans des hameaux inaccessibles, créés avec les gens rencontrés et devenus des amis. Ne serait-ce que pour cela il faut s’aventurer dans Chemin Faisant, une aventure fraternelle et bucolique, qui n’a pris aucune ride.
La biographie de Jacques Lacarrière, ici, et un site d’adeptes intitulé Chemin Faisant.
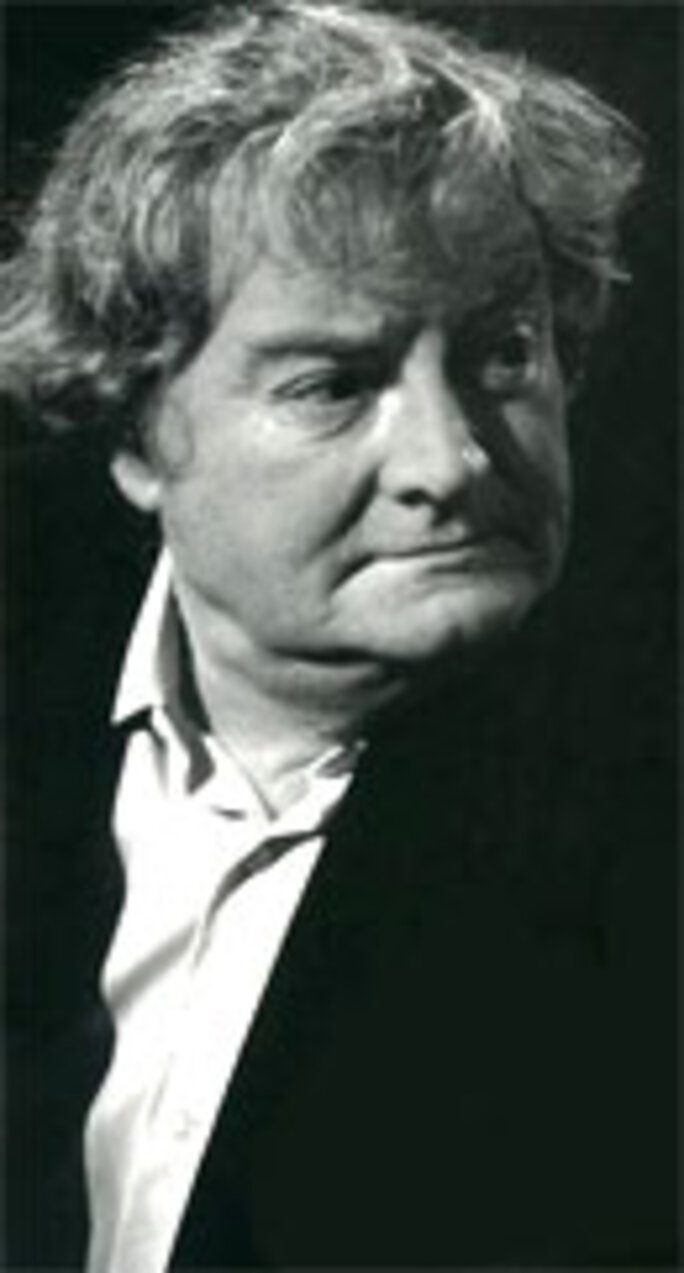
Jacques Lacarrière, Chemin Faisant, mille kilomètres à pied à travers la France d’aujourd’hui, éditons Fayard, 1974, ré-édité en 1997 et 2014. 20,30€. ISBN 978 2 213 00433 4.



