
Agrandissement : Illustration 1

Un livre sur Versailles (parc et château), voilà qui laisse craindre un commentaire convenu avec célébration pieuse de l’esthétique du Grand Siècle. Mais pas du tout. Son auteur, Michel Jeanneret, professeur de littérature, y choisit de regarder les choses – et en particulier la somptueuse décoration du parc – en rupture des idées reçues et comme par en dessous.
Commençant par relater la genèse d’un site extraordinaire voulu par un monarque qui se voulait Roi-Soleil, Jeanneret met à mal l’idée selon laquelle cette figuration mégalomane de soi serait sans faille et toute vouée à la raison et à l’harmonie. En fait, pour lui, Versailles est surtout un énorme dispositif à travers lequel un régime ne cesse d’exprimer son angoisse face aux forces diverses qui le menacent – la nature et sa sauvagerie, un cosmos mythologique nourri de fantasmes, de grossières classes d’en bas désignées par le biais, enfin divers ennemis du pouvoir dont la Fronde. Certes, château, parcs ou fêtes, Versailles ne cesse de dire que ces forces sont désormais domptées. Mais les périls n’en sont pas moins tenus pour redoutables et, pour nous, les occulter sous une représentation trop unie de l’esthétique classique revient à terriblement affadir le message.
Pour s’en convaincre, il n’est que d’évoquer tel bassin du parc où l’on voit le géant Encelade tenter de s’extraire avec fureur de la lave et des rochers. Ou encore tel autre figurant les convulsions mortelles d’un serpent Python frappé par Apollon dont Louis se voulait l’égal. Et, dit Jeanneret, c’est partout ou presque « la même célébration incantatoire du héros salvateur qui, fût-il absent de la représentation, dompte les fauves et anéantit les barbares » (p. 54). Mais les barbares vraiment, ou, de façon plus immédiate, les partisans de la Fronde qui viennent d’être vaincus ? Car une lecture politique de Versailles est possible, où les prestigieux éléments de décoration pointent vers les ennemis du roi, intérieurs et extérieurs. C’est la lecture à laquelle Jeanneret se livre à bon droit, sans trop appuyer cependant
Plus largement, pour l’auteur, toutes les mises en scène du monde naturel à l’intérieur du vaste domaine vont dans le sens d’un danger maîtrisé mais qui continue à faire peur, danger lisible même dans tel « style rocaille » quelque peu kitsch ou dans la surabondance d’eaux jaillissantes traduisant un cosmique débridé. Versailles s’est bel et bien voulu recréation du monde mais une recréation volontiers convulsive.

Agrandissement : Illustration 2

Or, les thématiques et les styles mis en œuvre se retrouvent, comme le montre l’auteur dans sa deuxième partie, au sein des spectacles donnés par le roi dans un domaine alors tout neuf. Fêtes avec feux d’artifice, comédies-ballets, ballets de cour et opéras, tous visaient à célébrer la splendeur d’un règne. Mais, là encore, les forces néfastes étaient prises en compte et, par exemple, d’une façon qui demeure étonnante, dans les pièces commandées à Molière, dont celles qui tournent autour d’êtres stupides comme Georges Dandin ou répugnants comme Monsieur de Pourceaugnac. Horreur sociale cette fois mais qui, tout comme l’autre, est dépassée par la qualité même du spectacle.
Enfin la littérature occupe dans le volume une place inattendue et qui nous éloigne en apparence de Versailles. Mais, si l’on change de registre, l’esprit n’en demeure pas moins. Car, passés en revue brillamment, les grands auteurs du siècle convoquent un être humain relié à des forces inquiétantes. Et ce sera par exemple cet « homme bestial », qui est partout dans les lettres du temps, depuis les fables de La Fontaine jusqu’aux contes de Charles Perrault en passant par les mémoires féroces d’un comte de Saint-Simon ou, hors littérature, par les superbes planches physiognomoniques de Le Brun qui démarquent des visages humains en espèces animales. Autre aspect « haïssable » de ce même être, celle qui l’enferme dans le culte intéressé de son moi que dénoncent Pascal comme La Rochefoucauld. Bestialité, vanité de soi : les moralistes classiques ont dénoncé là une autre forme de vilenie qui rejoint sans trop de peine les forces troubles du grand parc.
« L’art classique, pourra conclure l’auteur, ne se contente pas de rendre à l’ombre sa place au soleil. […] S’il arbore la beauté, l’ordre, la mesure, c’est pour se mesurer à leur contraire » (p. 328). C’est ce que nous dit autrement encore dans le volume une illustration magnifique qui en fait un véritable album. Versailles y est dans sa splendeur et, si l’on y regarde, dans sa violence mal assourdie.
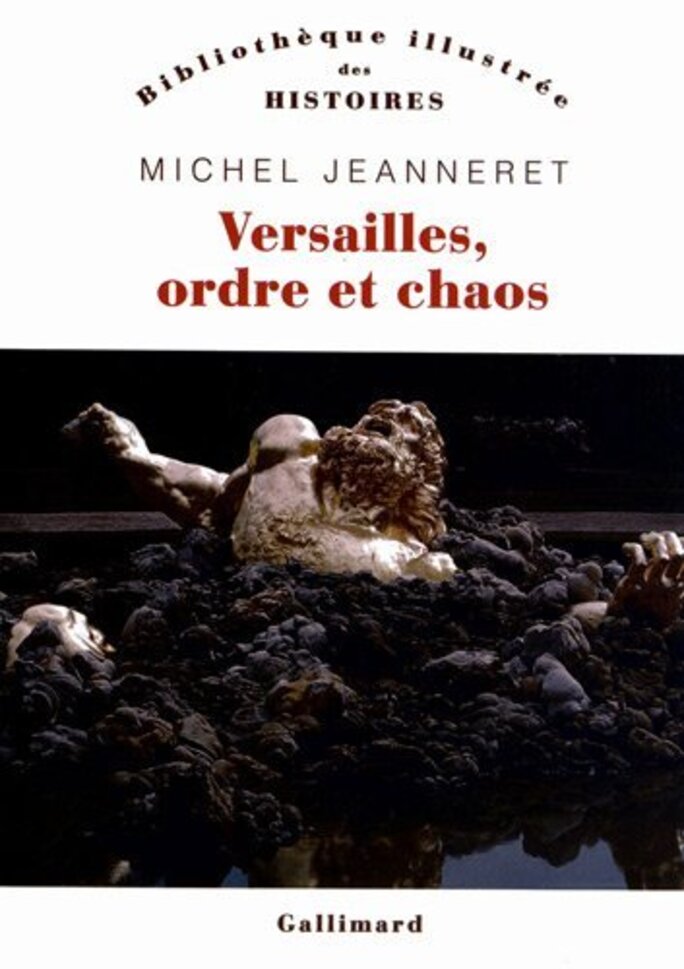
Pierre Jeanneret, Versailles, ordre et chaos, Paris, Gallimard, « Bibliothèque illustrée des Histoires », 2012. € 38. P. Jeanneret réédite parallèlement Les Fêtes de Versailles d’André Félibien, deux récits parus en 1668 et 1674 (Gallimard, « Le Cabinet des lettrés », avec des gravures d’époque, 2012, € 17 ,90).



