Deux polars crépusculaires, le Berlin de la république de Weimar, le Breslau 1927 qui n'était alors pas du tout Wroclaw. L'un initialement historien, l'autre latiniste, l'allemand Volker Kuscher et le polonais Marek Krajewski, en deux solides trilogies, sacrifient bien aux rituels du genre, mais invitent d'abord à la plongée dans des villes obscures, audacieuses et confites à la fois, guettées par le chaos, menacées et menaçantes, à hauteur des années 30.

En termes de roman policier, tous deux sont presque classiques. Ils centrent leurs récits autour d'un enquêteur criminel atypique en butte à une hiérarchie heureusement coiffée d'une figure de père, intuitif évidemment, empêtré dans une vie personnelle complexe, comme d'usage. On trouvera aussi dans leurs livres le désormais inévitable serial killer, version industrielle de l'assassin (même si en fait, en ces années trente, les qualificatifs de « Monstre » et autres « Vampires » soulignaient davantage l'exception que la quantité). Le meurtre de masse était pour un peu plus tard...
« Je me suis toujours demandé comment l'histoire, qui a posteriori nous semble écrite à l'avance, est perçue par ceux qui la vivent », dit Volker Kutscher. Et c'est bien une des lignes fortes de son livre. On s'affaire, sans trop accorder d'attention à ce qui aujourd'hui est retenu.
Dans les rues, communistes et nazis s'affrontent, sur fond d'indifférence, et lorsqu'un nazi est assassiné, l'enquête ennuie tout le monde, à vrai dire... Entre repli identitaire, napperons de dentelle et cabarets « décadents », ébullition artistique et aspiration à l'autorité, c'est la crise, les pauvres survivent, les plus riches prospèrent, on râle contre les juifs presque mécaniquement (ou un peu moins mécaniquement, pour quelques uns, dont on pressent qu'ils ne seront pas de farouches opposants trois ans plus tard), on se passionne pour la modernité, on escalade la Tour hertzienne, réplique radiophonique de l'Eiffel parisienne. Et on en tombe parfois.
Gereon Rath, enquêteur de la brigade criminelle berlinoise, est un homme qui a fauté, ce que l'on nommerait aujourd'hui une bavure. Natif de Cologne, le voici donc dans cette ville qui n'est pas sienne, mais bien celle de Döblin, où aflleure la trépidation de Berlin Alexanderplatz.

Agrandissement : Illustration 2

Laissant les affrontements politiques en rumeur de fond, Volker Kuscher explore dans La mort muette le cinéma à l'instant où celui-ci devient parlant. On s'empoigne entre tenants du muet - un art, pas mal de chefs d'oeuvre - et passionnés du dialogue, du « vrai », balbutiement d'une industrie. Qu'un projecteur fort bien accroché tombe sur la tête d'une superbe actrice au moment où celle-ci amorce une conversion professionnelle réussie en tournant dans les studios de Babelsberg, qu'on retrouve des corps savamment disposés dans des salles de « muet » qui viennent de faire faillite surprend finalement moins que d'apprendre qu'on tournait alors simultanément, sur le Tonkreuz, les films en trois langues différentes avec acteurs et prises de vues différents, afin d'exporter ... L'historien, précis mais léger, s'amuse, et Gereon Rath va donc écumer quelques clubs de rencontres avec échanges de messages (par porteur...) , les épiceries chinoises de la ville, ne guère s'intéresser à la cocaïne distribuée ici et là, descendre des bières sur l' « Alex », et, bien sûr clore son affaire, mais pas le cours de l'Histoire ...« Une aubaine pour la littérature contemporaine allemande qui souffre souvent d'une étrange amnésie », comme l'écrit le Buchjournal (qui exagère un peu). La mort muette se déroule en 1930 : le dernier tome de la trilogie (à paraître) n'évitera sans doute pas la fin de la République de Weimar et l'arrivée d'Hitler au pouvoir...

Agrandissement : Illustration 3

Eberhard Mock, le flic de Marek Krajewski, va mal. Il boit souvent et beaucoup, mais son ivresse est inexistante, se résume au constat du désastre, après. Il pue l'alcool lorsqu'il veut expliquer une théorie à ses collègues, est épris de sa très belle femme Sophie, mais ne sait aimer.
Il est somme toute bien adapté à sa ville, dont il fréquente assidûment les bas-fonds. Breslau, ville allemande en 1927 : les bords de l'Oder sont plus baroques que ceux de la Spree, traversés d'Europe centrale, ironie et clair-obscur, mais on y respire mal. La misère dans sa brutalité s'y expose, entre meubles cirés des demeures bourgeoises et nourritures roboratives - lard grillé tartiné de raifort ou grattons, mises en bouche arrosées de schnaps à toute heure dans des brasseries peu aérées - les perversions s'y épanouissent, les filles perdues meurent vite, le glissement des patins en hiver, les illuminations de Noël n'apaisent rien. Si les femmes sont belles, elles sont aussi très en chair, une chair menacée, bleutée à la Rubens.
Comment Marek Krajewski, éminent latiniste - de belles citations émaillent d'ailleurs ses livres, qui ne réjouiront pas seulement les habitués du Gaffiot - s'est-il attelé, en trois livres, à ce Breslau complètement allemand, lui qui est né et a grandi dans Wroclaw, devenue tout à fait polonaise en 1945 ? Peut-être entre autres (on peut lire sur le sujet l'intéressant article de Brigitte Patzöld dans Le Monde diplomatique) parce que justement, né en 1966, il a grandi dans une ville où l'histoire officielle, en un raccourci saisissant, évacuait quelques siècles de germanisation. Surement aussi parce qu'à l'heure actuelle un enseignant en fac aguerri ne perçoit même pas le salaire polonais moyen...
Eberhard Mock relève donc, car c'est inhabituel, qu'ici ou là quelqu'un parle polonais... Ici aussi, lorsqu'un ouvrier membre du parti nazi est assassiné, c'est anecdotique. On s'intéresse davantage à un prédicateur russe qui annonce la fin du monde, sans s'apercevoir qu'il s'agit de la fin d'un monde. Derrière les meurtres sans lien apparent, sinon une page de calendrier, un double compte à rebours commence. C'est dans le passé le plus enfoui de la ville, véritable héroïne de Krajewski, que gît l'énigme, et c'est dans l'histoire en marche que gît l'avenir, le tout habité par une certaine touffeur...

Agrandissement : Illustration 4

Et, détail amusant, comme si ces deux écrivains natifs des années soixante et hantés par le passé proche correspondaient outre-frontière, l'un des personnages de La fin du monde à Breslau se tourne vers Berlin et le cinéma, y arrivant précisément pour les débuts du parlant...
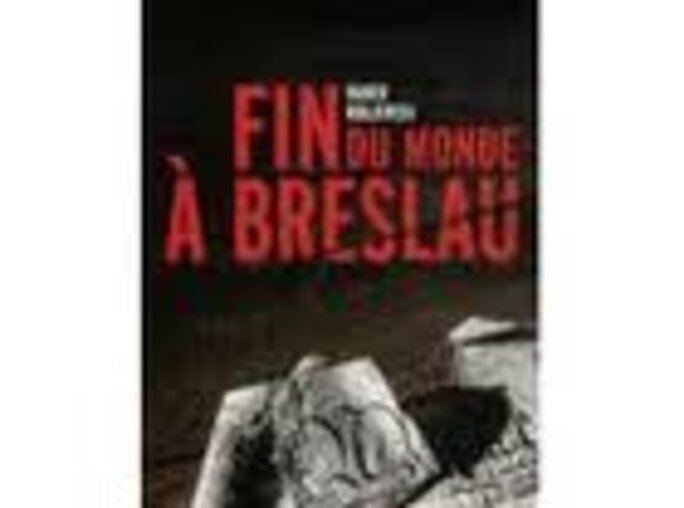
Fin du monde à Breslau, de Marek Krajewski, traduit du polonais par Charles Zaremba, 304 pages, Série noire Gallimard, 21 €.
Titres précédents :
Les fantômes de Breslau, traduit du polonais par Margot Carlier, 352 pages, folio policier, 6,46 €.
La peste à Breslau, traduit du polonais par Margot Carlier et Maryla Laurent, 258 pages, 18,90€.

La mort muette, de Volker Kutscher, traduit de l'allemand par Magali Giraud, 670 pages, Le Seuil, 22 €.
Titre précédent :
Le poisson mouillé, de Volker Kutscher, traduit de l'allemand par Magali Girault, 659 pages, Points Seuil, 8,20 €.
A l'exception de la photo tirée du film muet de Wilhem Prager, Voies vers la force et la beauté, toutes les photos illustrant l'article sont extraites du site consacré à Gereon Rath et issues des Bundesarchiv.



