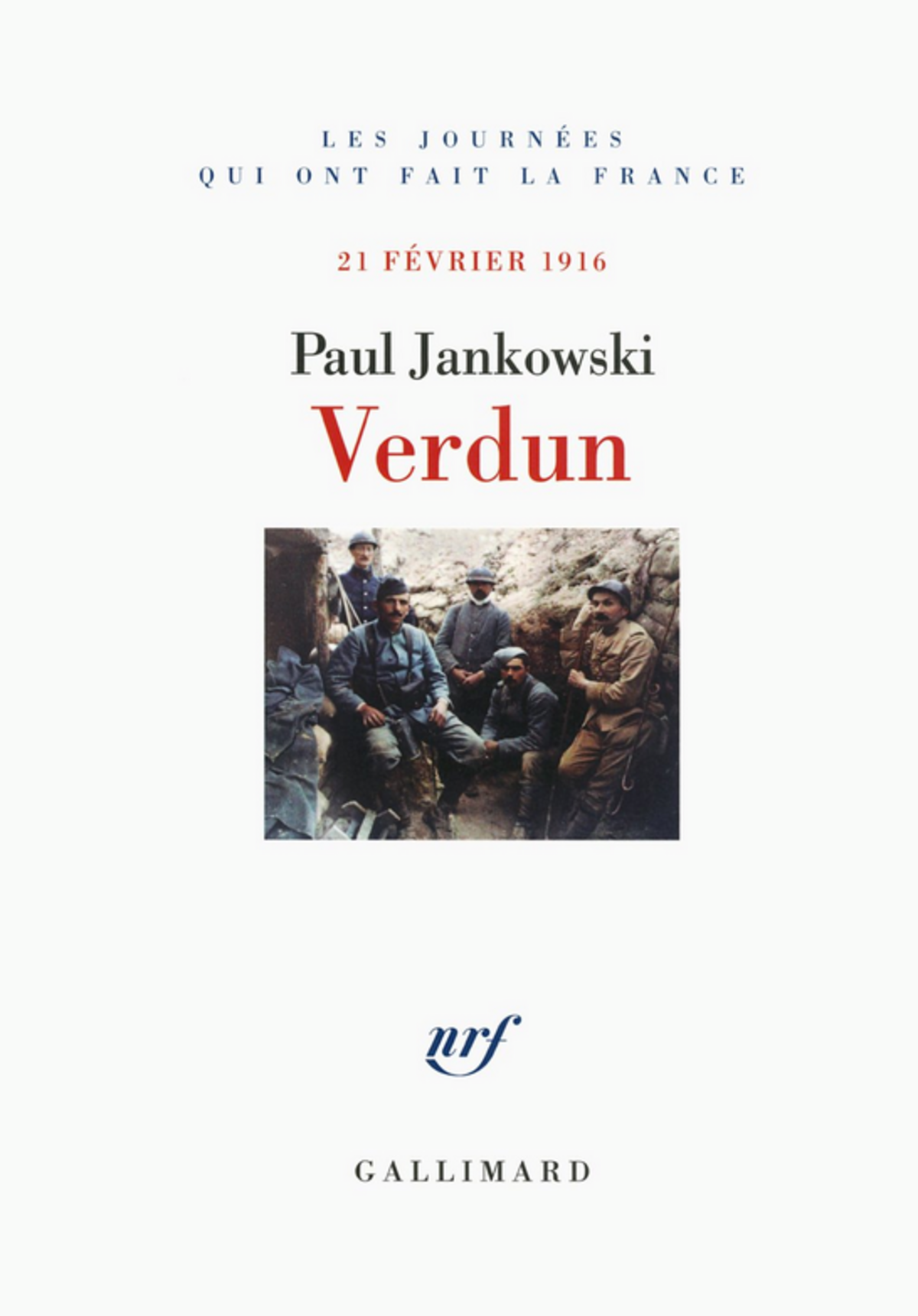
Agrandissement : Illustration 1

Voici que s’annonce le centenaire de la Grande Guerre et c’est déjà la déferlante en librairie. Ouvrages et livraisons se multiplient et balisent par avance les commémorations qui vont se succéder. Du lot, nous tirerons le Verdun de Paul Jankowski, qui paraît dans la collection « Les journées qui ont fait la France ». Professeur à Brandeis University, l’auteur appartient à cette école américaine qui a donné d’excellents historiens des réalités françaises.
Le Verdun de 1916 fut l’une des plus effroyables batailles de tous les temps, dans les faits comme dans la mémoire humaine. Elle dura près d’un an et fut avant tout une guerre de position. Entendons par là que le terrain conquis par une des armées était aussitôt repris par l’autre et qu’au total personne ne remporta la victoire, si ce n’est que l’héroïque résistance des « poilus » face aux « Boches » agresseurs fit des premiers les vainqueurs moraux de la longue tuerie. Mais en pratique, ce fut un match nul et notamment en pertes humaines. À cet égard, Jankowski s’interroge à bon droit sur la réalité de ce qu’on a pu appeler la guerre d’attrition, correspondant à la volonté de Falkenhayn, chef suprême de l’armée allemande, de « saigner à blanc » l’armée française à Verdun et d’atteindre par là le moral de toute une nation.
En fait, si Falkenhayn invoqua cette explication dans ses mémoires, elle n’en est pas moins sujette à caution. Car pourquoi avoir choisi Verdun alors que ce n’était ni un point névralgique ni un lieu symbolique ? Reims, par exemple, aurait bien mieux fait l’affaire. Par ailleurs, si l’objectif était bien l’Ausblutung (la saignée !), pourquoi n’avoir pas jeté plus de forces dans la bataille ? Pour l’historien américain, tant dans l’offensive vigoureuse que dans la défense acharnée, il y eut toute une part de choix arbitraire comme d’indécision. Et c’est un peu comme si c’était venu comme ça, les deux armées s’enferrant d’emblée dans une confrontation sans issue. « Conçue par les Allemands comme un simple préliminaire, admise par les Français (à leur corps défendant) comme une action subsidiaire, la bataille de Verdun devint l’emblème de la froide insensibilité d’un camp et du courageux dévouement de l’autre. » (p. 93)
Absurdité de cette bataille par conséquent. Il n’empêche, une légende a pris forme à Verdun dans cette lutte qui parut sans fin aux combattants et à l’opinion. Et, par son aura terrifiante, Verdun a éclipsé les autres grands affrontements de 14-18 (la Marne, Ypres, la Somme). Tout contribua à construire puis à enfler ce mythe : la soudaine attaque allemande soutenue par l’effroyable tir d’artillerie, la chute des forts qui fut aussi brutale que temporaire, la stagnation du front autour et, plus que tout peut-être, le fait que, prenant la résistance en main après Nivelle, Philippe Pétain fut celui qui sut organiser la guerre défensive, mettant en œuvre le « Verdun, on ne passe pas » dont parlait la chanson.
Mais la légende de Verdun fut plus encore la cristallisation la plus manifeste d’une haine réciproque de deux peuples, haine longuement entretenue et que le pacifisme d’un Jaurès n’avait su désarmer. Sous cette haine double, il y avait le sentiment, côté français, d’être en présence d’une armée méthodique dans sa cruauté et, côté allemand, d’être face aux soldats d’une nation superficielle et inconséquente. Toutefois, s’appuyant sur les lettres de soldats des deux camps, Jankowski montre que la détestation mutuelle n’allait pas sans d’autres sentiments. Pourquoi cette lutte sans fin, se demandaient beaucoup de combattants ? Et pourquoi la guerre tout simplement ? Et pourtant, dans les deux beaux chapitres que l’historien consacre à l’opposition interne d’hommes de troupe souvent mal nourris et mal traités, il doit bien observer que les cas de désertion ou de mutinerie furent finalement peu nombreux de part et d’autre.
Pour Jankowski, trois grands phénomènes ont fait de l’illustre bataille ce qu’elle fut. C’est d’abord que Falkenhayn est tombé dans le piège de l’offensive et, partant, de la guerre de mouvement. Il fut tout près de prendre Verdun mais les poches de résistance françaises tinrent bon, usant d’un matériel qui industrialisait la guerre. C’est ensuite que, du premier ministre Poincaré jusqu'au dernier poilu en passant par Nivelle ou Pétain, Verdun fut rapidement une bataille pour la gloire. « Au nom du prestige, les Français refusèrent de céder le moindre pouce de terrain après la dernière semaine de février. » (p. 145). C’est enfin que Verdun fut une bataille d’usure transformée en cauchemar. Comment tenaient ces pauvres militaires souvent mal nourris et enlisés dans la boue ? Jouait sans nul doute la fierté patriotique mais, note finement l’auteur, une fierté consolidée, dans la détresse des tranchées, par les solidarités de classe qui se constituaient en rupture des hiérarchies militaires ou à travers elles.
Occupant une position élevée dans l’échelle de l’absurdité, Verdun fut un événement unique. Elle servit par la suite à célébrer de part et d’autre l’unité nationale. Puis elle servit à prôner l’Europe et l’union des nations. Il reste bien difficile néanmoins de circonscrire sa portée symbolique, sauf à dire que ce grand carnage n’avait que très peu de sens.
Paul Jankowski, 21 février 1916. Verdun, Paris, Gallimard, « Les Journées qui ont fait la France », 2013. € 25.



