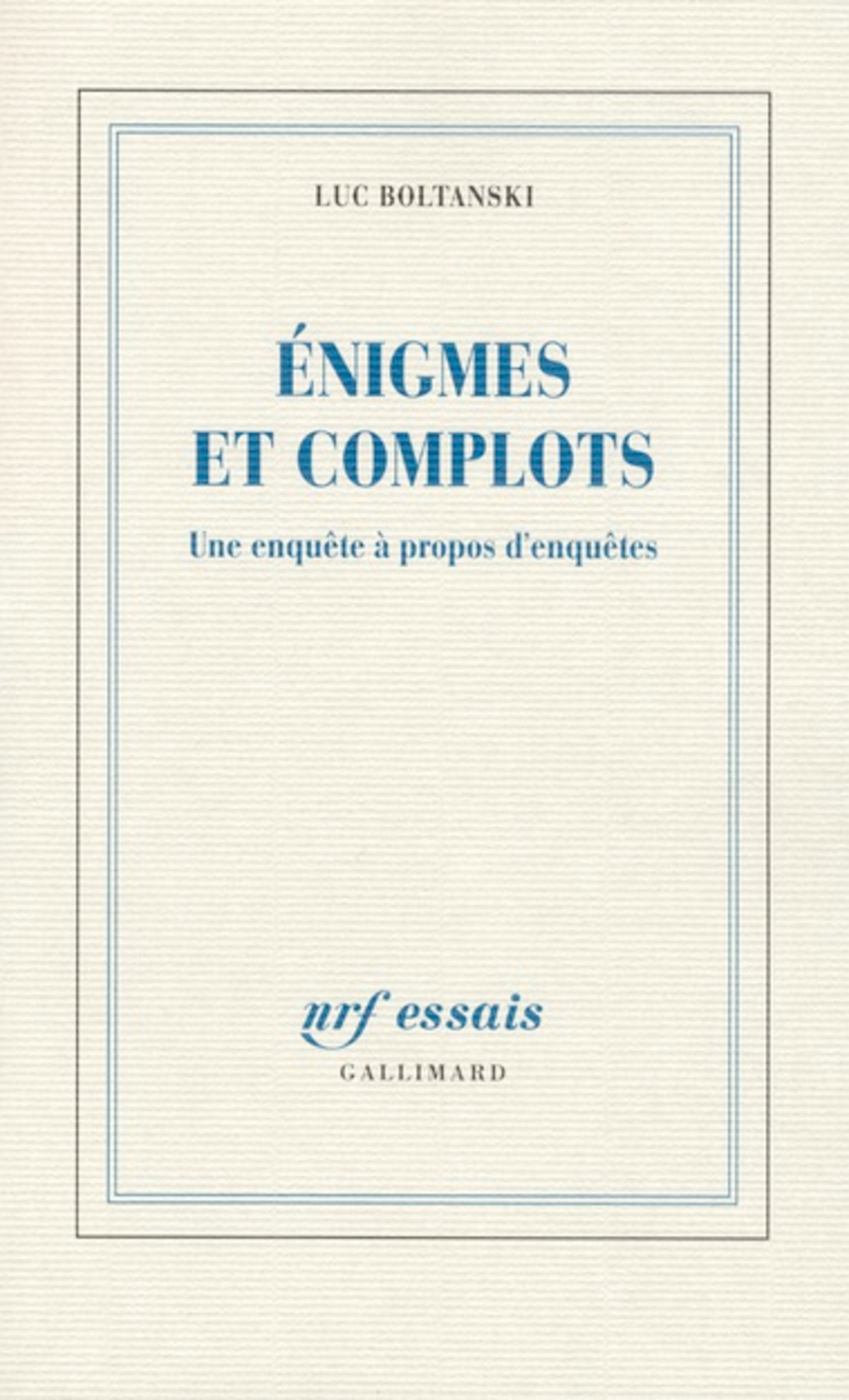
Agrandissement : Illustration 1
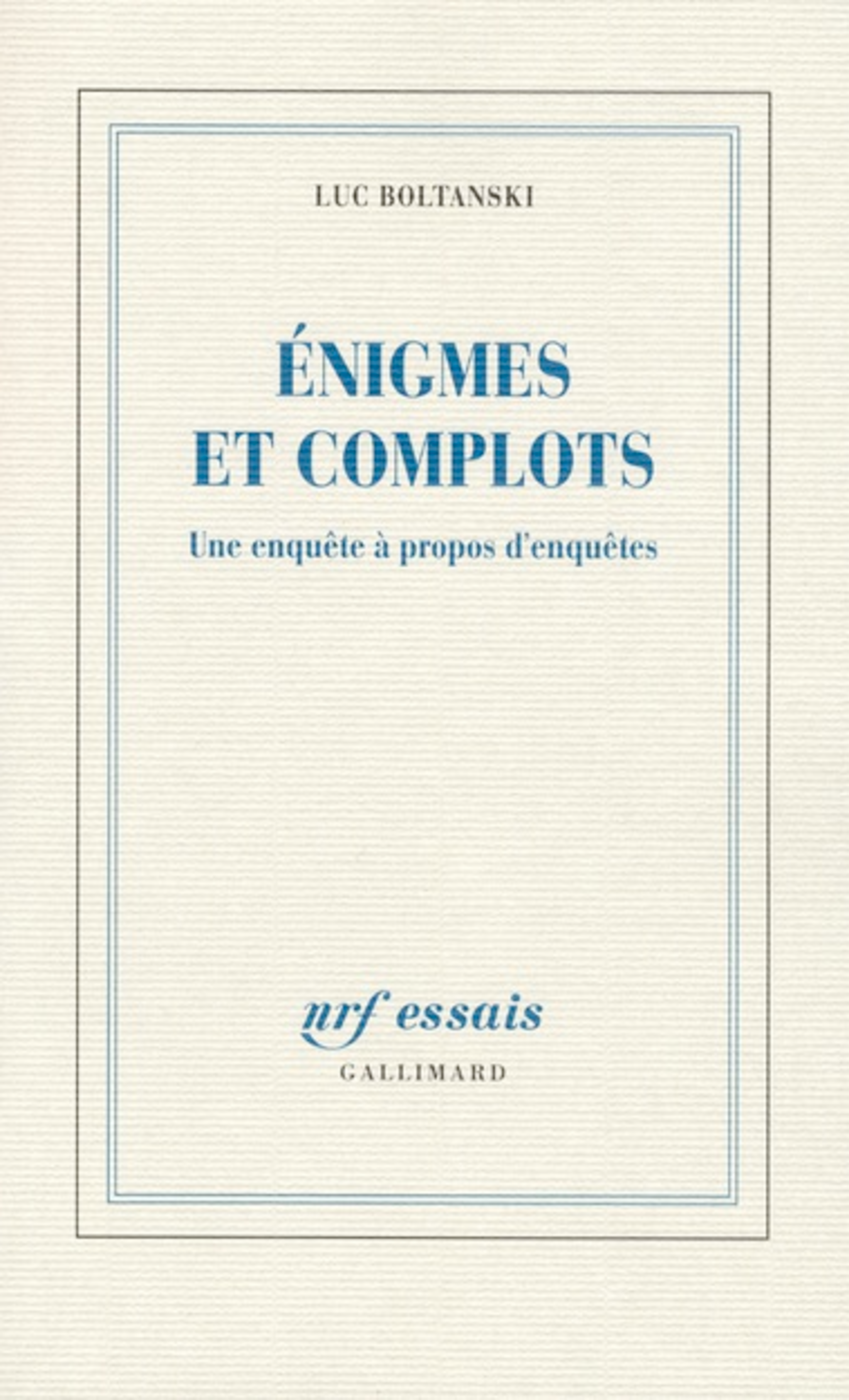
En 1989, dans Mythes, emblèmes, traces, l’historien italien Carlo Ginzburg se risquait à un rapprochement étonnant entre psychanalyse et roman policier, nés tous deux au tournant des XIXe et XXe siècles. De concert, montrait-il, Sigmund Freud et Conan Doyle avaient ouvert à un nouveau paradigme, indexé sur toute forme de trace: le lapsus d’un côté, l’indice de l’autre s’y révélaient, façon indirecte mais judicieuse d’atteindre au sens ou à la vérité. Le sociologue Luc Boltanski reprend la question dans son passionnant Énigmes et complots, récemment paru.
Se trouvent cette fois mis en rapport étroit pour la même époque le roman policier et le roman d’investigation, la paranoïa alors nouvellement identifiée, la théorie du complot en politique et enfin la sociologie elle-même et ses méthodes d’enquête. Incluant un aspect indiciel, cet autre paradigme serait de l’ordre d’un doute, d’une suspicion valant comme principe d’investigation –pour le meilleur et pour le pire en quelque sorte. Ce qui revient à dire qu’en maints domaines, notre époque depuis un bon siècle s’illustre par une recherche de l’explication qui ne fait plus confiance à cette réalité de surface qu’est la réalité «officielle» mais va chercher l’explication dans des causalités masquées ou refoulées. Et voilà qui donne quatre types d’enquêtes que Boltanski passe en revue avec un grand luxe d’arguments et d’exemples. Ce sera donc l’enquête fictionnelle du récit policier et du roman d’espionnage, l’enquête journalistique à laquelle l’ouvrage s’attarde peu, les investigations suspicieuses de type paranoïde et enfin l’enquête sociologique sur laquelle Luc Boltanski ne semble pas entretenir trop d’illusions.
Mais la sociologie de Boltanski n’en demeure pas moins conquérante, et surtout lorsqu’elle se tourne vers des fictions littéraires. Ainsi de la superbe comparaison que mène l’auteur entre ces deux grandes figures du roman d’énigme que furent et que demeurent Sherlock Holmes et le commissaire Maigret. Ce sont deux sociétés bien différentes qui se parlent à travers ces «héros». Dans une Angleterre encore victorienne, Holmes serait ainsi par excellence le détective indépendant chargé de protéger la vie privée de familles respectables; ce ne sont pas tant leurs domestiques que celles-ci ont à craindre (car, dans les romans de Doyle comme chez Proust, on ne sort guère du cercle maîtres et domestiques) que des intrusions plus ou moins extérieures (la jeune femme déclassée engagée comme gouvernante) telles qu’elles menacent l’ordre régnant. Or, le policier d’État n’a pas le tact requis pour régler de telles affaires. Seul le «privé» façon Holmes fait preuve de la délicatesse voulue et protège à souhait la hiérarchie sociale. Du côté français, en revanche, le policier sera bien autre et d’abord parce qu’il est fonctionnaire. Ainsi du brave Maigret, qui n’a pas à protéger une élite mais à veiller à la normalisation en douce de milieux divers en débusquant anomalies et infractions. En fait, le commissaire cumule les deux rôles que sépare le roman anglais: il agit en fonctionnaire mais le fait avec une humanité bonhomme qui est celle de la petite bourgeoisie dont il provient. «C’est dans la mesure où il incarne de façon paradigmatique la double identité de l’être administratif français, c’est-à-dire qu’il est, sous un certain rapport un fonctionnaire discipliné et, sous un autre rapport, tout bonnement un brave homme […] que Maigret est qualifié pour mener des enquêtes de terrain» (p. 139) La belle analyse que fait Boltanski du héros de Simenon me semble toutefois dérailler lorsqu’elle fait de ce dernier un homme de droite mâtiné de sadisme. Premier héros du récit d’enquête à rapporter à la société la culpabilité de l’individu –et démocrate en cela–, Jules Maigret méritait plus d’égards.
Autre chapitre passionnant, celui que Boltanski consacre à «l’interminable enquête des paranoïaques». Très tôt, la paranoïa, rappelle-t-il, a été identifiée à une maladie mentale de caractère social. L'auteru rappelle la contribution décisive de Max Scheler à la connaissance de «l’homme du ressentiment». Et ceci désigne notamment, dans nos sociétés, des intellectuels qui, n’ayant pas obtenu la place convoitée, développent une suspicion obsessionnelle qui vire facilement au nihilisme. C’est là le terrain où naissent les théories du complot, comme on les voit fleurir aujourd’hui encore aux États-Unis, en France ou ailleurs.
En revanche, une certaine forme de soupçon est professionnellement utile si l’on est juge d’instruction, journaliste d’investigation ou sociologue, tous ayant à débusquer des «vérités» cachées. L’auteur ne rapproche pourtant ces fonctions que pour mieux les distinguer, se demandant par exemple et, textes à l’appui, ce qui différencie le reportage de l’enquête sociale. Partant de quoi, il passe à la confrontation de différentes théories sociologiques pour noter que ce qui embarrasse la science sociale est d’opérer sur les entités collectives que lui procure l’usage commun, ce qui n’est guère se dégager des données d’évidence. Comment, dans ces conditions, échapper, s’agissant des classes dirigeantes et des grands pouvoirs, à des versions diverses de la «théorie du complot»? Bourdieu s’en tirait, rappelle Boltanski, en décrivant la connivence des dominants sous forme d’une «orchestration sans chef d’orchestre». Mais, dans cette partie finale de l’ouvrage, nous sommes entrés dans le débat de spécialistes.
De ce livre puissant et généreux qu’est Énigmes et complots, on retiendra bien des choses mais peut-être surtout la confiance qu’il fait à la fiction. C’est qu’à sa manière, il reconnaît dans les formes variées du récit d’énigme, dérivé du grand roman social antérieur, la littérature de notre temps.
Luc Boltanski, Énigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, Paris, Gallimard, « nrf essais », 2012. 23,90 €.



