
Il est permis de penser que l’inventeur de l’art contemporain fut le magnifique Marcel Duchamp. Et qu’il l’inventa même deux fois. D’abord en substituant aux œuvres peintes ses fameux « ready mades » (roues de bicyclettes, urinoirs, etc.), qui préludaient aux « installations » d’aujourd’hui. Ensuite, mais la chose est moins connue, en se faisant le concepteur d’expositions remarquables qui procuraient un rôle tout neuf à ceux que l’on nomme les commissaires : imprimer si bien sa marque à la présentation des œuvres que l’exposition devienne œuvre à son tour. Et c’est ainsi que l’on vit le commissaire d’exposition se faire artiste quand, dans le même mouvement, tel artiste s’instaurait en commissaire. Le temps des « curateurs » venait de commencer, pour reprendre ce terme aux Américains.
Ce phénomène de l’artiste commissaire (qu’il expose son œuvre, celle des autres ou autre chose encore) allait connaître une fabuleuse expansion dans les dernières décennies, modifiant de fond en comble les conditions dans lesquelles les œuvres se donnent à voir. S’est ainsi produite une révolution culturelle « seconde » à laquelle une historienne de l’art, Julie Bawin, vient d’avoir la bonne idée de consacrer un passionnant ouvrage autour de la figure démultipliée d’un « homme de l’art » jouant plusieurs rôles. Pour ce faire, J. Bawin a moissonné large, réunissant une collection extraordinaire d’exemples pris à différents moments et en différents lieux. Et, dans la profusion des expériences retenues, elle a réussi à introduire un ordre et à repérer une évolution grosse de signification. D’un bout à l’autre cependant, Duchamp demeure sa grande référence et notamment pour le sens rare qu’il avait du « système institutionnel de l’art ». Car c’est bien de cela qu’il s’agit et que notre auteure a compris : les « curateurs » adoptent envers l’institution artistique une position qui fluctue entre « posture critique » et « jeu créatif » pour de toute façon apporter un supplément de valeur au phénomène expositionnel.
Mais, face à une efflorescence qui paraît désormais sans limites, on sent parfois perplexe l’auteure de l’ouvrage : entre largement conquise (l’art se porte comme jamais) et quelque peu inquiète (où s’arrêtera-t-on ?): « Au fur et à mesure plus nombreux, note-t-elle, les commissaires d’exposition sont devenus des personnalités incontournables de la scène artistique contemporaine, se présentant parfois […] comme des “sur-artistes“, sortes de démiurges détournant la création artistique au profit d’un discours, d’une thèse, ou, mieux encore, d’une vision personnelle. » (p. 2)
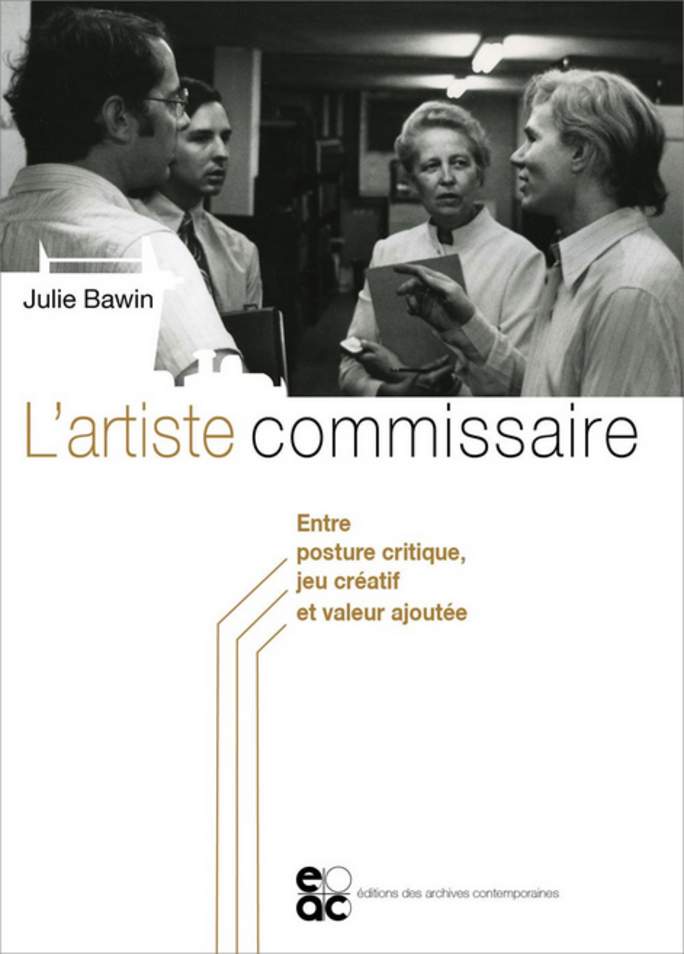
Agrandissement : Illustration 2
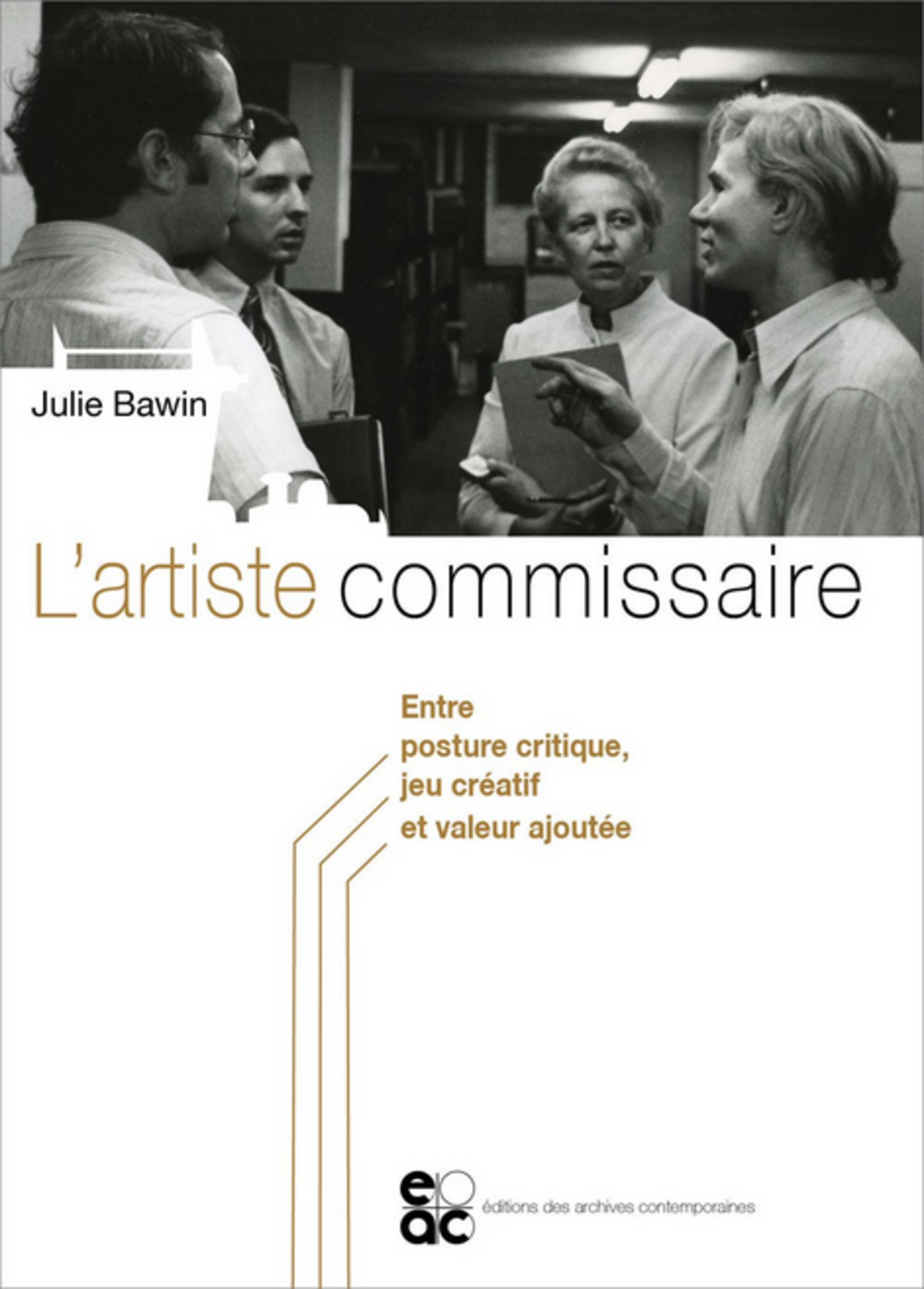
Alors, détournement de l’art que cette sur-exposition où la médiation entre plasticiens et public se fait au profit d’une starisation de quelques-uns ? Julie Bawin ne veut pas le penser, qui préfère prendre en compte de grandes réussites et souligner que, en bien des cas, le curating d’artiste, s’il s’exprime également dans les galeries et autres lieux, a pour principal mérite de sortir les musées de leur conformisme et de les rendre accueillants à l’art de leur temps. Avec l’Américain Asher comme avec le Français Buren, pour prendre ces exemples, c’est la fonction muséale qui est ainsi remise en cause. « Le musée en tant que site élitiste et bastion de la tradition, écrit encore la critique, doit donc progressivement céder sa place à une sorte de “musée mass media“, dicté par une mise en scène spectaculaire et événementielle de l’art. » (p. 126)
Un exemple de ce grand dépoussiérage fut donné par le Louvre, qui invita successivement divers artistes à investir ses salles et à interpréter ses collections. On y vit ainsi, et pour ne citer qu’eux, Jan Fabre confronter ses œuvres à celles des grands maîtres flamands – entre subversion et professionnalisme, et Patrice Chéreau transformer pendant des mois ledit Louvre en une sorte de grand barnum ouvert aux débats, à la danse, au théâtre, etc.
Un autre volet de l’évolution d’ensemble concerne davantage les galeries et lieux d’art. Certes, déjà Courbet et Manet s’exposèrent eux-mêmes mais ils n’avaient guère d’autre choix. En revanche, les plasticiens de notre temps choisissent de se mettre en évidence et de contrôler le marché. Ce sont ainsi les « pratiques solidaires » qu’ont illustrées de grands noms de l’art comme l’Anglais Hirst, le Japonais Murakami ou le Chinois Ai Weiwei et qui réunissaient autour d’eux disciples et amis dans l’affirmation d’une « manière » qui allait les promouvoir. Ou bien encore ce sont ces cartes blanches que les galeries donnent à des artistes en leur demandant d’exposer leur personnalité intime. Ainsi, au Palais de Tokyo de Paris, Marc-Olivier Wahler invita l’Italien Rondinone à concevoir une « exposition qui se construit comme une déambulation dans un cerveau en perpétuelle activité » (p. 235). Et voilà l’artiste devenu scénographe au milieu d’éléments épars.
C’est au sein de cette évolution qu’est apparu un acteur hybride mais combien entreprenant, le curateur indépendant. Le Suisse Harald Szeemann incarna avec éclat cette figure d’un intervenant qui s’érige en artiste à même le style selon lequel il donne à contempler les œuvres d’autrui. Nous voilà à la limite, celle de l’exposition d’exposition. On associera à Szeemann le Warhol qui, après s’être rendu célèbre avec sa Factory, se vit confier le soin de redistribuer objets et œuvres appartenant à un musée de Providence et d’exprimer sa vision de l’art dans le grand micmac de sa Raid the Icebox (photo ci-dessus et en couverture du livre).
Ainsi, d’étape en étape, L’Artiste commissaire se fait livre plus qu’attachant. Confierai-je ici qu’un jour j’ai encouragé son auteure à l’entreprendre ? Je m’en félicite puisqu’il vient tout naturellement se ranger aujourd’hui aux côtés des travaux d’une Nathalie Heinich et d’un Paul Ardenne qui ne conçoivent l’art actuel qu’en regard de ses conditions socio-historiques de production.
Julie Bawin, L’Artiste Commissaire. Entre posture critique, jeu créatif et valeur ajoutée. Paris, Éditions des Archives contemporaines, 2014. € 29,50.



