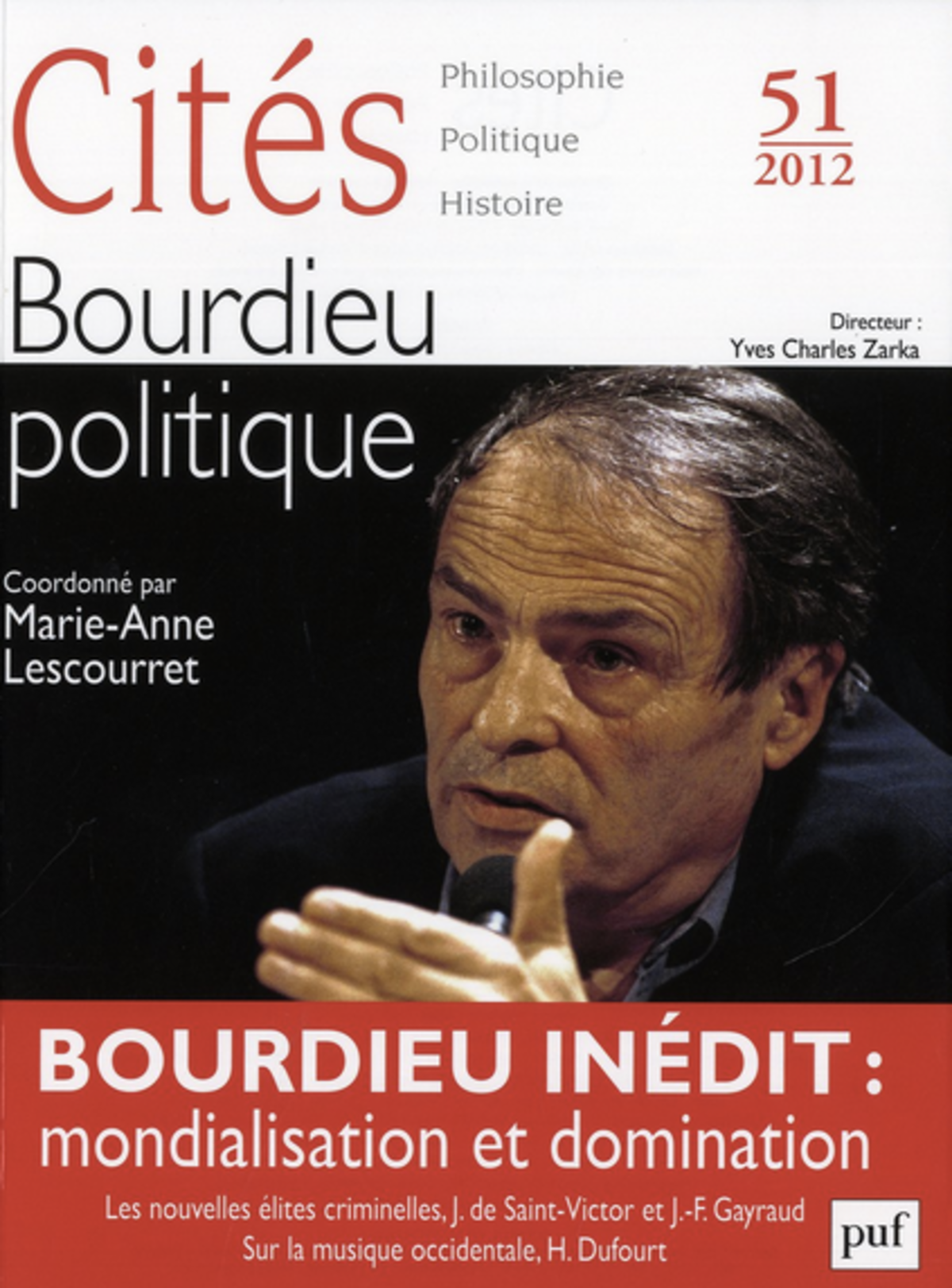
Repris d’un cours fait au Collège de France en 1989-1992 et édité par quatre de ses disciples, le beau et gros volume Sur l’État (Seuil et Raisons d’agir) relançait début 2012 toute la question des rapports de Bourdieu au politique et de la manière dont le sociologue disparu arrivait à accorder sa méfiance envers l’État avec la défense des services publics qui était la sienne. Voilà que la revue Cités y revient dans une livraison conçue par son directeur Yves Charles Zarka et coordonnée par Marie-Anne Lescourret.
L’ensemble est d’une si grande richesse qu’il nous réduit ici à pointer quelques-uns de ses temps forts. D’entrée de jeu, Zarka donne le ton : l’État selon Bourdieu EST le monopole de la violence symbolique en même temps que de la violence physique. Ainsi de son pouvoir de nommer et, plus que jamais aujourd’hui, d’évaluer. À sa suite et dans un article serré, Gérard Mauger montre comment, passant de la philosophie à la sociologie, Bourdieu ne put concevoir cette dernière qu’en lui attribuant une portée politique. Et pour la raison simple qu’il n’est de bonne sociologie que dévoilant des mécanismes de pouvoir et le faisant nécessairement de façon « partisane ». C’est sur cette base que l’auteur des Médiations pascaliennes a défendu un engagement sociologique, produit des analyses d’un intellectuel collectif. « Il n’a cessé, note Lescourret en de jolies formules, de construire l’intellectuel nouveau, “fonctionnaire de l’humanité“, dédié à l’élaboration d’utopies rationnelles » (p. 15). L’intellectuel en question est, pour cet autre contributeur qu’est Marcel Fournier, acquis à la rationalité que Bourdieu nomme « raison pratique » et qui est théorie de l’action. Le problème pour le sociologue est cependant de concilier la même raison avec une perception historique et donc relativiste soutenant un travail d’objectivation qui porte à la fois sur les conditions d’exercice de la science et sur le fait que le sociologue est compris dans l’objet qu’il analyse.
Pour en revenir à la question de l’État, on retiendra avec Juliette Grange, auteure d’un article substantiel, que Bourdieu a toujours été « statophobe », tout comme Foucault d’ailleurs. C’est que, pour lui, « dans l’État bureaucratique, l’efficacité symbolique tient sa force de la dissimulation et de la dénégation de ce qui le constitue » (p. 87). Ce qui est façon de pointer ce qu’il y a de « magique » dans l’État républicain que les juristes ont drapé de neutralité illusoire. Ainsi de l’aspiration typiquement française à l’universel qui n’est qu’illusion de légitimité dissimulant un puissant effet de domination.

Il faudrait parler encore dans la même livraison des articles plus philosophiques proposés par Derek Robbins, Claude Gautier et Jean-Paul Cléro, le premier retraçant l’itinéraire de Pierre Bourdieu, le second parlant de la façon dont le sociologue concevait le porte-parole de tout groupe dominé en imposteur muni d’un skeptron, le troisième se demandant ce que recouvre dans l’œuvre bourdieusienne la référence récurrente à Blaise Pascal. Mais allons plutôt vers la belle analyse de Luc Van Campenhoudt qui se demande s’il n’y a pas lieu aujourd’hui de préférer à la notion de champ attachée à la théorie de Bourdieu celle de réseau, si présente en beaucoup de dispositifs contemporains ? Pour Van Campenhoudt, la première de ces notions garde toute sa pertinence, en permettant par exemple de décrire la manière dont aujourd’hui différents champs empiètent sur d’autres, menaçant redoutablement leur autonomie. Ainsi du champ journalistique qui coiffe si souvent le champ politique, du champ pénal qui interfère avec le champ social ou, plus que tout, du champ économique submergeant tous les autres. Et voilà certes qui n’est guère réjouissant.
Ceci nous ramène à l’éditorial du directeur de la publication qui prend sur lui de dénoncer, à la suite de Bourdieu, la plaie d’un système bureaucratique voulant que le champ socio-politique tout entier soit actuellement sous la coupe d’une « volonté de maîtrise totale en fonction de “valeurs“ purement instrumentales comme l’efficacité, le rendement, la productivité » (p. 7). Et Zarka d’ajouter avec force : « La violence symbolique a aujourd’hui son nom : évaluation ». Cette fois, nous voilà entraînés vers l’action critique et militante, et qui s’en plaindra ? Bourdieu encore ne disait-il pas que ce que le monde social a fait, le monde social peut le défaire ?
Bourdieu politique, coordonné par Marie-Anne Lescourret, revue Cités, Paris, PUF, 2012, 15 € 50.
Avec une interview de Bourdieu conduite par B. Chung, « Mondialisation et domination : de la finance à la culture »



