Dans cette galerie d’art contemporain que je visite est exposée une “fontaine” (hommage à Duchamp ?), faite d’un montage métallique auquel sont suspendus de nombreux sachets d’emballage. La galeriste m’aborde et me dit : “vous voyez, c’est un geste de protestation contre notre société de consommation”. Je n’y aurais jamais pensé. Mais ainsi va l’art aujourd’hui : il ne se présente guère sans son commentaire, et je le dis sans moquerie.
Dans l’ouvrage qu’elle publie ces jours-ci sous le titre du Paradigme de l’art contemporain et qui fait suite au Triple jeu de l’art contemporain (1998), Nathalie Heinich insiste sur cette particularité d’un art qui est celui de notre temps, — qu’on le veuille ou non : ses productions visuelles (on n’ose plus dire picturales) ont besoin d’un discours d’escorte, d’une description du travail accompli comme projet et comme visée. Et cela pose évidemment la question de l’usage public de cet art, de sa perception et de sa consommation. Dans le cas évoqué en commençant, avais-je besoin du secours de la galeriste ? Et si oui, pouvais-je faire confiance à ce qu’elle me disait ?

Mais parlons de ce nouveau livre de Nathalie Heinich qui est une véritable somme sur l’art de notre temps. Ou qui, mieux encore, est un état de la question étonnamment méthodique et parfaitement illustré (en mots, non en images !) à l’aide de multiples exemples empruntés au grand marché mondial des productions artistiques. En sociologue avertie, Heinich entend décrire ce qui est désormais un sytème et d’en objectiver de la façon la plus sérieuse les propriétés et conditions de production. C’est dire qu’elle ne va jamais se prononcer pour ou contre ledit système et ce qu’il génère : il est là, il existe et est extraordinairement vivant.
Se survit certes un art moderne qui remonte aux impressionnistes et aux cubistes mais c’en est néanmoins fini d’une peinture qui exprimait la sensibilité des artistes. On est désormais dans bien autre chose. Et c’est si vrai qu’avec l’auteure on peut résolument parler d’un changement de paradigme semblable à ceux qu’a décrits Thomas Kuhn à propos des sciences et dont il a fait la théorie. Donc il y a eu révolution et sont apparus des principes de fonctionnement — pratiques, idéologiques, esthétiques —entre lesquels existe une solidarité forte et qui ne tolèrent aucun autre dispositif. Ainsi c’en est fini de la peinture et de ces créations conçues en termes d’objets (les tableaux !) et d’œuvres. Prévalent à présent des processus et des productions qui se nomment montages, installations et même parfois ambiances.

Déjà apparue dans un ouvrage antérieur, l’idée forte de l’auteure est que le nouvel art vit sous un régime de la singularité à tout prix. “La singularité, écrit-elle, n’est plus seulement ce qui est attendu par les spectateurs, mais aussi ce qui est visé sciemment, et parfois prioritairement, par les artistes” (p. 72). Il s’agit de surprendre en remettant en cause les règles et habitudes d’une perception qui n’est plus représentation. Et cela donne des actes diversement inspirés et pas toujours interprétables. Ce sera Yves Klein exposant dans une salle peinte en bleu la pure essence de son génie créatif. Ce sera Warhol démarquant dans ses tableaux (eh oui !) la culture de masse. Ce sera Christo emballant un pont à Paris. Ce sera Delvoye reproduisant en grand tout le système digestif et faisant marcher sa machine. Et ce sera Cattelan qui pend au sens fort des mannequins d’enfants sur une place publique.

Agrandissement : Illustration 3

Ces productions bigarrées et violentes participent à la fois d’une imitation ironique et d’une ambition de rivaliser avec quelque grand Créateur. Nathalie Heinich parle à ce propos d’expérience des limites, reprenant ainsi une formule qu’utilisa Philippe Sollers à propos d’écrivains aussi radicaux que Lautréamont, Artaud ou Bataille. Ce qui ne manque pas de pointer vers un avant-gardisme plus ancien et qui se voulait scandaleux. Car il s’agit bien pour les stars du “contemporain” de donner dans la provocation. Leurs installations ne sont-elles pas tout ensemble malaisées à exposer, à transporter, à conserver ?

Agrandissement : Illustration 4
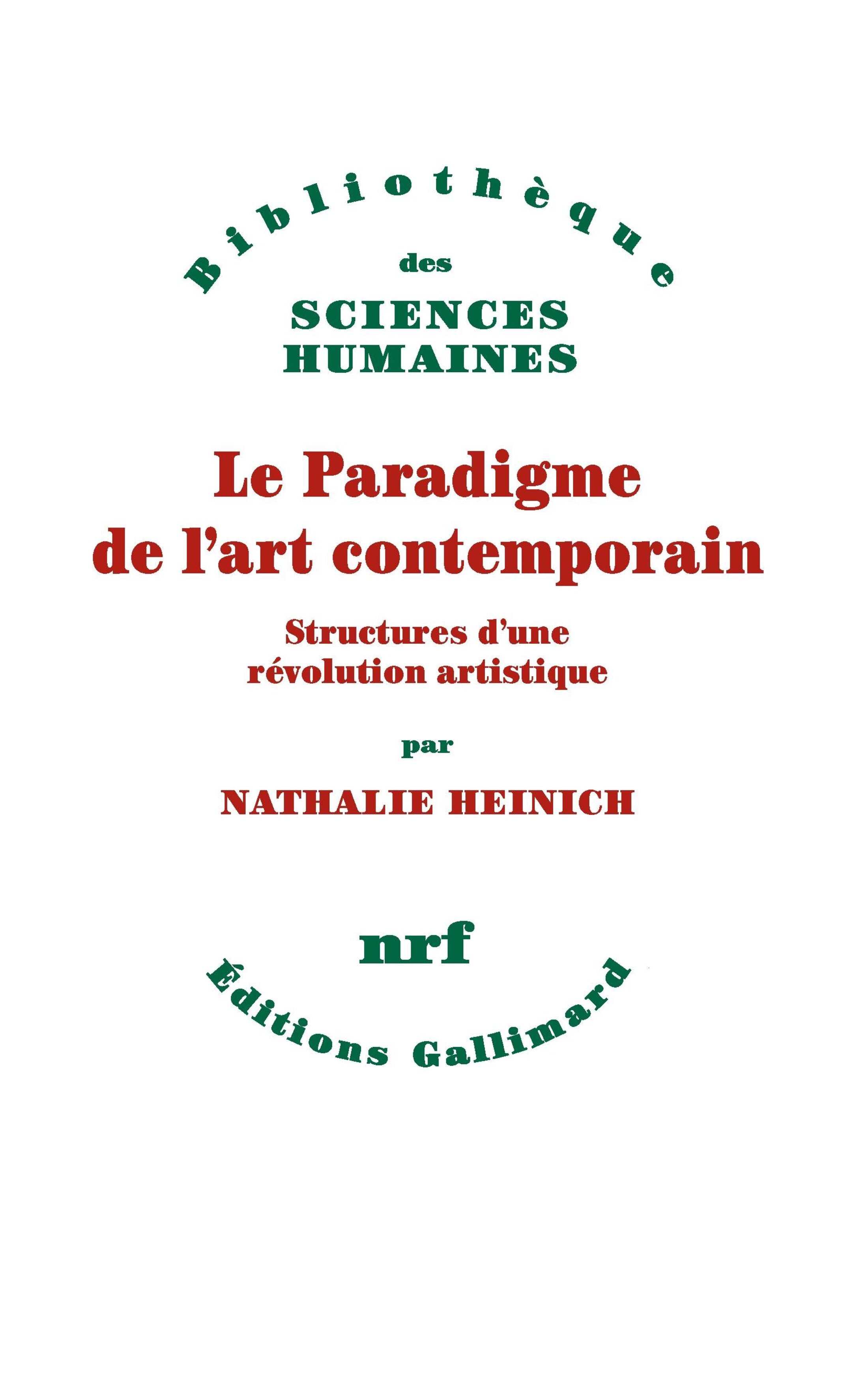
Mais ce que notre sociologue excelle à décrire, c’est le nouvel appareil de fonctionnement institutionnel régi par le paradigme. Aussi voit-on le marché de l’art singulier s’appuyer autant sur les institutions publiques (voir les FRAC en France) que sur les marchands et collectionneurs et créer ainsi une collaboration inédite. Mais surtout, puisque l’art en cause exige en permanence d’être “introduit” (Heinich parle d’“acharnement herméneutique”), de nouveaux médiateurs sont apparus et leur rôle est devenu essentiel. Ainsi le curateur a remplacé le commissaire, le directeur d’institution le conservateur et le galeriste le marchand. Par ailleurs, des biennales comme Venise et des foires comme Bâle scandent régulièrement les grands moments d’un marché désormais mondial et sur lequel les prix flambent.
Aux différents bouts de ce marché, curateurs, artistes et collectionneurs circulent sans trêve, préparant des expositions et traitant leurs affaires. Ils sont pris dans le vertige d’un “présentisme”, où vont et viennent projets, trouvailles et anecdotes. De quoi sans doute inquiéter, hérisser, heurter le simple amateur d’art. Pourtant, celui-ci ne peut faire mieux que s’assimiler le régime de singularité. Et, pour ce faire, il peut compter dorénavant sur un ouvrage en tout point remrquable et qui lui offre calmement les clés du nouveau paradigme.
- Nathalie Heinich, Le Paradigme de l’art contemporain. Structures d’une révolution artistique, Paris, Gallimard, “Bibliothèque des sciences humaines”, 21 € 50. En vente le 20 février 2014



