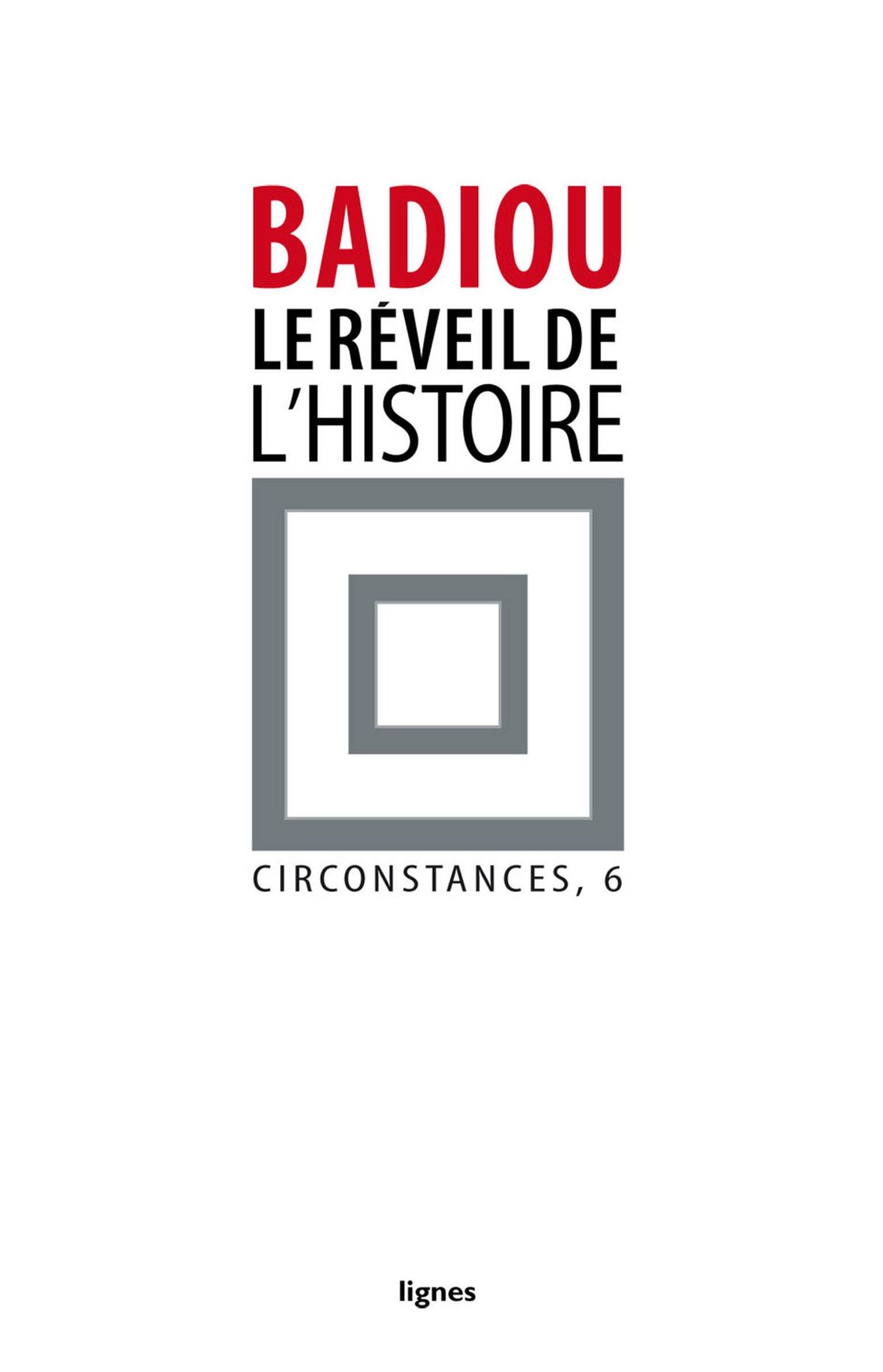
Agrandissement : Illustration 1
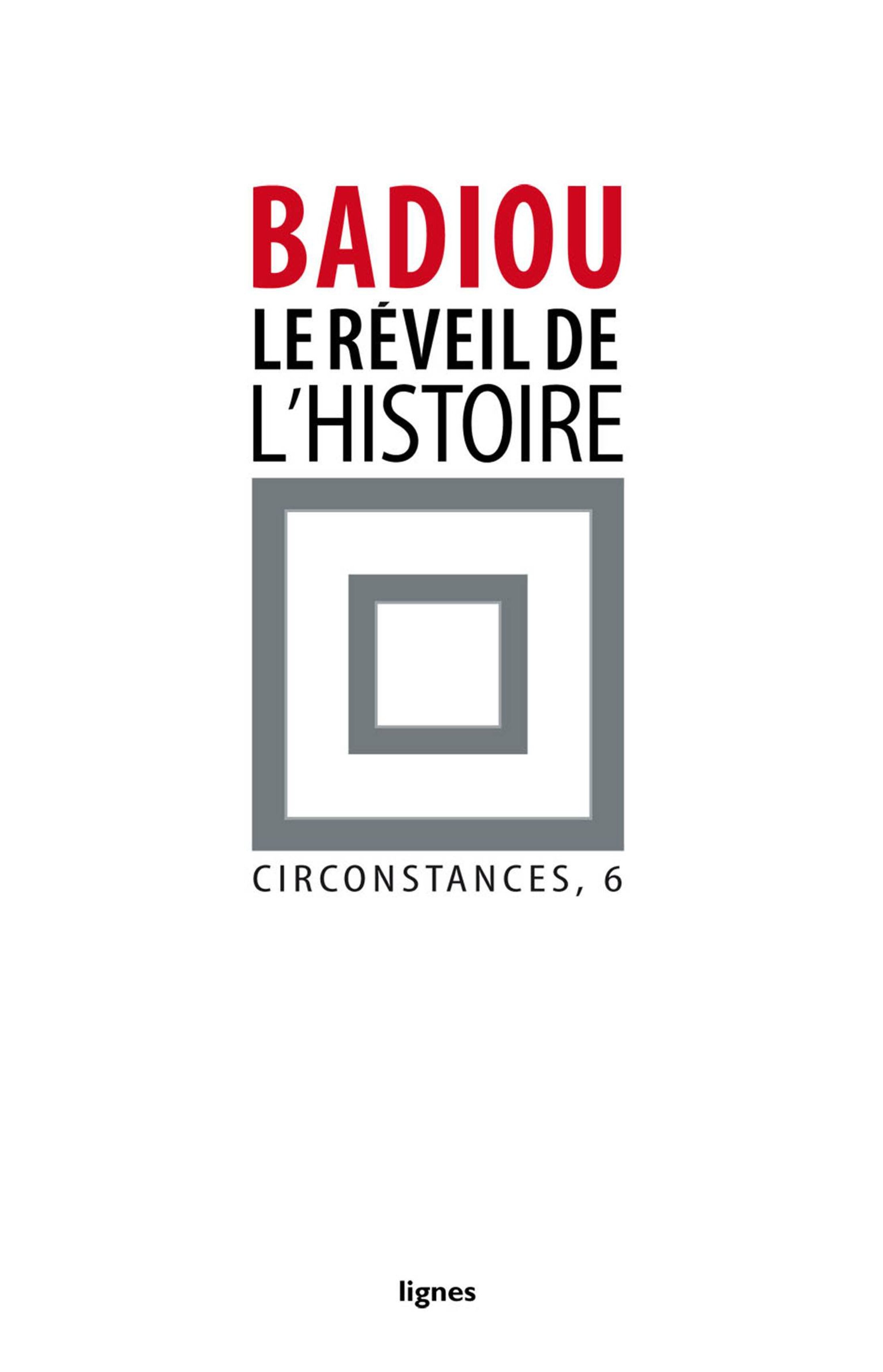
Time Magazine vient de choisir sa personnalité de l'année et, comme il se doit, elle figure en couverture. Il s'agit du ou de la protestataire-type («protester»). Alain Badiou en ferait bien autant, si l'on en croit son tout récent Réveil de l'histoire, où il revient sur les «émeutes» des pays arabes et accessoirement sur le mouvement des «indignados».
Mais, l'on s'en doute et l'on s'en réjouit, Time et Badiou n'ont pas la même lecture des événements insurrectionnels. Pour le journal américian, les révoltes arabes ne font rien d'autre qu'exprimer un «désir d'Occident», donc de démocratie à l'occidentale. Pour Badiou, en revanche, elles sont une phase dans un processus de libération à peine commencé et qu'il faut analyser dans sa complexité symbolique et politique. D'un lieu à l'autre, toutes choses ne sont pas égales d'ailleurs et, aux yeux de l'auteur, la révolte libyenne (si révolte il y eut) a été entièrement confisquée par les pays de l'Otan.
Dans son nouvel ouvrage, qui fait suite à L'Hypothèse communiste de 2009, Alain Badiou fait la preuve d'une haute capacité à conceptualiser l'histoire immédiate. Après avoir réaffirmé que le capitalisme n'est en rien sorti de sa forme classique et que les analyses qu'en donna Marx ont conservé toute leur pertinence, Badiou s'empare de la notion d'émeute pour cerner son nouvel objet et montre quelle force dialectique elle prend, quand on l'applique à bon escient aux mouvements de Tunisie ou d'Égypte. Il fait ainsi apparaître que, dans les deux cas, il y eut passage du stade de l'«émeute immédiate» à celui de l'«émeute historique». Mais, pour ce faire, il fallut que soient remplies trois conditions au moins: étaient nécessaires une localisation forte (celle de la place Tahrir éminemment), une condensation du peuple «en mosaïque» (des gens de toutes classes furent présents), l'affirmation d'une demande commune (le «Dégage» adressé au dictateur, l'exigence que l'armée se retire du pouvoir). Telle fut alors la grande leçon: au centre de Tunis comme place Tahrir, on a vu se former et se manifester violemment une «minorité massive», qui se voulait tout le peuple, parlait pour ce peuple et transgressait, ce faisant, les différences d'âge, de classe et de religion. «Les (masses), écrit à ce propos Badiou, désignent un aspect originairement communiste de la mise en mouvement populaire, son aspect générique, dès lors que l'émeute est historique» (p. 134). Cependant, dans la période actuelle que Badiou qualifie d'intervallaire et qui voit donc le «réveil de l'Histoire», il est douteux que le mouvement puisse déjà donner naissance à une Idée politique neuve se condensant dans une organisation –qui ne saurait plus être la «forme-parti», précise l'auteur. C'est aussi que, si l'émeute historique est émergence puissante des «inexistants», elle est loin de rompre avec toutes les identités discriminantes.
À propos d'identité comme mythe nuisible et comme produit des sondages, Alain Badiou se paye comme un passant un détour par la France et par ses politiques d'exclusion. Et d'écrire de façon savoureuse: «Le "Français", le F moyen, est par exemple laïc, féministe, civilisé, travailleur, élève sage de "l'école républicaine", blanc, parlant très bien français, galant, courageux, de civilisation chrétienne, fraudeur, indiscipliné, sujet de la patrie des droits de l'homme, moins sérieux que les Allemands, plus ouverts que les Suisses, moins paresseux que les Italiens, démocrate, bon cuisinier... et des tas d'autres choses variables et contradictoires, brandies par les propagandes nationales en fonction des circonstances» (p. 112).
Comme on voit, le marxisme fortement revendiqué de Badiou ne s'interdit pas l'humour non plus que la poésie (l'auteur cite, chemin faisant, Brecht et Char). D'ailleurs, tout tourné qu'il soit vers le théorique, il ne se départit jamais d'une sentimentalité fusionnelle au demeurant chaleureuse. Le philosophe, comme on sait, n'a pas cessé de voir dans le moment «Commune de Paris» un événement révolutionnaire d'une d'une pureté sans égale. De même ici, et alors qu'il ne s'illusionne pas sur l'avenir immédiat des révoltes arabes, il ne dégage pas moins d'elles tout ce qui en fait l'intensité et qui s'exprime en particulier dans les rassemblements hétérogènes qu'elles furent et sont encore. Ceux-ci, dit-il, ont le mérite sans pareil de faire exister une vaste foule d'inexistants. Et de rappeler pour l'occasion cette formule de L'Internationale qui valait pour les prolétaires et vaut sans pour les indignés: «Nous ne sommes rien, soyons tout».
Badiou, Le Réveil de l'Histoire. Paris, Lignes, « Circonstances 6 », 2011. 17 €.



