Sur les chaînes de télé, on peut encore voir de temps à autre un feuilleton policier intitulé Une femme d’honneur. L’héroïne en est une adjudante-chef de la gendarmerie qui dénoue les affaires les plus difficiles et fait son métier avec grande vaillance. Femme d’honneur pour autant? C’est un bien grand mot à propos de quelqu’un qui ne fait qu’accomplir parfaitement son travail. Mais il est tout de même mérité au sens où l’adjudante incarne une grandeur professionnelle par laquelle elle capte tant notre estime que notre reconnaissance.
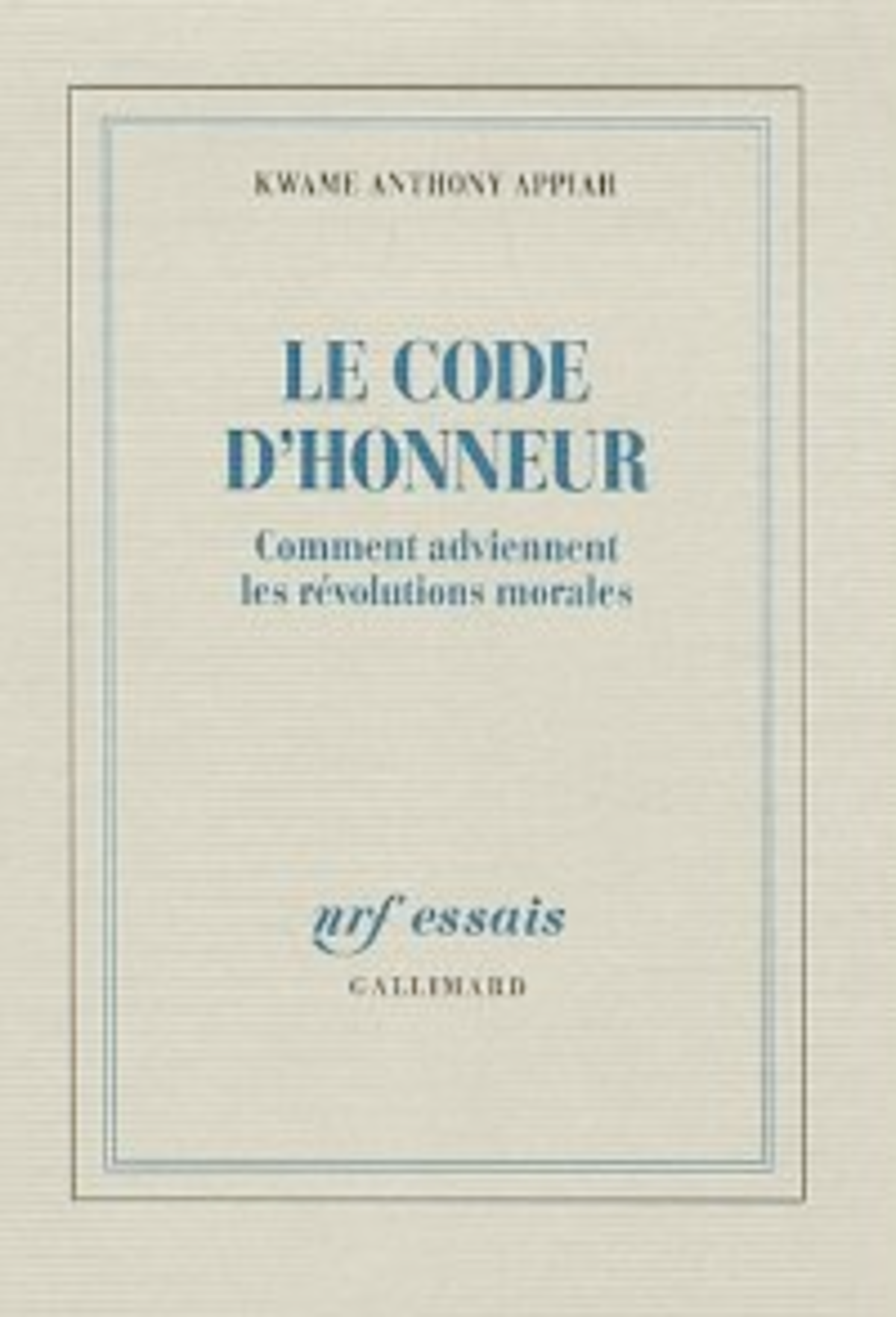
Il n’est donc pas incongru qu’un brillant philosophe, professeur à Princeton, choisisse de revenir à cette question de l’honneur, notion qui peut sembler d’un autre temps. Kwame Anthony Appiah le fait en passant en revue de grandes pratiques sociales qui ont marqué l’Histoire et où le sens de l’honneur est mis en contradiction avec lui-même pour finir par beaucoup évoluer. Quatre exemples sont ici retenus, dont le dernier, touchant à un usage atroce, est encore largement d’actualité. Sont ainsi successivement analysés, dans Le Code de l’honneur, le duel aristocratique, le bandage des pieds des femmes dans les classes supérieures en Chine, la traite des esclaves par-dessus l’Atlantique, enfin les crimes d’honneur que l’on pratique au Pakistan quand une femme est déflorée avant le mariage.
Tout cela fait donc un sacré mélange mais où se reconnaissent tout au long même structure et même évolution. C’est d’abord qu’à chaque fois, une pratique que nous estimons aujourd’hui barbare est largement tenue pour la figure même du comportement d’honneur. Fondée sur la reconnaissance d’un code, elle confère une rare estime aux pratiquants, qui sont de la classe supérieure. Mais vient le moment où un groupe à l’intérieur du groupe perçoit et dénonce la cruauté ou l’injustice d’usages qui pourtant se perpétuent. Commence alors leur déclin lent, qui est souvent synonyme de l’adoption des codes par les classes inférieures. Mais qui est surtout effet d’un renversement de perception : dans le cas des pieds bandés (les «lotus d’or» !), des Chinois lettrés ou revenus d’un voyage en Occident répandent l’idée que torturer les pieds des femmes pour les réduire de volume relève d’une véritable barbarie déshonorant le pays. «À la fin du XIXe siècle, note Appiah, une famille de l’élite Han aurait eu bien du mal à trouver un époux convenable pour une jeune femme aux pieds normaux ; à la fin des années 1930, l’inverse était vrai à peu près partout» (p.189). D’une forme d’honneur, on a basculé dans une autre, qui la contredit. Ce qu’il faut encore souligner est que, si l’Empereur de Chine a voulu par la «méthode» des pieds bandés réduire la mobilité de ses femmes, c’est pour qu’elles n’aillent pas courir le guilledou –comme on ne disait pas en Chine ancienne.
On voit moins dans l’ouvrage en quoi mettre des noirs en esclavage relevait de l’honneur, sauf à dire que le propriétaire de plantation accroissait de la sorte son prestige. Mais c’est «l’honneur en retour» qui, ici encore, est en cause. L’argument est subtil et inattendu: au nom de son expérience de la dignité humaine bafouée, la classe ouvrière anglaise aurait joué un rôle décisif dans l’abolition de l’esclavage en prenant fait et cause pour ces esclaves lointains dans lesquels elle se reconnaissait sans peine. Exemple d’une étonnante solidarité et d’un respect de soi générant le sens du respect des autres.
Dernier exemple: à propos de l’honneur traditionnel tel qu’il survit aujourd’hui et notamment au Pakistan, Appiah rapporte l’histoire de Mukhtaran Bibi, vivant avec sa famille au Penjab. Parce que son jeune frère s’est trop approché d’une jeune femme, plusieurs membres d’une tribu voisine la violent en guise de vengeance d’honneur. Mais Mukhtaran ne se réfugie ni dans la honte ni dans le suicide. Pendant des années, elle lutte pour obtenir réparation des instances judiciaires. Et elle en vient même à prendre la tête d’un mouvement de soutien aux femmes abusées. Ainsi elle est allée jusqu’au bout de l’honneur par sens couplé de sa dignité et de celle d’autrui.
C’est avec un talent très particulier et une manière de tact soutenu que le philosophe évoque de grandes causes où l’on voit un honneur de classe succomber face à un honneur de portée universelle. Le lecteur eût sans doute aimé que l’analyse sociale soit plus poussée, tant les codes évoqués font partie d’un visible système de domination. Mais l’intérêt d’Appiah est ailleurs et se porte avant tout sur la façon dont se produisent les révolutions morales. Ce qu’il fait, dans son beau livre, avec une grande liberté de pensée pour conclure que la dignité auquel a droit tout être humain «est une forme d’honneur et [que] son code s’inscrit dans la morale» (p. 195).
Kwame Anthony Appiah, Le Code d’honneur. Comment adviennent les révolutions morales, Paris, Gallimard, « nrf essais », 2012. 25 €.



