Le lecteur est tout d’abord sensible à la forte charge émotionnelle que produit sur lui le roman d’Agnès Verlet, émotion que fait naître d’emblée l’Avant-dire, en tant que bouleversant "Tombeau des Tanenboim", que le récit va déployer sur le double registre du roman familial et de la thématique de l’enfant caché. L’originalité du roman tient au fait que l’auteure réussit — difficulté majeure — à renouveler le genre des "souvenirs d’enfance", en multipliant de façon inventive les jeux du couple apparition/disparition, ce qui permet d’éclairer de façon originale le couple attendu de la mémoire et de l’oubli.

Ainsi Agnès Verlet tient-elle le pari d’embarquer son lecteur dans la quête de sa narratrice grâce à la justesse de la restitution d’une enfance bourgeoise au milieu du XX° siècle, y compris dans sa "sous-conversation" et ses secrets de famille justifiés par un art consommé de la discrétion, qui confine au déni, déni qui suscite le malaise et commande la démarche romanesque. Elle sait faire revivre cette famille nombreuse, au sein de laquelle se jouent les subtiles différences entre "les grands" et "les petits", différences qui instituent un ordre, faussement arithmétique, que vient bouleverser l’arrivée (l’apparition) du frère "en trop", Paul, le seul à avoir un prénom, qui est peut-être le masque d’un autre nom — imprononçable.
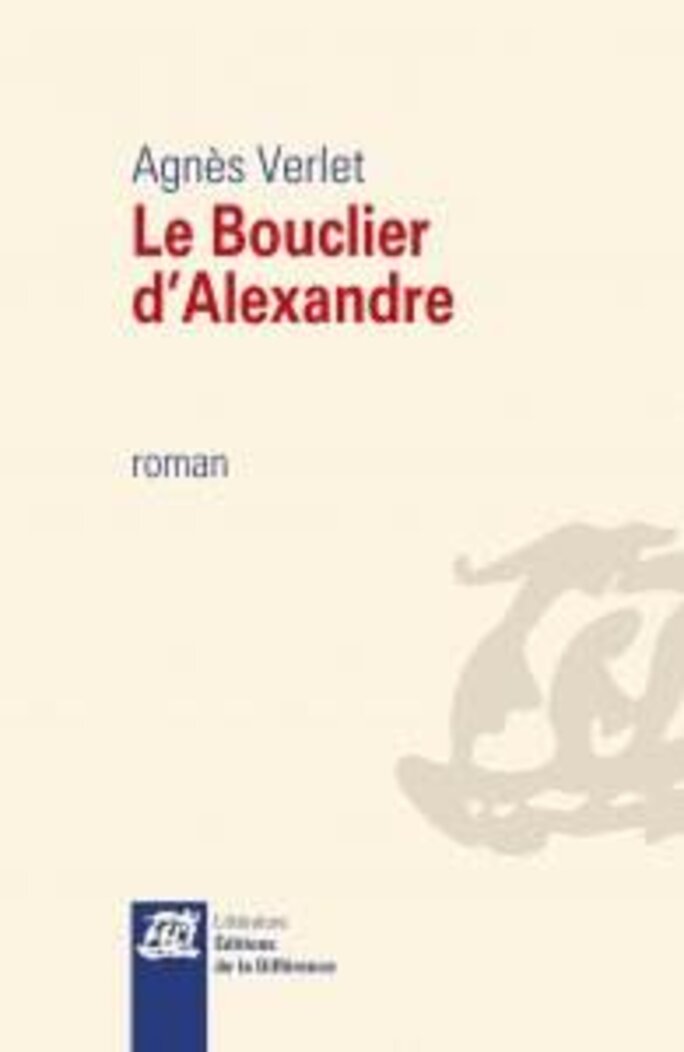
La réussite du roman tient à l’efficacité du dispositif narratif, qu’indique d’emblée le beau titre, à la fois programmatique et énigmatique, ce qui permet l’articulation entre le puzzle — comme jeu emblématique de l’enfance — et la reconstitution nécessaire et impossible du célèbre objet archéologique. Le formidable "Tombeau des Tanenboim" qui sert d’incipit au récit permet ainsi d’ouvrir tous les possibles de la quête et de la narration, y compris dans la reconstitution imaginaire qu’autorise la fiction : que ce soit dans la scène du "sauvetage" de l’enfant juif par le père de la narratrice, dans le jeu sur l’homophonie Tanenboim /Tannenbaum (la polysémie de ces sapins, de Poméranie ou de Noël, servant de révélateur du non-dit) ou encore dans la scène de l’enterrement où la narratrice "ose" le conte/rêve pour arracher les masques et s’emparer de la boîte aux secrets, qui est la matière même de la création romanesque. Et l’hommage inaugural aux parents disparus de Paul appelle l’autre hommage, plus caché et douloureux, le "Tombeau du petit frère", qui justifie, de façon posthume, l’écriture du Bouclier d’Alexandre.
Ainsi Agnès Verlet nous donne-t-elle ce rare et précieux plaisir de lecture que procure son beau roman, ce "roman bariolé" — poikilos (ποíκιλος) auquel pensait Barthes —, récit-mosaïque qui sait éviter l’écueil du roman sociologique, ce qui n’est pas toujours le cas pour d’autres œuvres dans l’air du temps...
- Agnès Verlet, Le Bouclier d’Alexandre, éd. La Différence, 384 p., 20 €



