
Agrandissement : Illustration 1

Katrina, de Frank Smith, est un livre nomade, où le nomadisme est central. Un livre des circulations – entre l’enquête, la poésie, le récit. Le livre bouge et se déplace d’un genre à l’autre, sans se conformer à aucun, produisant des trajets éphémères entre ces genres, des formes hybrides, mobiles (« Entre deux points, la phrase des eaux, lancinante. Elle circulera, et toi avec »).
Ce qui importe est le déplacement, la mobilité, selon une logique de la transversalité, de l’agencement. Les langages se juxtaposent, se mélangent, sans hiérarchie : langage objectif d’une description encyclopédique ou d’un dictionnaire, langage subjectif des impressions et états internes ; langage littéraire, langage parlé ; langue anglaise, langue française ; etc. Les Indiens de l’Isle de Jean Charles, en Louisiane, qui sont donc des citoyens américains, ont également des ancêtres français – circulant entre plusieurs identités, plusieurs histoires, plusieurs langues. Comme l’eau, qui circule partout, omniprésente. Comme circule celui qui, dans le livre, ne cesse de se déplacer pour rencontrer les habitants du bayou, recueillir – accueillir – leurs paroles, traverser les paysages au volant d’une voiture de location…
Parcourir les routes, rouler à travers la géographie marine du bayou, exprime ce qu’est le livre – et inversement –, exprime l’écriture qui est circulation, rencontre, traversée d’un langage changeant, indéfiniment recommencé, différent/différant : « (…) un propos qui ne se termine pas, une phrase sans point, maintenue en suspens (…). Des bribes de quelque chose de consistant, de pas immuable à se dire, se donner. On ne va pas au bout mais peu importe ».

Le titre du livre fait bien sûr référence à l’ouragan « Katrina », qui en 2005 a semé la désolation en Louisiane. Cependant, l’auteur s’intéresse moins à l’ouragan en lui-même qu’à la zone de l’Isle de Jean Charles, exposée sans défense à la mer qui l’inonde, aux cyclones tropicaux, aux catastrophes naturelles qui détruisent sans cesse, se reproduisent et ruinent ce qui avait été reconstruit. Peuplée d’Indiens pauvres, de descendants de colons français qui ne s’identifient pas au modèle majoritaire américain, l’Isle de Jean Charles est l’inverse de l’American Dream et de l’American Way of Life, l’inverse de l’Amérique blanche et conquérante de Wall Street, des banlieues riches de Los Angeles – son négatif ou son envers oublié, refoulé. C’est à cette part niée de l’Amérique que Frank Smith choisit de donner la parole, c’est ce territoire que, dans ce livre, il choisit d’arpenter, c’est la population indienne qu’il rencontre, non pas en touriste européen blanc compatissant mais pour écouter sa parole, trouver avec elle et le pays d’eau où elle vit le moyen d’un agencement. Katrina est donc un livre politique.
On pourrait lire dans le livre une dénonciation, un témoignage au sujet d’une population abandonnée, condamnée à disparaitre – et en un sens il s’agit de cela. Face aux difficultés de la vie et de la survie dans une telle zone, comment ne pas avoir le sentiment que l’existence ne peut continuer, que sa fin a déjà commencé, et qu’il faut partir ? Comment ne pas se résigner ? La communauté de l’Isle de Jean Charles ne paraît pas avoir d’autre avenir que celui de sa dispersion, de son exil, de sa fin. D’autant que la protection de cette population et de cette zone n'est pas du tout une préoccupation pour les institutions du pays ou les industries pétrolières qui exploitent la zone sans s’intéresser au sort de la vie qui s’y trouve. Le destin de cette vie serait mourir ou partir, partir signifiant aussi mourir.
Sauf que les Indiens ne partent pas et refusent de partir, reconstruisant au contraire ce qui a été détruit, tentant de préserver ce qui disparaît – la mémoire, les lieux –, recommençant à chaque fois les conditions de la vie, jusqu’à la prochaine catastrophe. Réduire Katrina à une dénonciation, à un point de vue compatissant, transforme les Indiens en simples victimes et manque leur « puissance de vie ». Que les populations indiennes soient ici victimes d’une histoire et d’une politique est évident – les réduire à cette dimension est politiquement suspect car cela revient à reproduire à leur sujet le point de vue du pouvoir pour lequel les Indiens sont au mieux des victimes, au pire nuisibles, mais ne sont jamais une « puissance de vie », une vie possible, une autre vie possible qui par là résiste au pouvoir. Si Katrina est un livre politique, c’est surtout dans la mesure où il dépasse la victimisation pour explorer cette vie qui est là, vie indienne, vie mortelle et errante de cette zone de la Louisiane, avec laquelle le livre de Frank Smith cherche et crée un agencement vivant, vital (« Tu passes par tous les mélanges, toutes les combinaisons, les arrangements, les alliages, toutes les configurations possibles d’avec tes Indiens »).
Dans Katrina, il s’agit de vivre avec, d’être avec les Indiens, d’écouter ce qu’ils disent d’eux-mêmes et des autres : leur vie, leur désir, leur jugement. Il s’agit d’être avec des individus, des singularités qui disent leur singularité : leur vie, leur mémoire, leur histoire, leur lieu. Qui disent leurs paysages, leur politique – la mer, l’Amérique, les industries pétrolières, le futur. Qui chantent les comptines de leur enfance. Dans Katrina il s’agit de voir, de regarder, de parcourir l’étendue inconnue du bayou, celle d’un autre monde, d’un monde autre ou d’un autre du monde. Etre avec, écouter, contempler présupposent l’ignorance, de ne pas aborder ce que l’on rencontre ou regarde avec un savoir constitué, un point de vue qui réduit l’autre à des catégories existentielles, subjectives, historiques, politiques, déjà fixées. Etre sans repères. C’est cette absence de repères qui est recherchée par la rencontre – qui rend possible la rencontre –, ou par la circulation, le parcours des routes et des paysages produisant un monde à chaque fois nouveau, inconnu (« Tu circules en voiture, c’est l’ignorance »). Dans Katrina, ce parcours de l’inconnu, cette existence avec l’inconnu, cette absence de savoir et l’accueil de cette absence, sont une politique : ne pas savoir, ne pas imposer un langage, laisser parler l’autre, contempler et s’enfoncer dans ce que l’on ne sait pas pour en extraire une « puissance de vie », d’autres modes du rapport aux autres, à soi, au monde.
Le livre de Frank Smith est fait de ces parcours, de ces rencontres, des paroles dites par les habitants de l’Isle de Jean Charles : Lily, Marie-Lynn, Wenceslas, Denecia, Albert, Ron, Gary, Mr. John… Il est fait de leurs vies marginales par rapport à la pensée et au mode de vie majoritaires aux USA (et de plus en plus à travers le monde) – vies qui se caractérisent surtout par le rapport qu’elles ont nécessairement à la mer, à l’océan, aux cyclones, aux catastrophes recommencées, aux exigences de la vie sans cesse recommencées, c’est-à-dire à l’inconnu qui définit et conditionne leurs existences. Ne pas savoir, inventer des agencements avec un monde que l’on ne maîtrise pas, que l’on ne peut connaître a priori, est le propre de ces populations qui vivent avec cette « plasticité de l’île », « opaque et hostile », qui vivent de cette « vie d’eau », et dont la seule certitude est l’incertitude, la nécessité du recommencement, « l’aventure réitérée du mouvement quotidien ». L’Isle de Jean Charles n’est pas une communauté de victimes mais de philosophes spinozistes (« We never know ce qui peut arriver ! »). Et la destruction, la mort qui vit avec eux est aussi une puissance de vie – « To a life of moving water, vers une vie d’eau » – qui détruit autant qu’elle est à vivre puisqu’elle est la vie même : « Jamais on ne sait s’il faut fuir quelque chose, ou si au contraire on doit essayer d’atteindre cette chose… ».

A l’inverse de ce rapport à la vie, existe l’Amérique blanche, l’Amérique de la terre ferme – rendue ferme et fixe, connaissable et prévisible, maitrisable par le savoir et la technique –, pour laquelle le monde est d’abord exploitable : exploitation des populations sans doute, exploitation des ressources, comme le font, dans le livre, les compagnies pétrolières. Celles-ci ne rencontrent rien ni personne, ne contemplent évidemment rien, n’ont aucun rapport à la mer, aux éléments, et voient dans les cataclysmes uniquement un obstacle à leur pouvoir, un phénomène contre lequel se protéger, à dominer. L’Amérique blanche est celle d’une volonté de pouvoir, qui est un pouvoir de mort, soucieux de la vie qu’il peut exploiter mais indifférent à la vie que, par cette exploitation, il rate et détruit. L’exploitation, la maîtrise du monde ont pour conséquence la disparition de ce monde, son effacement au profit de ce qui dans le monde peut être utilisé en vue d’un mode de vie mortifère. Et ce rapport au monde est aussi bien celui qui s’applique aux populations, l’histoire des Indiens montrant comment ceux-ci ont pu être massacrés puis niés, oubliés, car non exploitables. La puissance de vie des Indiens de l’Isle de Jean Charles est précisément l’inverse du pouvoir de l’Amérique qui, comme tout pouvoir, est un pouvoir de mort…
En faisant résonner la parole de cette communauté d’Indiens, le livre de Frank Smith accomplit un geste politique par lequel ce qui est nié s’affirme, par lequel une population décimée existe encore, par lequel le règne de l’Amérique blanche est contesté moins par des revendications que par l’affirmation d’un autre mode de vie, de pensée, d’un autre rapport à la vie et au monde (« En marge du système-monde, l’insularité »). Il s’agit d’une politique de résistance puisque résister est moins nier qu’affirmer – et donc créer –, moins juger que troubler et faire fuir – l’existence de la parole des Indiens de l’Isle de Jean Charles étant en elle-même un acte de résistance au pouvoir blanc sédentaire, destructeur, négateur de la vie.
C’est cet autre rapport à la vie, aux événements du monde, aux phénomènes de la nature qui est rencontré à travers le livre. La Louisiane de Katrina n’est pas seulement un lieu géographique, encore moins touristique, ni réduit à des événements médiatiques et catastrophiques. La région de l’Isle de Jean Charles devient un lieu mental, subjectif, autant que métaphysique, expression de ce qu’est le monde dans son envers qui est pourtant sa réalité vivante, la vie du monde. Le monde est un monde d’eau, sans frontières, sans limites fixes, déterminées – monde de forces, de mouvements et de nouveautés incessants, donc de différences et d’événements, un monde-nuit, un monde-océan où tout est brassé, mobile, changeant. C’est ce monde que montrent les paysages du bayou parcourus dans le livre, monde que l’on ne domine pas mais avec lequel on produit des relations, des agencements éphémères et fragiles, comme avec une « nuit impraticable ». Ce monde est expérimenté par celui qui circule sur les routes, On the road comme l’écrivait Kerouac, là où le monde ne cesse de se modifier, de changer, d’offrir au regard et à l’expérience son étrangeté irréductible, la répétition de sa différence, monde d’événements par lesquels sans cesse il recommence.
En ce sens, dans Katrina, il n’est pas seulement question de rendre compte des conditions matérielles et géographiques difficiles auxquelles les habitants de l’Isle sont en butte. Est surtout exprimée, là encore, la « puissance de vie » du territoire, celle de la mer, de ce pays noyé, y compris lorsque cette puissance est celle des cyclones et des catastrophes. C’est ce que fait de manière très belle le livre de Frank Smith : chercher la vie même dans la mer qui engloutit tout, dans les forces de la mer, des marais, dans l’érosion marine d’un pays qui disparaît, dans ce cosmos indien de la Louisiane que Frank Smith appelle la « Louisiane originelle ». Et c’est de même ce que font les individus du livre, tant leur existence ne se distingue pas d’un agencement qui les dépasse avec le monde et la vie dans toutes leurs dimensions plurielles et parfois violentes, mortelles – ce qui n’a rien à voir avec une sagesse de pacotille, pas plus qu’avec une triste résignation, encore moins avec le fighting spirit, mais a tout à voir avec les philosophies violentes de la vie, de l’immanence de la vie, celles par exemple de Spinoza ou de Nietzsche…
A chaque fois, à chaque catastrophe, chaque jour, il faut recommencer, chaque jour nouveau étant un recommencement : « Une eau courante, qui cimente tout entre eux, finally. On reconstruit, à chaque fois. On ne sait pas faire de maisons trop solides, on ne sait pas tracer de piste définitive non plus. Suivre un canal une fois pour toute. C’est Chris qui colmate à longueur de journée sa cabane à outils, qui procède par poussée et craquement (…). On recommence après chaque ouragan. On reprend ce qui avait été fait jusque-là et puis on continue. On regarde, cela fuit de partout ». Mais ce n’est pas seulement l’ouragan régulier qui oblige à recommencer, c’est chaque jour qui est un recommencement et contraint à recommencer – à répéter un commencement qui par définition n’a jamais lieu : « Ils attendent le coucher du soleil à longueur de journée, pour recommencer le lendemain ». Il n’y a pas de commencement, il y a toujours un recommencement, une répétition de l’événement, de la différence (« On refait tout encore comme si rien n’avait été – ever ! »). C’est-à-dire aussi un temps qui n’est pas linéaire, historique, mais qui est répétition, retour de la répétition et de la différence, par lequel le monde ne commence jamais mais recommence sans cesse, se maintient dans son commencement, ses bifurcations. Nous sommes loin de la terre ferme américaine, nous sommes là où la terre ferme américaine est envahie par les eaux, les lacs, où elle est quotidiennement détruite, où elle « fuit de partout ». A l’Isle de Jean Charles, même les maisons sont flottantes…

Pour l’écrivain Frank Smith, l’Isle de Jean Charles est aussi une expérience du langage, de la langue, l’expérience d’une écriture qui déborde de ses cadres habituels, supposément fixes, envahie elle aussi par les eaux. Cette expérience concerne d’abord le singulier bilinguisme des habitants du lieu dont la langue est une articulation particulière du français et de l’anglais : ceux-ci ne parlent pas seulement français et anglais, mais le bilinguisme de leur langue – dans leur langue – est un mélange de français et d’anglais, un effacement des frontières entre les deux langues pour la création d’une troisième langue inédite, avec son glissement constant d’une langue sur l’autre, leur envahissement réciproque par lequel, là aussi, chacune fuit et s’inscrit dans un agencement inédit. Ce bilinguisme fait donc moins référence à la maîtrise de deux langues distinctes qu’à un bilinguisme interne à la langue, une langue bilingue, présente dans le livre, par laquelle la langue est ouverte au mouvement, à la circulation d’une langue à l’autre – langue faite de différences, langue de l’autre par laquelle le système de la langue fuit, se défait, recommence autrement, ailleurs, selon une autre histoire, d’autres subjectivités…
Mais cette expérience de la langue ne se réduit pas à ce bilinguisme original. Elle concerne le lieu lui-même, et les forces qui le traversent et le constituent. Dans Katrina, l’Isle de Jean Charles est aussi, dans sa matérialité, une grammaire (« Tu aimes comment l’île, et où, quand et pourquoi. Tu te familiarises avec sa grammaire. Une énergie »). Le paysage, son érosion, le parcours des routes, les paroles rencontrées au hasard, les catastrophes omniprésentes, sont autant de traits d’un langage qui est celui de l’écriture. Frank Smith ne cherche pas – ou ne traduit pas – dans l’Isle de Jean Charles une image d’un langage possible : l’Isle de Jean Charles est plutôt l’expression d’un langage, d’une langue qui est celle de l’écriture et qui trouve dans la matérialité du lieu les principes de son fonctionnement autant que de son dysfonctionnement : un langage sans frontières fixes, un langage de la circulation, un langage qui ne dit pas le monde, qui ne le maîtrise pas, mais qui parcourt la nouveauté du monde, qui glisse le long de son recommencement incessant. Ecrire ne serait donc pas dire le monde mais agencer la langue et la vie du monde...
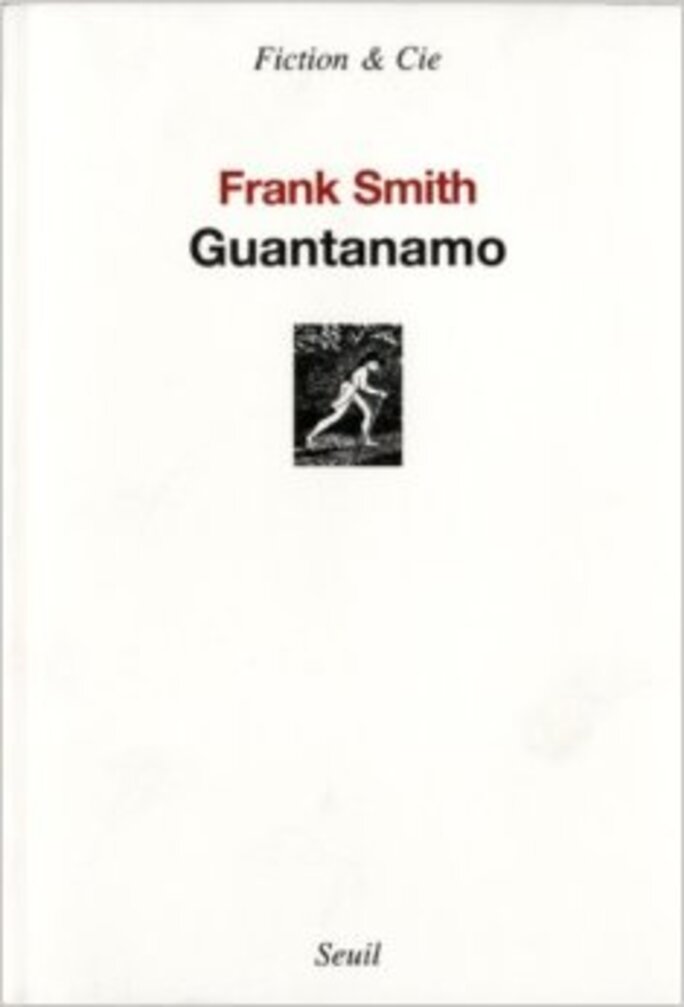
Il arrive par exemple que l’auteur, dans Katrina, établisse des listes : listes de noms de personnes, de noms de lieux, des listes de définitions de ce qu’est une île. Sans doute s’agit-il de souligner qu’un lieu géographique est aussi un ensemble de noms et de mots, qu’il est donc aussi du langage, pris dans une langue qui le dit, le nomme et l’organise. Mais les listes, pourtant, loin d’épuiser de manière exhaustive le lieu, de dire ce qu’il est, ouvrent le lieu à l’indéfini et à la circulation qui sont l’indéfini et la circulation de la langue – un mot se rapportant sans cesse à d’autres mots, une liste n’étant jamais close, d’autant moins lorsqu’elle est supposée dire ce qui en lui-même ne cesse de se modifier, de vivre selon un le temps d’un devenir sans fin – le monde, la vie vivante du monde. Faire des listes, c’est circuler dans la langue, c’est-à-dire on the road sur une route toujours ouverte, qui est plusieurs routes en même temps, qui bifurquent et changent, route donc nécessairement inachevée pour un monde nécessairement inachevé (« Dans la liste, le etc. est inévitable, on ne peut pas tout déblayer, inventorier »). Mais faire une liste c’est en même temps circuler dans le monde, faire du monde une circulation à l’intérieur de laquelle le monde n’est jamais dit mais est parcouru, rendu à son indétermination, à son infinité – le monde comme un etc. Chez Frank Smith, la liste vaut ainsi comme expression du langage de l’écriture, comme ce qui en rassemble les traits caractéristiques, la dissolution fondamentale du monde qu’elle rend à la vie.
Katrina est indissociablement un livre poétique, politique, éthique. Un livre où est dite la survie du peuple de l’Isle de Jean Charles, où est accueillie la survivance de ce peuple sans doute voué à la disparition mais survivant ici, dans le livre, pour toujours. Katrina serait aussi la recherche d’un langage qui ne serait pas du pouvoir, un langage du monde et de la vie, une parole de résistance. Katrina serait enfin le livre de l’Isle de Jean Charles, livre écrit par les habitants, par leur errance sur place, indéfiniment recommencée, qui est l’errance du monde – livre écrit par le lieu lui-même, selon sa topologie mobile : une écriture qui est une cartographie de la vie et du monde vivant. L’Isle de Jean Charles serait ainsi le nom d’un écrivain, d’une écriture, dont un autre nom serait aussi Frank Smith…
Frank Smith, Katrina, Isle de Jean Charles, Louisiane, éditions de l’Attente, 2015, 132 pages, 11 €.



