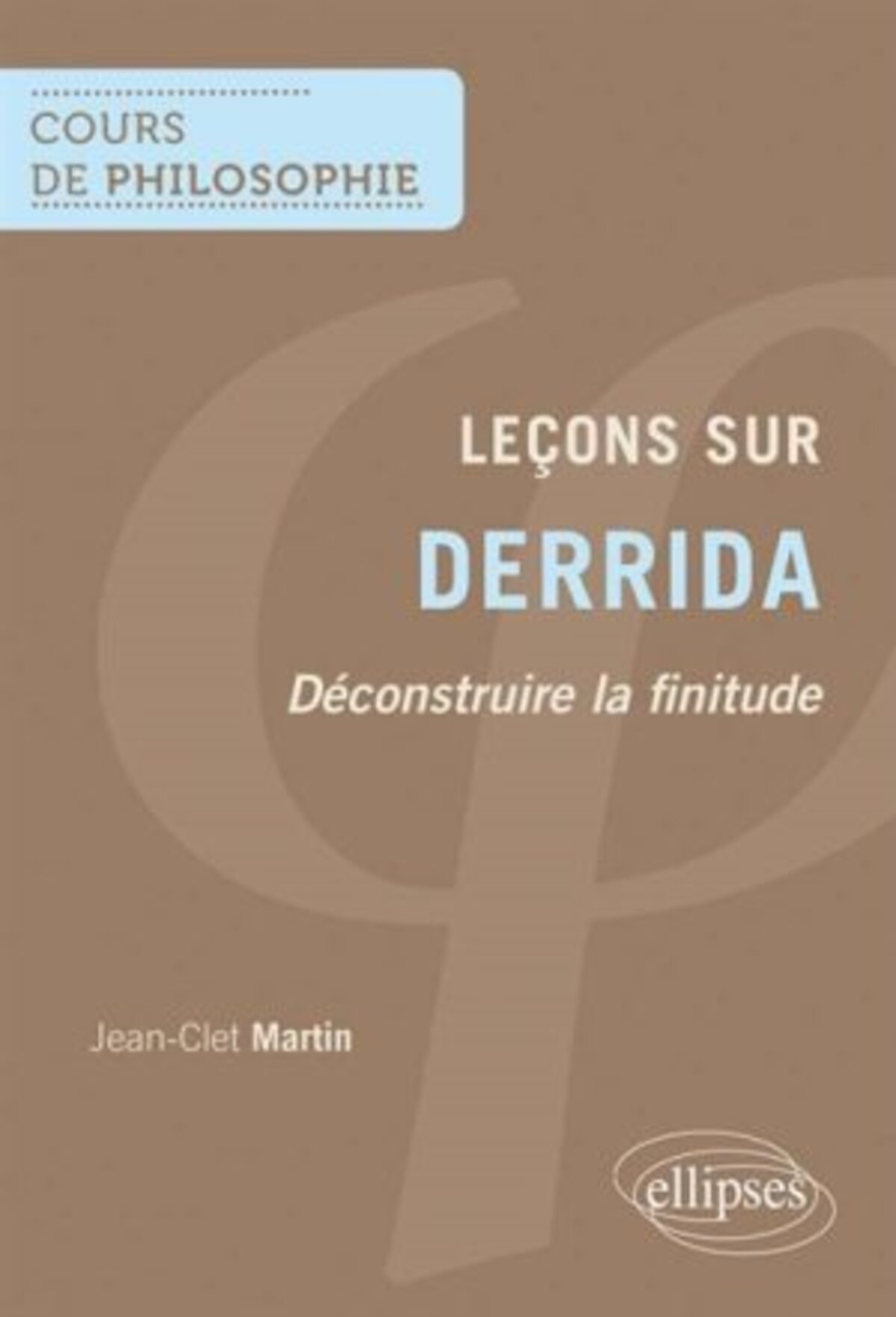
Alors que livre précédent de Jean-Clet Martin était déjà consacré à Jacques Derrida, avec Leçons sur Derrida, il retrouve le philosophe français et revient sur certains aspects de sa pensée en en proposant un panorama différent.
Si le livre a pour titre Leçons sur Derrida, il ne faudrait pas en conclure qu’y est exposée la philosophie de Derrida selon les standards scolaires et universitaires habituels, ni que cette philosophie y est réduite à quelques principes généraux permettant d’en embrasser la totalité. Il y a un certain humour à intituler Leçons un livre consacré à un penseur comme Derrida, que l’institution universitaire française n’a jamais reconnu. S’il est possible de faire cours sur Derrida, comme sur Descartes ou Kant, n’est-ce pas que l’absence de reconnaissance de Derrida dans l’Université française tient davantage à l’aveuglement de celle-ci qu’au manque de consistance de la pensée du philosophe ?
Mais l’humour pourrait aussi concerner le fait que si la pensée de Derrida peut faire l’objet de cours, cela n’est possible qu’à condition de sortir des cadres habituels d’un cours en subvertissant la logique universitaire : dispenser des leçons sur Derrida implique que l’on sorte du cadre de la leçon pour faire autre chose où il s’agit d’abord de désapprendre et de se perdre.
Jean-Clet Martin souligne que s’aventurer dans la philosophie de Derrida conduit à « transgresser certaines habitudes », à « se sentir porté par un vent risqué ». Lire les textes de Derrida ou suivre des leçons sur Derrida n’aurait pas pour but de « faire preuve d’un savoir et entrer dans le prestige de celui qui retient une leçon » : « Lire n’est pas tellement comprendre ce qu’il faut retenir d’une tradition », la lecture ou la leçon n’étant pas ici l’occasion d’une connaissance, de l’acquisition d’un savoir comme on peut acquérir une technique ou le contenu d’une discipline. Rencontrer la pensée de Derrida, par la lecture des œuvres, par des leçons sur Derrida, implique d’abord de faire l’épreuve d’une nouveauté et d’un danger pour les habitudes, pour la pensée – l’immersion dans un paysage nouveau et qui ne laisse pas intact.
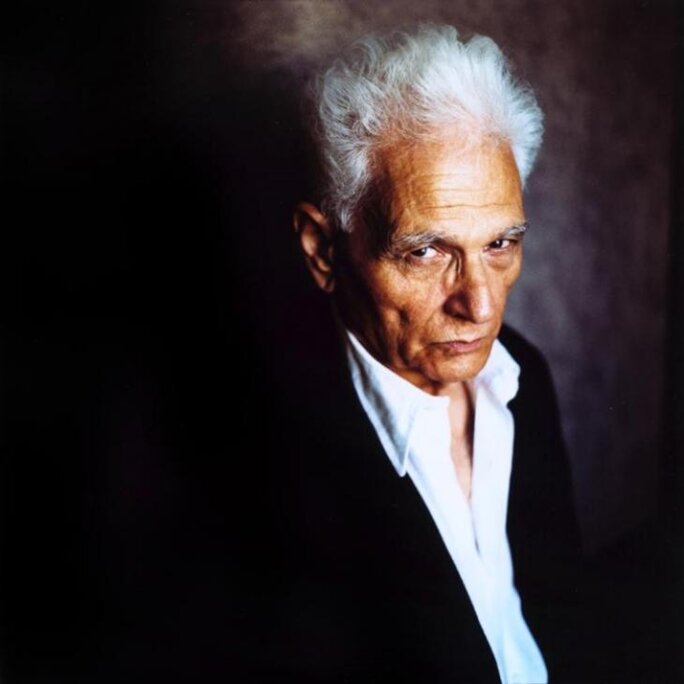
Agrandissement : Illustration 2
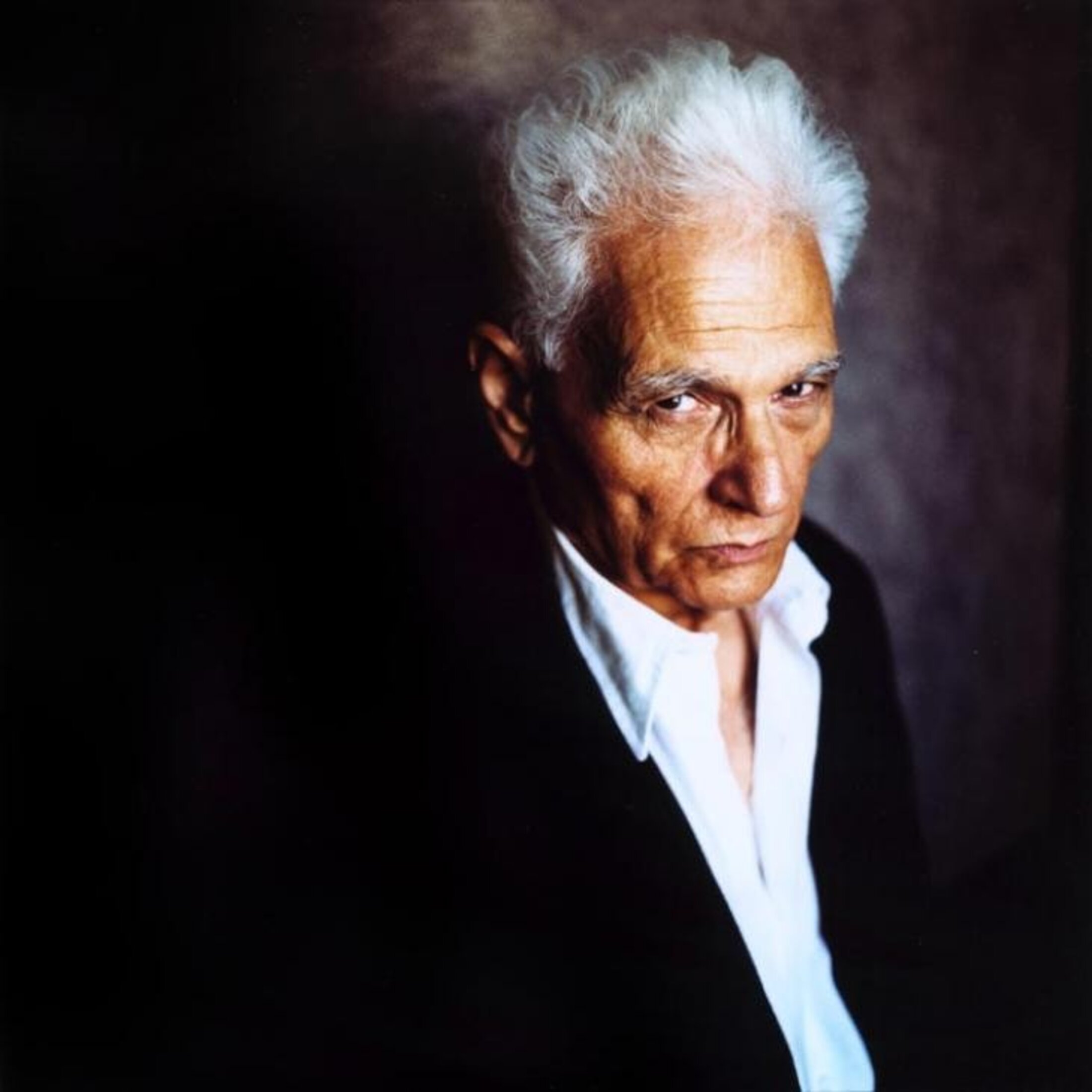
En effet, si de manière classique on peut trouver chez Derrida un travail approfondi sur d’autres philosophes que la tradition a sanctuarisés, ce travail en produit une image très nouvelle par laquelle apparaît ce que nous n’avions jamais vu : non seulement une compréhension renouvelée mais surtout « des effractions, des lézardes », des marges qui étaient là, nécessaires à la pensée de l’auteur, impliquées par elle, mais qui n’avaient pas été dites ni par lui ni par personne. Au lieu de regarder la lumière de l’œuvre, Derrida en regarde l’ombre, les ombres. Au lieu d’en rester au système et à ce que le pouvoir de la tradition en a retenu, il est attentif à ce qui soutient le système autant qu’il le fait fuir, le fissure. Par là apparaît une autre pensée, d’autres conditions pour la pensée, d’autres paysages auxquels l’institution n’avait pu qu’être aveugle.
Dans ces conditions, des leçons sur Derrida s’apparentent, de manière presque socratique, à un ébranlement, une sorte de secousse par laquelle se fissure, se déplace, et parfois s’écroule ce qui est institué comme savoir, ce que l’on croyait connaître, ce que l’on espérait apprendre. Cette attention aux marges invisibles et invisibilisées, aux traces silencieuses qui habitent les pensées et qui, lorsqu’elles émergent pour elles-mêmes, ne peuvent que fendre et transformer ce qu’elles habitaient pourtant déjà – cette attention est caractéristique de la pensée de Derrida mais n’est pas seulement le moyen renouvelé d’une critique : elle est aussi ce qui produit une pensée nouvelle et des conditions nouvelles de la pensée.
Jean-Clet Martin insiste sur cette nouveauté de la pensée de Derrida et sur l’épreuve du nouveau à laquelle cette pensée conduit, non seulement dans son contenu mais d’abord dans la nouvelle image de la pensée qu’elle implique. Il n’y a pas d’essence éternelle de la pensée, mais des images de la pensée que la pensée actualise, ignore, critique ou remplace. Ce que montre le livre de Jean-Clet Martin, c’est que l’image de la pensée liée à la philosophie de Jacques Derrida appelle de manière essentielle un travail sur la finitude et à repenser la finitude de manière critique.
L’idée de finitude définit les limites auxquelles l’Homme ne cesse de se heurter et qui, au moins depuis Kant, circonscrivent ce qu’il peut faire, connaitre et être. Analysant cette idée, Foucault avait montré comment, historiquement, l’apparition de la figure de l’Homme est indissociable de l’idée de finitude, celle-ci n’étant pas simplement ce qui permet de penser l’Homme mais ce qui donne une existence et un sens à ce que nous entendons par Homme. En déterminant chez Derrida l’importance de la pensée de la finitude, Jean-Clet Martin montre comment celui-ci, de manière récurrente et patiente, ne cesse de reprendre ce qui est en jeu dans la philosophie kantienne, mais aussi comment il se situe à l’intérieur d’une problématique fondamentale – pour ne pas dire fondatrice – de la pensée contemporaine dans ce qu’elle a d’important, c’est-à-dire de nouveau : Heidegger, Freud, Nietzsche, Foucault, Deleuze, Derrida, Lyotard, Adorno et d’autres pourraient être réunis, bien que leurs œuvres soient très différentes et dans certains cas antagonistes, autour de cette volonté de repenser après Kant la finitude, d’en refaire la généalogie, d’en redessiner la carte, de subvertir son architecture pour penser autre chose et autrement.
Il ne s’agit pas d’espérer, par-delà Kant, revenir à une espèce d’absolu, à la croyance que nous pourrions ignorer ce que la finitude a de constitutif. Ce retour sur l’idée de finitude et le travail sur cette idée que l’on rencontre chez Derrida prennent plutôt la forme d’une problématisation de la limite, d’une attention aux limites non pas simplement pour en reconnaître l’existence – limites de la pensée, de la raison, du corps, de l’identité, du politique, de l’histoire, du langage, etc. – mais pour à la fois en interroger le passé, la construction, l’efficience, et les possibles déplacements, les possibles désarticulations : « Derrida va tout mettre en œuvre pour trouver des issues, des écarts, des différences capables de repousser la limite, la frontière de la finitude ». Il s’agit donc moins de sortir de la finitude que d’en brouiller le paysage pour en produire d’autres, nouveaux et mobiles, rendant possible d’autres rapports à l’être, au monde et à soi. C’est ce rapport subversif à la finitude qui implique chez Derrida une nouvelle image de la pensée et une nouvelle façon de penser que l’on a pu appeler « déconstruction », à condition de comprendre que la déconstruction n’est pas synonyme purement et simplement de « destruction » mais qu’elle est d’abord une pensée de la limite, un art des limites et de leur mobilité.
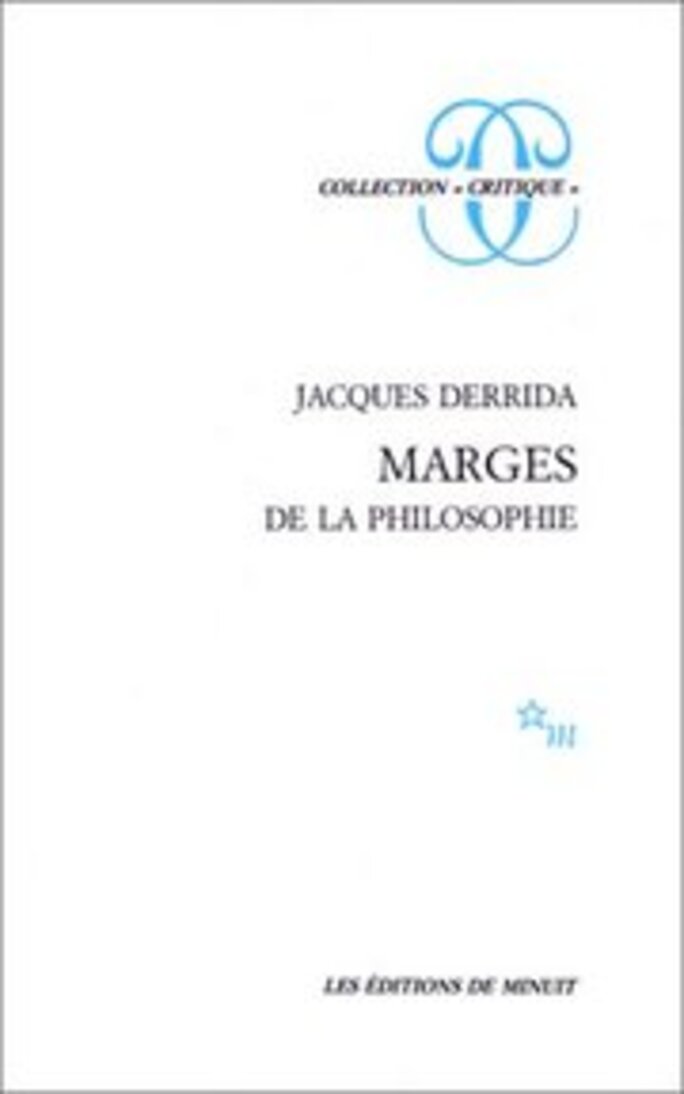
C’est dans cette optique que Derrida développe une attention particulière aux « marges » – non à des marges qui seraient extérieures à la philosophie, par-delà la pensée ou l’être, mais à celles que paradoxalement la pensée implique en elle-même, l’extérieur que chaque système ne peut pour exister qu’impliquer tout en le niant (la marge sur une page n’est pas extérieure à celle-ci, elle en est le bord, la zone ignorée mais nécessaire à l’organisation interne de la page).
Cette exploration des marges prend chez Derrida diverses formes que Jean-Clet Martin analyse tout au long de son livre et relie entre elles. De même, cette exploration ne va pas sans l’invention de nouveaux concepts, de renversements conceptuels, de subversion de la pensée instituée pour la création d’une nouvelle pensée. C’est tout ce travail de critique et d’invention que Jean-Clet Martin parcourt également pour en souligner le sens et l’importance à travers l’analyse de certains des concepts les plus étranges et paradoxaux de l’œuvre de Derrida ainsi que leurs conséquences théoriques et pratiques. Enfin, Jean-Clet Martin montre comment cette nouvelle pensée qui est à l’œuvre chez Derrida ne va pas sans le souci d’une langue et d’un style philosophiques nouveaux, une matérialité nouvelle de la langue et de l’écriture qui, de manière centrale et continue, préside à l’élaboration chez Derrida de textes surprenants non seulement par leur contenu conceptuel mais aussi par leur langage, leur forme et leurs conditions.
La pensée de Derrida se présente comme un débordement incessant des limites instituées, comme un déplacement répété des frontières de l’être, de la pensée, du monde, ouvrant sans cesse de nouvelles perspectives critiques – sur l’Homme, le corps, l’animal, l’ontologie, le politique, etc. –, autant qu’elle propose une nouvelle intelligence de ce qui est et de ce qui peut être. On comprend que l’Université française voit tout cela d’un mauvais œil…
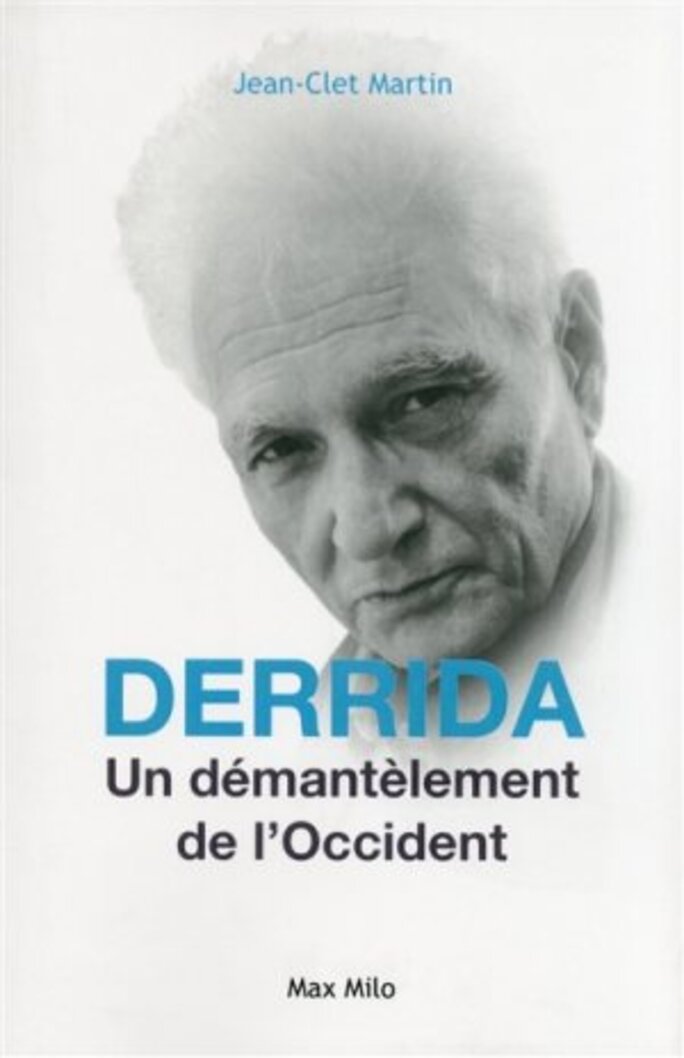
Si, à l’intérieur de cette entreprise philosophique majeure, Derrida tisse des liens complexes avec d’autres penseurs importants – Hegel, Nietzsche, Heidegger, Rousseau, Nancy, etc. – Jean-Clet Martin souligne certains des points sur lesquels l’œuvre de Derrida rencontre, également de manière complexe, les préoccupations et problèmes d’autres philosophes contemporains fondamentaux, tels que Deleuze ou Foucault – ce qui pourrait bien sûr paraître paradoxal, voire hérétique, pour les nouvelles Eglises deleuziennes et foucaldiennes, étrangement disposées à établir des limites frontalières et des miradors entre des penseurs qu’il ne s’agit certes pas d’assimiler, mais à partir desquels une reprise commune est possible, voire souhaitable.
Si ce livre de Jean-Clet Martin se présente comme un ensemble de leçons sur Derrida, permettant à l’étudiant de s’initier à son œuvre, il ouvre aussi, par le rappel éclairé de la dynamique qui est l’œuvre dans ses textes et en en parcourant la logique multiple, des perspectives pour une pensée contemporaine. Il s’agit donc d’un véritable livre de philosophie où se dessinent une nouvelle image de la pensée, de nouvelles directions, et la promesse d’œuvres à venir.
Jean-Clet Martin, Leçons sur Derrida – Déconstruire la finitude, éditions Ellipses, 2015, 285 pages, 29,50 €.



