« Quand j’avais franchi le grand portail en fer de l’hôpital, je devais être encore vivant». Ainsi commence la fiction d’Ahmed Bouanani, L’hôpital. Qui peut écrire cela ? Un mort ? Comment un mort pourrait-il écrire ? Cette phrase ouvre un espace-temps singulier où les repères habituels laissent place à un univers régi par d’autres principes étranges. Nous sommes passés ailleurs – mais où ?
La nature de l’hôpital en question n’est pas claire : hôpital général ? psychiatrique ? hospice ? S’y trouve réunie une population hétéroclite, plus ou moins marginale — comme le jardin de ce même hôpital : « ensemble de flores absolument dissemblables ». Son espace est à la fois quadrillé et instable, réglé et chaotique, concentrationnaire et ouvert à la folie du dehors, celle des éléments, des oiseaux, du jardin (« caprice de jardinier en délire »). Il est aussi troué par une autre folie, interne : le délire de l’imagination, du souvenir, du corps, des discours, des rêves, de la fiction que chacun suscite ou invente. Le temps de l’hôpital, comme le temps du livre, est ordonné selon une succession monotone mais aussi traversé d’un désordre par lequel ses dimensions s’inversent, le passé et le présent basculant l’un dans l’autre : un délire du temps où la mort et la vie sont moins distinctes que contemporaines et diffuses — un temps « hors de ses gonds », comme Shakespeare le fait dire au jeune Hamlet lorsque celui-ci, face à la figure de son père mort, fait l’expérience de cet entre-deux de la mort et de la vie.
Le texte d’Ahmed Bouanani est d’abord constitué de ces paradoxes : paradoxes du sens, paradoxes du temps, de l’espace, des situations, des corps, de la pensée. Paradoxes de la narration qui ouvrent le lieu étrange de ce livre. Ce lieu n’est-il pas, par définition, celui de la fiction ? La fiction n’est pas une transposition de la réalité, le résultat d’une imagination plus fertile : l’écriture de fiction transforme la disposition habituelle des choses et de la pensée, elle introduit des paradoxes et anime d’une vie nouvelle – et mortelle – la réalité de la pensée et du monde. « Quand j’avais franchi le grand portail en fer de l’hôpital, je devais être encore vivant» – ceci ne peut être que l’énoncé d’une fiction, puisqu’il appartient à l’écriture de fiction de pouvoir dire le plus paradoxal. Si l’écriture n’est pas assimilable à l’usage commun de la langue, elle n’en est pas non plus simplement un usage différent mais réductible à la même logique. La fiction introduit dans le monde et la pensée une logique perturbatrice, distincte des catégories communes de l’expérience, de la pensée, de l’existence : logique des paradoxes créatrice d’une autre existence du monde et de la pensée. C’est cette puissance de l’écriture qui est aussi l’objet du roman d’Ahmed Bouanani, qui est parcourue, exposée, développée de manière rare et belle.
Tout est marqué du signe de la fiction. Il y a l’atmosphère étrange, à la limite du fantastique, dans laquelle baigne le livre : la porte d’entrée de l’hôpital n’est plus repérable, les médecins sont étrangement absents, la mort rôde, etc. Par-delà certains éléments qui raccrochent le récit à une dimension réaliste, sociale et politique, l’auteur multiplie les signes d’une étrangeté qui est celle de la fiction et de l’imaginaire. L’hôpital semble être un hôpital fictif, servant une finalité que l’on ignore, plutôt qu’un véritable hôpital. Les infirmiers sont plus proches de tortionnaires, de fous ou d’assassins que d’infirmiers (« des hommes en blanc se matérialisant dans des hurlements de meute enragée »). Les objets eux-mêmes semblent fictifs : les médicaments seraient peut-être des poisons, et le chauffage est bien installé mais n’a jamais fonctionné, etc. Tout semble faux, distinct de ce qu’il est supposé être et évoluant dans une autre dimension de la réalité – ou du délire, ou du rêve – dont la logique échappe et semble impliquer un monde flottant, sans identités, confus, vague, mobile.
Les divers personnages ont des noms fictifs : le Pet, le Litron, Argane, O.K., le Corsaire, etc. Et chacun d’eux porte ou produit des fictions : mensonges, affabulations, faux souvenirs – chacun invente ou mime une réalité qu’il n’est pas, qui n’existe pas :
« Une serviette en guise de tablier, Argane portant un plateau imaginaire, s’incline devant le Pet qui a fini par s’affaler sur son lit.
- Le scotch de Monsieur !
Le Pet se prête au jeu. Il fait semblant de prendre le verre qu’il secoue, hume d’un air connaisseur, avale une gorgée, grimace.
- Hmm ! c’est du vrai, je parie que ça vient de Scotland ! »
Le roman lui-même est composé essentiellement de fictions diverses, de visions nocturnes, de faux souvenirs, de récits hallucinés, de cauchemars produits soit par le narrateur, soit par les divers personnages – à moins que les personnages eux-mêmes ne soient des visions, des silhouettes fantomatiques hallucinées par le narrateur (« je concevais moi-même mes petits compagnons »). La « réalité » qui est décrite est toujours incertaine, oscillant entre l’imaginaire et le rêve qui ne se distinguent pas de ce qui paraitrait réel : « Je ferme le bouquin et je pense à Blaise Cendrars, je lui dis : ‘Emmène-moi au bout du monde !’ Il me prend avec son unique main et nous voguons en pirogue, sous les racines des palétuviers, à travers des jungles, des brouillards […]. Soudain, au bout de quelques pages, nous accostons à Paris, boulevard Exelmans ».
Le roman porte d’autant plus le signe de la fiction que le narrateur est supposé être l’écrivain lui-même, que le livre que nous lisons est présenté dans le roman comme étant écrit par le narrateur lors de son séjour dans l’hôpital. Le roman que nous lisons est donc supposé être écrit lors d’un séjour dans un hôpital qui, tel qu’il est décrit dans le roman, ne peut avoir eu lieu (le livre lui-même mime ce qu’il n’est pas). Donc, le roman que nous lisons n’est-il pas lui-même fictif, fictionnel, livre imaginaire, livre rêvé ? Que lisons-nous exactement ? Qu’avons-nous entre les mains et devant les yeux ? « Vous ne saurez jamais si vous rêvez ou si vous êtes dans la réalité » dit au narrateur un médecin apparu en rêve ou lors d’une hallucination : lisant le roman d’Ahmed Bouanani, la question se poserait : ce livre existe-il dans la réalité, ne serait-il pas un livre rêvé, un livre lu en rêve ? Ouvrant ce livre ne suis-je pas pris moi-même dans « l’hôpital » ?
Si les personnages ne sont peut-être que des hallucinations (« Ce fut alors que le Corsaire se matérialisa devant moi » ; « les voyageurs, à travers les vitres embuées, paraissent effroyablement irréels »), ils sont surtout et avant tout des êtres de langage. Ceci, évidemment, ne devrait pas surprendre, puisque le personnage de roman est d’abord un être de langage. Cependant, la structure du roman et l’agencement des scènes et apparitions des personnages insèrent ceux-ci dans des dispositifs de langage où ils n’apparaissent que pris à l’intérieur du récit d’un rêve, d’une hallucination, du récit d’un souvenir, lorsqu’ils produisent eux-mêmes un récit qui les met en scène ou qu’ils sont présentés directement comme des personnages. Loin de tout effet de réalisme, le récit insiste au contraire sur le caractère fictionnel de ce qui est lu : les images, le style, les personnages, la construction signalent sans cesse la présence de la fiction.
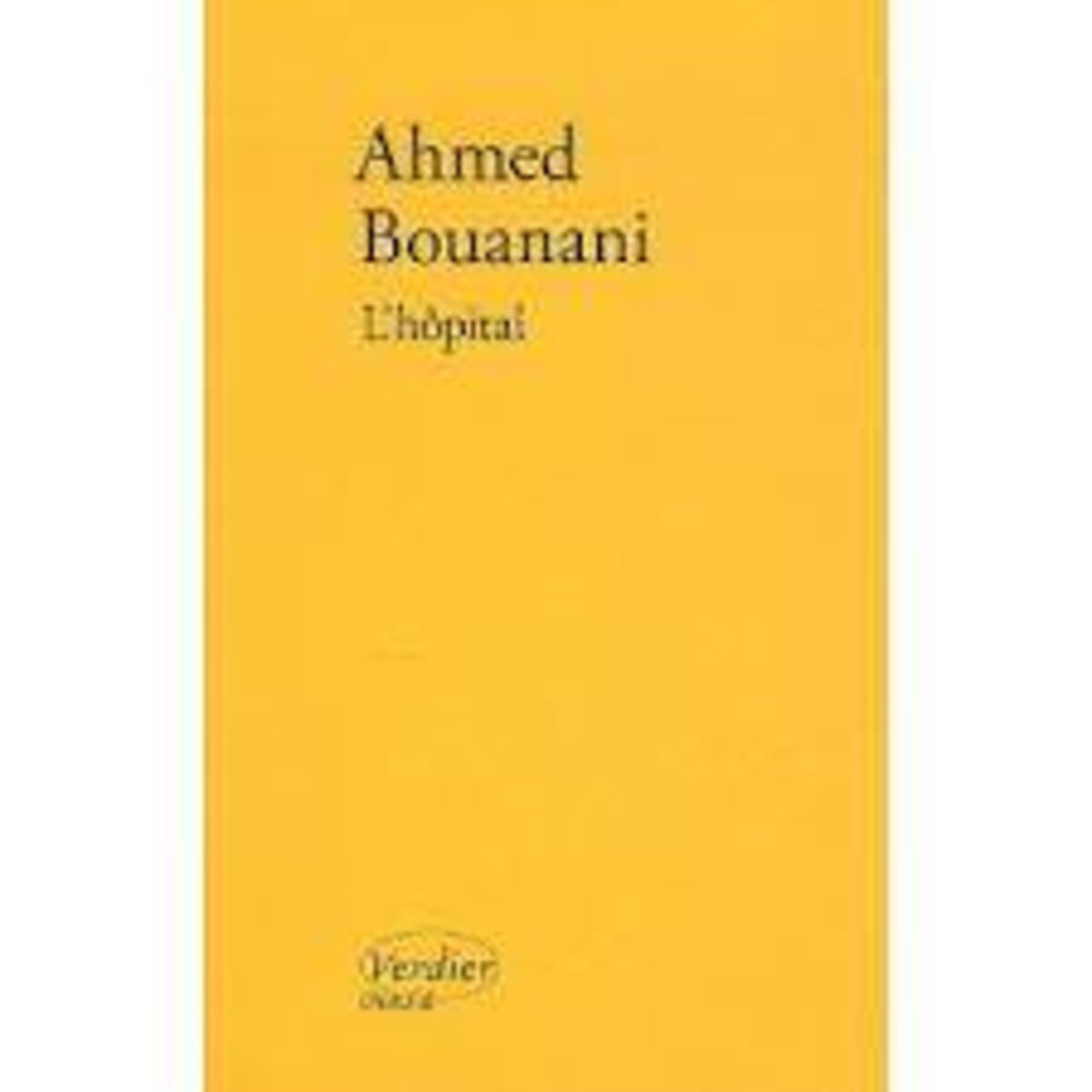
Si ce livre développe les pouvoirs de la fiction, c’est que s'y diffusent le temps et la mort. Le temps n’est pas uniquement l’ordre monotone d’une succession et la mort n’est pas uniquement ce qui, distinct de la vie, en serait le terme : si le temps qui passe nous rapproche d’une mort certaine que, comme les patients de l’hôpital, nous attendons, il est aussi ce qui ne cesse d’introduire la mort dans l’existence, ce qui fait qu’exister c’est mourir sans cesse. Dans L’hôpital sont présentes toutes ces dimensions du temps et de la mort : l’ordre réglé et monotone selon lequel l’hôpital est organisé, selon lequel chaque jour succède au précédent et rapproche d’une mort que les patients attendent, redoutent, miment, ou à laquelle ils rêvent. Et le temps et la mort s’incarnent régulièrement, de manière tout aussi mécanique, dans les cadavres qui sont rapidement évacués. Mais le temps est aussi ce qui fait que nous mourons sans cesse, que chaque chose meurt sans cesse et diffère d’elle-même. Se souvenir de son enfance, du temps révolu de son enfance, ce n’est pas se souvenir de soi mais se trouver face au cadavre de celui que l’on n’est plus. Les paysages de son enfance sont des ruines où affleurent les rares signes d’une vie lointaine, presque morte elle aussi. Par le temps nous ne cessons de mourir, c’est-à-dire de n’être plus ce que nous étions, le temps est ce qui parsème le chemin de chaque vie d’autant d’étrangers morts que nous contemplons en les reconnaissant comme d’autres nous-mêmes, des êtres lointains flottant à la surface du souvenir comme des noyés. Et le futur de notre mort n’est pas simplement ce qui attend au bout du chemin : ce futur est aussi ce qui nous projette dans un état autre de nous-même, un état dans lequel nous ne serons plus ce que nous sommes et qui fait que les patients de l’hôpital sont déjà des cadavres en décomposition, que l’hôpital est déjà un cimetière.
Le temps et la mort sont ce qui introduit dans l’existence, dans la pensée et dans le monde, la dimension de la fiction : la fiction n’est pas essentiellement un genre littéraire, elle est une dimension du monde et de la pensée. C’est cette dimension qui est développée dans ce roman : rien n’est fixe, tout diffère de soi, tout est autre chose que ce qu’il a l’air d’être. Le fictif, le faux, le fictionnel ne sont pas l’indice d’un monde imaginé ou mensonger, illusoire, distinct de la réalité et de la vérité : ils sont la réalité du corps, de la pensée et du monde perçue du point de vue du temps et de la mort, point de vue qui produit un monde et une pensée qui, fondamentalement, n’ont pas de rapport avec la réalité et la vérité mais seulement avec la fiction, l’imaginaire, le délire, le faux. Le temps et la mort ne sont donc pas réductibles au temps qui passe et au cadavre : le point de vue du temps et de la mort est aussi celui d’une puissance vitale pour un autre monde, une autre pensée.
Ainsi, « l’hôpital » n’est pas ici le symbole de quoi que ce soit et l’on ne cherchera pas dans le roman une signification mais plutôt un mouvement, celui du temps, de la mort, du devenir qui fait devenir autre et étranger à soi, mouvement de mort autant que mouvement de vie. « L’hôpital » serait une sorte de signifiant flottant, irréductible à l’identité d’une signification mais ouvert à la variation, aux différences (ou différances, pour reprendre un terme de Derrida) qu’il traverse et réunit de manière multiple : à la fois espace concentrationnaire, concentré de l’humanité, métaphore de la société marocaine ou de la condition humaine, traduction romanesque de délires du corps et de la pensée, etc. Il est tout cela à la fois et d’autres choses encore : irréductible à aucune en particulier et ne cessant de différer de lui-même selon des lignes et boucles complexes par lesquelles il traverse plusieurs dimensions de la réalité et du sens. On cherchera d’autant moins une signification à ce roman qu’il est d’abord fait du mouvement du temps et de la mort, « un morceau de temps à l’état pur » selon la formule proustienne : mouvement du temps et de la mort, mouvement des paradoxes du monde et de la pensée qu’ils impliquent. Une sorte de chef-d’œuvre.
Ahmed Bouanani, L’Hôpital, éditions Verdier, collection Chaoïd, 120 p., 12€30.



