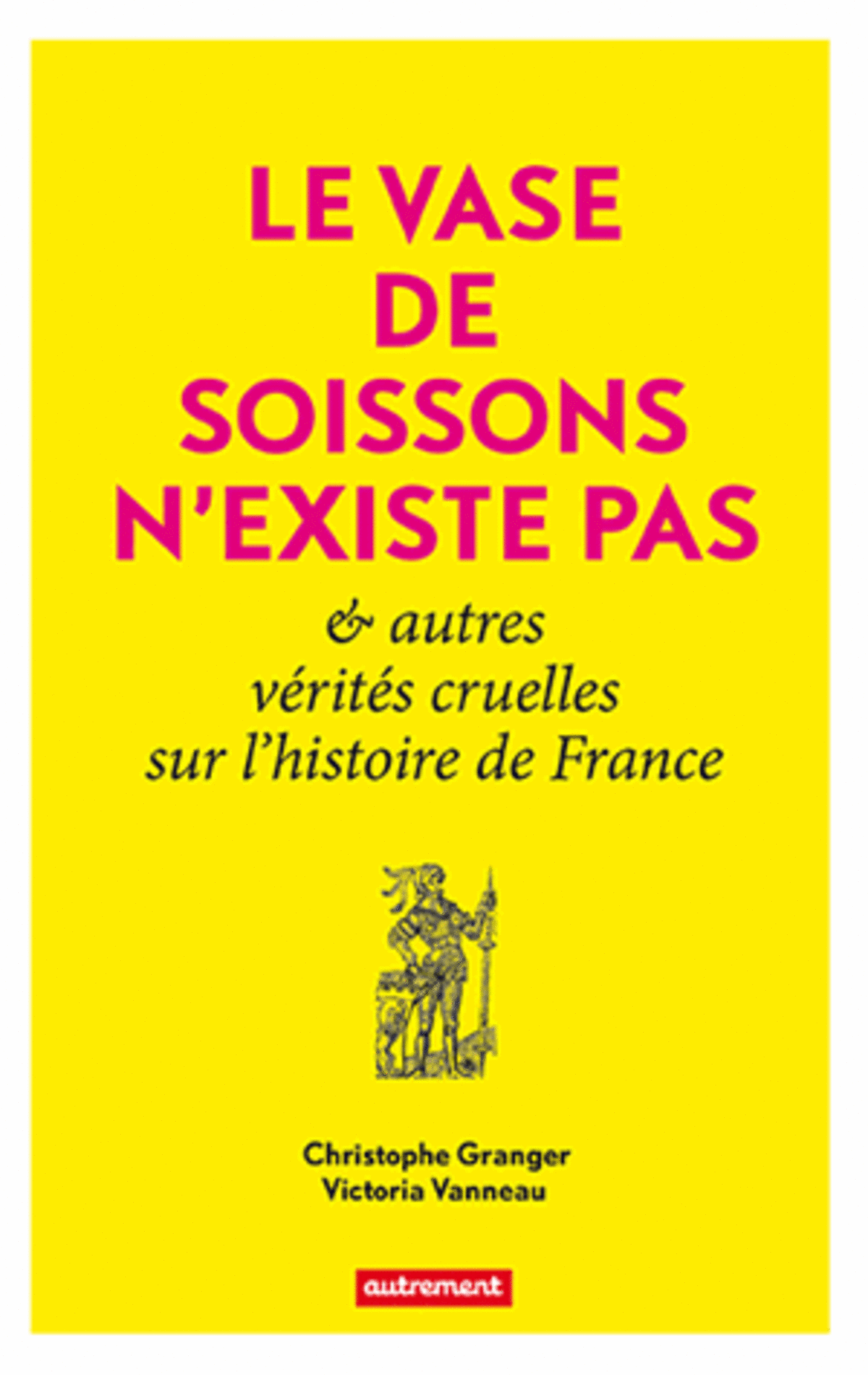
En préambule il convient de dire que si cet ouvrage souligne les incohérences de l’histoire dite officielle, les deux auteurs, Christophe Granger, historien, et Victoria Vanneau, historienne du droit, incarnent à eux deux les incohérences du système universitaire français, puisqu’après avoir enseigné dans une bonne dizaine d’universités et écumé la plupart des statuts précaires que l’Université engendre avec tant d’habileté budgétaire, ils sont désormais chômeurs des universités. Christophe Granger a publié, en 2009, Les corps d’été, XXème siècle. Naissance d’une variation saisonnière, Editions Autrement, ainsi que A quoi pensent les historiens ? en 2013, dans la même maison d’édition.
L’ouvrage conjointement signé La vase de Soissons n’existe pas & autres vérités cruelles sur l’histoire de France recense et analyse quinze évènements qui ont été ancrés dans les esprits de plusieurs générations d’écoliers, en démontrant que ces mêmes faits ont été parfois embellis, tantôt transformés et, très souvent, purement et simplement inventés de toutes pièces. En suivant l’ordre chronologique, les deux auteurs ont passé, successivement, au microscope de leurs vérifications le bouclier de Vercingétorix, le vase de Soissons, la culotte du roi Dagobert, la couronne de Bouvines, l’étendard de Jeanne d’Arc, la ceinture de chasteté, les ferrets de la reine, le masque de fer, le godemiché de Marie-Antoinette, le sou de Varennes, la chapeau de Napoléon, la chasse-mouches du Dey d’Alger, le parapluie de Louis-Philippe et le pantalon des poilus.
Les historiens des XVIIIème et XIXème siècles semblent porter une large responsabilité de ces transformations par lesquelles ils ont revisité l’histoire dans un but de propagande nationaliste. Le bouclier de Vercingétorix, par exemple, s’avère une légende martelée dans l’imagination de générations d’écoliers de façon totalement erronée et aux antipodes de la réalité des faits. La défaite d’Alésia est une scène presque glorieuse, « presque une victoire » ironisent les deux auteurs. Vercingétorix aurait lancé fièrement ses armes et son bouclier aux pieds de César, qui en aurait été effrayé. Héros de la nation, immortalisé en 1968 par un album d’Astérix, Vercingétorix symboliserait la Gaule résistante. L’ennui est qu’en 52 avant J.-C. la Gaule n’existe pas. La France d’alors était faite d’une multitude de peuples, Eduens, Arvernes, Carnutes et bien d’autres encore. Quant à l’épisode du bouclier jeté avec « provocation », la seule trace est celle de César lui-même qui la relate, dans sa Guerre des Gaules, en « onze pauvres mots » : « Les chefs sont amenés, Vercingétorix est remis, les armes sont projetées ». Exit la glorieuse présentation des faits présumés gaulois.
Vercingétorix est envoyé à Rome et y sera mis à mort six ans plus tard. Or au XVIIIème puis à l’aube du XIXème siècle, plusieurs historiens, dont Nicolas Fréret et Amédée Thierry (Histoire des Gaulois) notamment, entreprennent de donner à cette défaite les aspects d’une légende, selon laquelle la Gaule et la France ne font qu’une seule et même patrie, guidée par un chef, Vercingétorix, qui aurait fait trembler Jules César. La réalité, on vient de le voir, est tout autre, mais le mensonge à des fins de récupération ne saurait avoir de limites. Il en est de même pour Dagobert, roi mérovingien, qui a régné de 629 à 639 et qui est indubitablement associé à la chanson créée au XVIIIème siècle — encore ! — Le Bon Roi Dagobert. Or contrairement aux paroles de la chanson, pour les historiens, Dagobert, loin d’être l’imbécile moqué dans la chanson, fut ce que l’on appelle un grand roi, à l’instar de Clovis et de Charlemagne.
Avec l’aide précieuse de son vieil ami et très fidèle conseiller, Eloi, Dagobert a tenu à distance l’aristocratie avide de pouvoir, il a réorganisé efficacement l’administration, la justice, l’éducation et les arts. Cependant ce fut aussi un fêtard invétéré, gros mangeur et gros buveur, qui collectionnait les épouses, les aventures et les conquêtes. Mais ce n’est pas à ce dernier point qu’est lié la légende, ce qui n’implique pas, donc, que Dagobert aurait, en quittant une maîtresse, remis, par inadvertance, sa culotte à l’envers. Le roi Dagobert aimait porter des braies, célèbre culotte gauloise, particularité vestimentaire qui, de son vivant, ne suscitait que de l’étonnement restreint. Mais quelques siècles plus tard, en mai 1750, lorsque Paris s’embrase, les paroles de cette chanson apparemment débonnaire deviennent très rapidement le symbole d’une critique virulente du pouvoir en place et de Louis XV, qui, de fait, est associé à l’image véhiculée par la chanson, souverain débauché et paresseux. Les deux auteurs nous emmènent ensuite en 875 vers un événement, qui, en toute objectivité et c’est très bien ainsi, a disparu corps et biens, de l’histoire de France, la Sainte Ampoule.
A cette époque, le conseiller du roi Charles II, Hincmar, n’a qu’une obsession, faire rayonner Reims en assurant à la ville le monopole du sacre des rois. Il réécrit donc avec emphase le jour du baptême de Clovis dans la cathédrale de Reims, le 25 décembre 496, en des termes qui laissent pantois : « Clovis s’avança vers le baptistère pour y recevoir l’onction. La foule venue en nombre empêcha les huiles saintes (la sainte ampoule donc) d’arriver. C’est alors qu’une colombe plus blanche que la neige — ce qui donne à penser que Coluche est allé chercher l’inspiration de certains sketches dans les écrits d’Hincmar…—, descendue du ciel, apporta dans son bec au saint évêque une fiole contenant le saint chrême ». C’est aussi lyrique et convaincant que du Morano, agenouillée devant une photo du petit prince de Nagy de Bocsa, mais cette aimable plaisanterie assurera la prééminence de Reims jusqu’à ce qu’un historien libre-penseur du XIXème, Jacques Collin de Plancy, mette fort justement en mille morceaux la sainte ampoule dans son Dictionnaire critique des reliques et des images miraculeuses (1821). Autre légende sortie de l’imagination débordante de certains individus, la ceinture de chasteté.
A cet objet-là on concédera qu’il n’a aucune place dans les manuels scolaires et moins encore dans les chroniques du pouvoir, et pour cause, il n’a, lui aussi, jamais existé. La ceinture de chasteté apparaît, en 1551, dans Vies des dames galantes de Brantôme, qui va lui trouver une origine totalement infondée à Bergame, en Italie. Si Rabelais affirme que la dite ceinture est inconnue en France, le mythe perdure, avec, notamment la complicité de Voltaire, Le Cadenas, 1716, et le Moyen-Age sera revisité et l’objet fabriqué, puis exposé. En 1861, La Revue anecdotique des lettres et des arts relate que des ambassadeurs du Siam n’ont pas voulu quitter Paris sans avoir vu le dit objet, puis se sont étonnés de son excellent état, à quoi il leur a été répondu que c’était tout à fait normal, puisqu’il n’avait jamais été porté. Pas davantage que le masque de fer ou le godemiché de Marie-Antoinette, sujet qui a incité les deux historiens à descendre du sérieux de leur piédestal pour s’amuser un peu quant à l’existence de l’objet (p-164) : « Celui de la reine, alors ? Un mythe. Sans quoi il aurait fini par laisser une trace quelconque. Or, dans les tiroirs, les indiscrétions, les inventaires, on n’en trouve pas la queue d’un »…
Ce petit ouvrage sans prétention est très agréable à lire et à relire, car, au-delà de l’humour parfois distancié, parfois moins des deux auteurs, il recèle des trésors de symbolisme et ouvre des analyses intéressantes. Que Hussein, le Dey d’Alger, le 30 avril 1827, soufflette le consul de France, Pierre Deval, à l’aide d’un chasse-mouches est purement anecdotique. En revanche, les raisons — le refus grossier du paiement d’une dette commerciale de trente ans — et l’exploitation de l’incident — prétexte à une guerre avec l’Algérie puis à la vaste entreprise de colonisation — sont extrêmement révélatrices de la condescendance des pays colonisateurs envers le reste du monde. Que les poilus de 1914 aient pu partir au combat avec des pantalons de couleur rouge vif dont la conception datait de 1829 — cibles parfaites pour l’ennemi, ce qui explique, en partie, le nombre très élevé de victimes lors de la seule première année — montre que l’état-major militaire semblait plus préoccupé par l’élégance vestimentaire des soldats qui partaient au massacre que par leur armement. En fin, on ne saurait oublier « le » chapeau de Napoléon, ridicule bicorne censé être objet unique d’une vie, alors que ce dernier en faisait acquérir au moins cinq par an et qu’ils les foulaient au pied à la moindre colère. Tous ces prétextes, tous ces présumés évènements procèdent de la même méthode — détournement, invention, absence de vérification, absence de preuves, amplification sans retenue — qui est, de toute évidence universelle, puisque les chaînes d’information télévisée en continu en ont fait leur terreau quotidien.
- Christophe Ganger, Victoria Vanneau, Le Vase de Soissons n’existe pas & autres vérités cruelles sur l’histoire de France, Editions Autrement, septembre 2013, 264 p.,, 16 €.



