
Agrandissement : Illustration 1
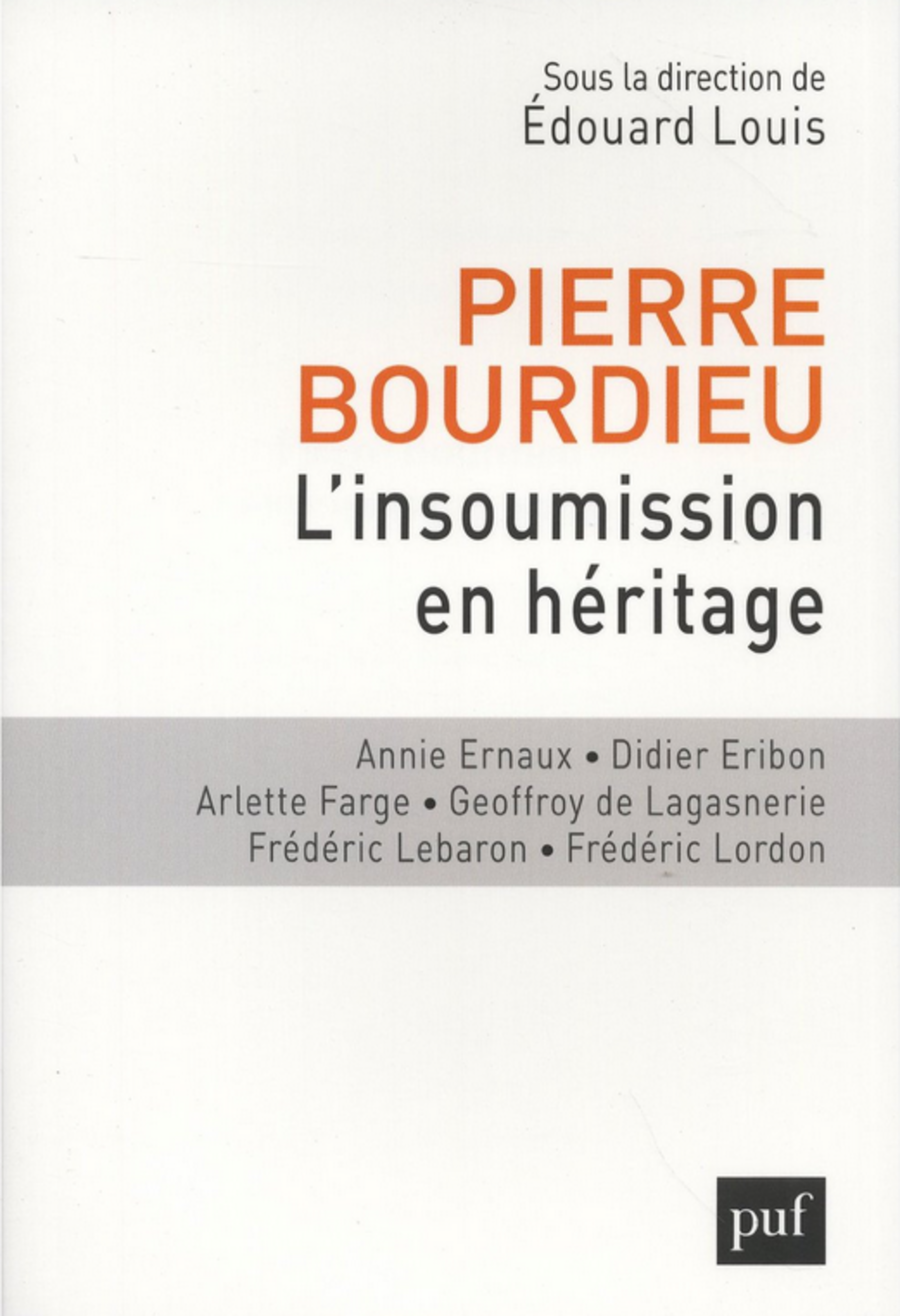
Toute relecture d’un grand texte est redécouverte, nouvelle interprétation. Ainsi avec Les Pensées de Pascal ou avec la Recherche du temps perdu de Proust. Ainsi avec certains ouvrages de Pierre Bourdieu, comme ceux que commentent dans le récent L’Insoumission en héritage six spécialistes d’une œuvre dont ils s’efforcent de faire apercevoir des aspects inédits. Six chapitres donc et un fil rouge : la dénonciation incessante chez l’auteur des Méditations pascaliennes des formes multiples de la domination mais, plus largement, le refus d’un ordre abusif chez celui qu’anima, sans trop qu’on le remarque, un véritable esprit libertaire.
Romancière, Annie Ernaux ouvre le recueil en s’attachant à La Distinction, ce gros volume quelque peu baroque dans sa construction. Leçon magnifique qu’elle propose, où apparaissent en toute lumière les clivages sociaux qui permettent à une classe de s’approprier la culture « qui distingue ». Mais Ernaux nous montre plus subtilement que la démonstration ne va pas chez Bourdieu sans une union étroite de l’expression et du contenu au cœur de l’écriture. Et d’écrire, analysant tel passage : « Ici, l’ampleur de la phrase, l’accumulation des propositions relatives, l’insertion de paroles populaires, une chute digne de la Bruyère sont au service d’une dénonciation du mépris de classe et révèlent une solidarité profonde avec les dominés. » (p. 43). Rien n’est plus juste, en effet.
À la suite d’Ernaux, l’historienne Arlette Farge dit toute l’importance de cet ouvrage étonnant qu’est La Domination masculine. Si ce volume est si provocant, c’est que l’auteur y multiplie les actes d’indiscipline, alors qu’il peut paraître renchérir sur des thèses féministes bien connues. Ainsi, relève Farge, pour abonder dans le sens d’un certain combat, Bourdieu choisit de faire largement la part de la vulnérabilité masculine à l’intérieur même du grand système des « genres ». Ou bien encore, s’attaquant aux historiens, le sociologue les accuse de n’avoir jamais interrogé sérieusement ce qui « éternise » les oppositions entre sexes.
De son côté, Frédéric Lebaron, qui travailla dans l’équipe de Bourdieu au Collège de France, retrace le parcours politique du sociologue et ses intermittences. Bourdieu évita toujours de s’inféoder à une organisation et préféra soutenir des mouvements et des rassemblements qui échappaient à toute institution, étant pourvus d’une « base de masse ». Par ailleurs, en leader improvisé qu’il fut parfois, il estimait que les sciences sociales dans leur version critique avaient à s’impliquer dans la lutte des classes.
L’article de Geoffroy de Lagasnerie est peut-être le plus décapant. D’un côté, il décrit avec force la vision tragique de Bourdieu, pour laquelle l’espace social est traversé d’une violence soutenue et de conflits. Or, ces derniers ont particulièrement pour objet l’appropriation des titres que confère l’État, cette « banque centrale du capital symbolique ». Appropriation totalement aliénante cependant, au sens où elle ne peut donner à l’existence des individus qu’une signification illusoire. D’un autre côté, Lagasnerie montre que la seule manière de sortir du système est de conquérir une autonomie, qui passe par des domaines comme l’art et la science, la politique, l’amour. Mais l’écueil est que ces voies impliquent une aspiration inquiétante à l’universel parce que la tendance de ce dernier est d’unifier et de neutraliser. Comment sortir de l’impasse ? Avec Bourdieu, l’auteur voit l’issue dans un espace social « qui laisse la possibilité à chacun de nous de faire sédition et de créer de nouveaux mondes. » (p. 91). Où l’on retrouve bien entendu le Bourdieu libertaire.
Autre démonstration novatrice que celle de Frédéric Lordon, en ce qu’elle distingue trois temps du capitalisme : celui de l’exploitation pure et dure, celui d’une exploitation qui entraîne les travailleurs dans l’illusion du bonheur (la consommation de masse), enfin celui tout actuel faisant que le salarié ne trouve son bonheur qu’à même « son » travail. Stade néolibéral et qui nous jette en pleine « servitude volontaire ». Ceci rejoint évidemment la théorie bourdieusienne de la violence symbolique, où le dominé finit par aimer ce qui l’assujettit
Didier Éribon clôt le volume en parlant d’un certain type de « honte » sociale dont, tout comme Annie Ernaux, il fit l’expérience en tant que fils de prolétaires. Et de se poser la question d’une formation scolaire vraiment démocratique : des « états généraux » de l’école, dont rêva Bourdieu, pourraient-ils y répondre ? Mais on sait par avance que, de ces « états », les plus concernés seront nécessairement absents puisqu’ils ont été exclus du système avant même de commencer. Voilà qui ramène aux premiers travaux de Bourdieu sur la reproduction sociale comme aussi à cet idéal que cultiva le sociologue d’une parole donnée à tous si la chose est jamais possible.
Ainsi se clôt un petit livre étonnamment libre et revigorant. Il convie chacun de nous à hériter de Bourdieu, à nous « insoumettre » à notre tour, en pensée tout au moins.
Parallèlement au même volume paraît un livre qui en est comme le complément naturel. Travail de Camille Peugny, il revient sur la question de la reproduction sociale pour montrer, statistiques à l’appui, que la « moyennisation » de la société dont on nous rebat les oreilles, est un pur mirage et que les espérances relatives à une mobilité croissante sont aujourd’hui mortes. Avec, parmi bien d’autres, cette observation intéressante selon laquelle le système scolaire s’est protégé de l’arrivée des « intrus » en créant, bien à l’écart des filières nobles de l’enseignement supérieur, d’autres parcours qui sont pour les jeunes comme autant d’impasses. Ainsi, plus que jamais, le destin d’un grand nombre d’individus se dessine dès le berceau.
Pierre Bourdieu. L’Insoumission en héritage, sous la dir. d’É. Louis (A. Ernaux, D. Éribon, A. Farge, G. de Lagasnerie, Fr. Lebaron, Fr. Lordon), Paris, PUF, 2013. € 18.
Camille Peugny, Le Destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale. Paris, Seuil, « La République des idées », 2013. € 11, 80



