
Fait brutal: l’histoire des femmes est largement celle de leur domination par les mâles.
Si l’on commence à bien le savoir, il n’en est pas moins utile d’en reprendre pas à pas la démonstration historique à partir de points de vue qualifiés. On peut le faire avec trois éminentes spécialistes dans un ouvrage de synthèse et de clarification que publie, au Seuil, la collection «La plus belle histoire de». Se succédant pour couvrir l’ensemble des grandes périodes, ces trois personnalités réagissent aux questions que leur pose de façon aussi alerte qu’incisive Nicole Bacharan en meneuse de jeu.
On entendra ainsi successivement Françoise Héritier parler des temps d’avant l’Histoire et défendre le point de vue anthropologique, Michèle Perrot parcourir les siècles de l’Antiquité à nos jours en parfaite historienne qu’elle est, la philosophe Sylviane Agacinski traiter du contemporain et évoquer la problématique au gré des débats les plus récents. Au total, un beau parcours, encore qu’un peu déjeté, qui n’omet aucun point essentiel et foisonne d’arguments et d’exemples.
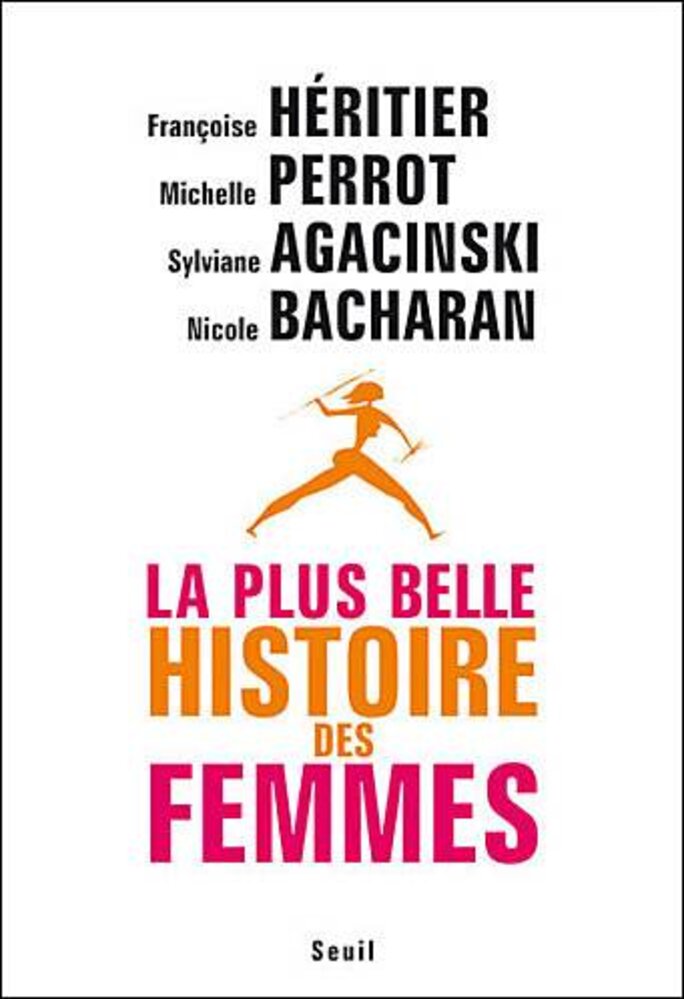
Un thème traverse le volume de part en part : l’«être homme» s’est constitué au fil des temps en universel abstrait voulant que la condition des femmes ne puisse se définir que par la différence. Ce fait brut s’assortit d’une double exigence: qu’entre femmes et hommes l’égalité des droits soit de plus en plus une réalité mais aussi que, pour autant, il n’y ait pas assimilation des sexes et des genres. Entre les deux variétés de l’espèce humaine, il est, disent les trois auteures, des différences irréductibles et en un sens réjouissantes, à commencer par celles qui concernent le corps et la reproduction de l’espèce. Hommes et femmes font ensemble des enfants mais c’est le ventre maternel qui reste le lieu de la gestation, malgré toutes les contraceptions médicalement assistées. En revanche, ce partage des fonctions n’est en rien une raison pour que les trois-quarts des femmes, comme c’est le cas en France, assument seules les tâches domestiques, tâches en rien méprisables par ailleurs.
Évoquant par métier des temps immémoriaux (elle enseignait l’anthropologie au Collège de France), Françoise Héritier part de cette réalité violente : la valorisation universelle et méthodique au cours des temps du masculin et des qualités attribuées aux hommes. Ce peut être au point que, dans l’Inde traditionnelle, parce qu’elle était le fait de l’homme, la passivité se retrouvait valeur positive. Il est donc une domination masculine reconduite sans trêve dès les origines et qui s’accompagne d’une « licéité absolue de la pulsion masculine ». Ce qui justifie toutes les variantes du viol : le mâle est à satisfaire «séance tenante», et, n’importe comment, il y faut des femmes. C’est sur ces bases que se fondent d’emblée des sociétés largement discriminantes. Quant aux formes prétendues du matriarcat, on ne les trouve nulle part, précise Héritier, même pas chez les Iroquois.
Pour Michèle Perrot, à travers les siècles, les régimes socio-politiques ont toujours voué le sexe féminin tantôt au viol et tantôt à la maternité sans fin. De là une représentation récurrente et clivée des femmes, qui seraient soit insatiables soit frigides, sans qu’existe le moindre moyen terme. Même là où un sort plus favorable semble leur avoir été fait comme dans l’Église catholique avec ses ordres religieux féminins, l’organisation est masculine et pour tout dire machiste tout au long. Perrot fait cependant la part de ces moments d’Histoire qui accordent à des catégories de femmes une relative autonomie : belles dames du temps de l’amour courtois, écrivaines de Labé à Sand, «régentes» à la tête de certains états, institutrices du XIXe siècle, mais, en chaque cas, le prix compensatoire à payer fut toujours élevé.
Pour Sylviane Agacinski enfin, la grande affaire est bien celle de la déconstruction de l’androcentrisme dans la perspective d’un système qui, véritablement égalitaire, reconnaîtrait la spécificité et l’apport de chaque sexe. À cet égard, Agacinski déplore que la langue française ne dispose pas, à côté du masculin et du féminin, d’un genre neutre, bien nécessaire à exprimer ce qui est commun aux deux «genres». Et par exemple pour faire barrage au «casting métaphysique des sexes», selon lequel l’homme est esprit et la femme chair. «L’universel, nous dit-elle, c’est la mixité, l’hétérogénéité masculin/féminin ; on est forcément l’un ou l’autre. Mais nous sommes aussi semblables par tout ce qui n’est pas strictement sexuel.» (p. 255). Toute la discussion que mène par ailleurs Agacinski sur les conditions nouvelles de la procréation s’inspire d’une conception de l’éthique ouverte mais exigeante.
Au total, un fort beau livre, où les intervenantes reviennent à des analyses qu’elles ont menées par ailleurs (voir l’utile biblio de leurs travaux). On appréciera la clairvoyance sereine de leurs prises de position. Pour le lecteur, ce sera aussi l’occasion de découvrir une «ligne française» de l’histoire féministe des femmes, ligne qui, remontant à Beauvoir, dépasse largement Le Deuxième Sexe.
Françoise Héritier, Michelle Perrot, Sylviane Agacinski, Nicole Bacharan , La Plus Belle Histoire des femmes, Paris, Seuil, 2011, 19,50 €.



