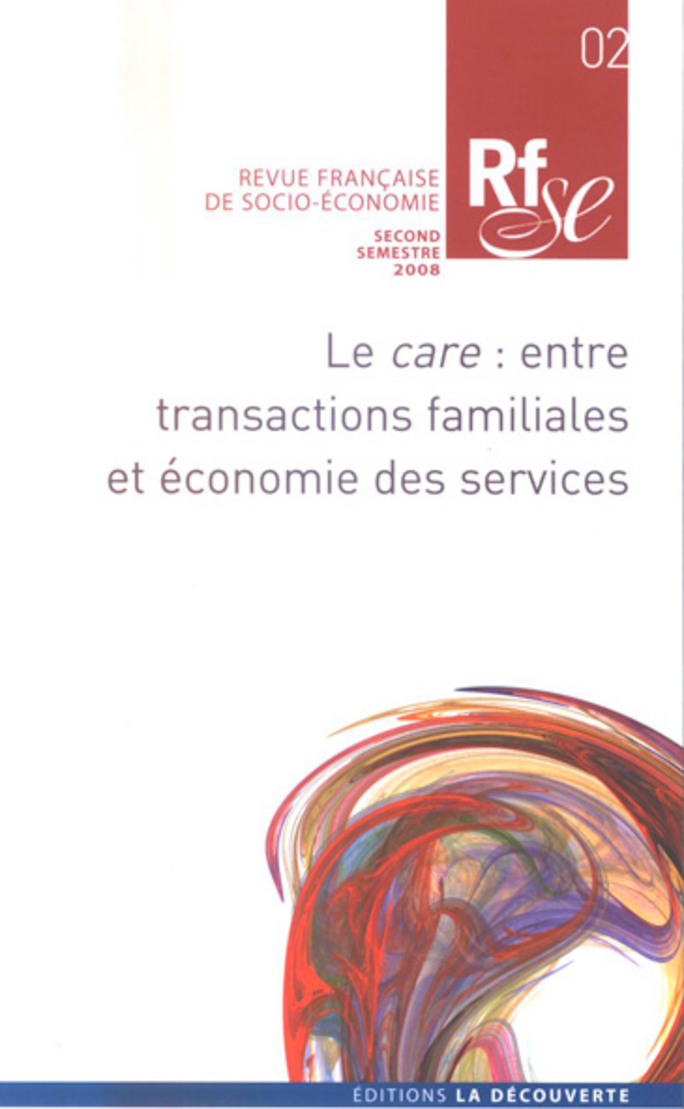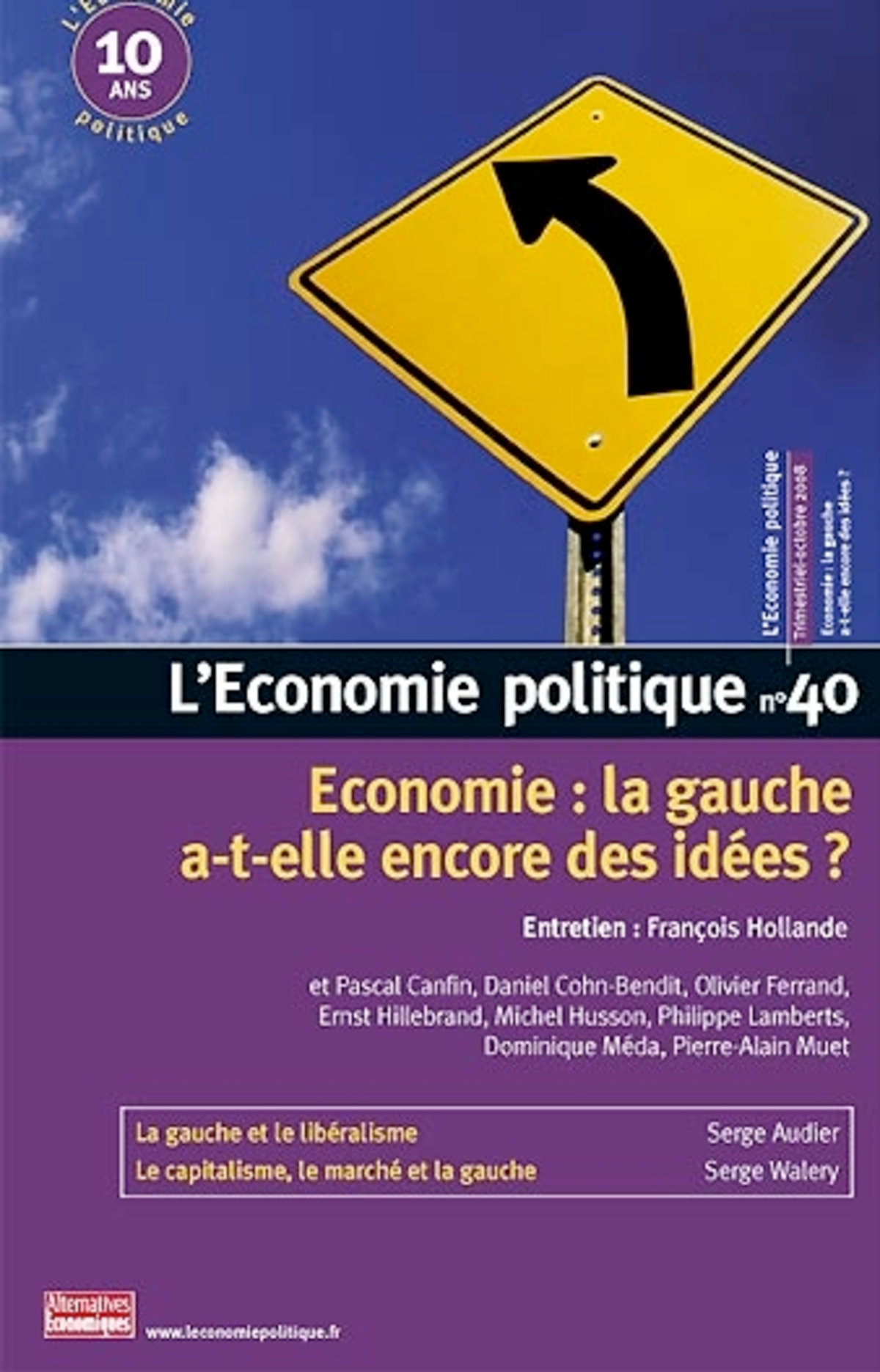
La gauche a-t-elle encore des idées en économie ? Question provoc, mais pas seulement, à l'heure où le Parti socialiste, englué dans une guerre des chefs sans fin, paraît incapable de formuler un début de réponse à la hauteur du séisme économique en cours. D'autant que le PS n'est pas sans responsabilité, loin de là, dans l'épanouissement d'une finance peu ou pas assez régulée, à l'origine du grand désordre actuel. Afin d'apporter de premiers éléments de réponse à cette question compliquée, L'Economie politique, qui fête ses dix ans en cette fin d'année, a très simplement ouvert ses pages à une dizaine d'économistes et penseurs ancrés à gauche - PS surtout, écolos un peu, et au-delà. Bilan des opérations, «la réponse est oui», écrit Christian Chavagneux, rédacteur en chef, depuis les débuts, de cette revue singulière, éditée par le mensuel Alternatives économiques. On devine ici et là les soupirs de soulagement.
«Care» et recherche
Des idées, donc ? Reprenons-en quelques-unes, croisées au fil des pages : face à l'accroissement des inégalités, et l'apparition de «sur-inégalité» dans la société française, François Hollande défend la mise en place, au sein de l'entreprise, «de règles qui fixent un écart de rémunération maximal entre les salaires les plus faibles et les plus élevés». «Il reviendrait à chaque entreprise de fixer cette échelle», précise-t-il. Plus loin, Dominique Méda, sociologue proche de Ségolène Royal, propose de miser sur le secteur (très la mode) du «care»*, pour créer des emplois et surtout, repenser le rapport des Français au travail. Quant à Olivier Ferrand, patron du jeune think tank Terra Nova, il prône, quitte à reprendre des refrains bien connus et à vrai dire presque usés, de lourds investissements dans l'économie du savoir («doubler notre effort dans la recherche», faciliter le financement des «gazelles», ces start-up en développement, etc). Plus à gauche, Michel Husson, économiste «alter» et membre d'Attac (déjà lu ici sur Mediapart), imagine la rupture avec l'actuel mode de répartition des revenus, marqué par la baisse régulière de la part des salaires («On a donc assisté à un transfert considérable de revenu allant des salariés aux rentiers»).
Silences, contradictions
Ne pas s'enthousiasmer trop vite face à cet apparent fourmillement d'idées : très vite, surtout côté PS, les contradictions affleurent. Hollande continue d'espérer un accord sur le cycle dit de Doha, pour la libéralisation des échanges internationaux, au sein de l'Organisation mondiale du commerce («Sans elle, le bilatéralisme serait encore plus fort»). Alors que Ferrand défend bec et ongles la signature d'accords commerciaux bilatéraux, entre l'Union européenne et de gros pays émergents («Les Etats-Unis l'ont compris»). Et le même Ferrand fait du retour de la croissance du Produit intérieur brut, le PIB, sa «première priorité», quand Dominique Méda, reprenant des thèses déjà développées avec justesse dans Qu'est-ce que la richesse ?, veut «tirer toutes les conséquences du fait que la croissance désirable ne peut en aucun cas être la croissance du PIB» (lire des extraits ici sur Mediapart). Et puis il y a les silences, de plus en plus gênants : rien ou presque, sur les techniques de régulation de la finance internationale, rien sur le financement du développement des pays du Sud, etc.
Le texte peut-être le plus dense se situe en bout de numéro, aux marges du dossier. Le philosophe Serge Audier, auteur d'un essai récent sur La pensée anti-68 (La Découverte, 2008), livre une analyse historique et nuancée des rapports entre gauche réformiste et libéralisme en Europe, qui prend une couleur particulière après la défaite d'entrée de jeu de Bertrand Delanoë pour la direction du PS. En injectant du long terme dans sa réflexion, depuis le congrès allemand de Bad Godesberg (1959) jusqu'au déploiement des Third way britannique et Nueva via espagnole, Audier constate, sans trop se mouiller, les efforts du PS français, chez Delanoë donc, mais aussi chez Julien Dray ou Vincent Peillon, à se ré-approprier la question des «libertés». Avec des fortunes diverses.
* Le care englobe l'étude de l'ensemble des activités (formelles et informelles) de la prise en charge des soins aux personnes. Lire sur le sujet, entre autres textes, le deuxième numéro de la Revue française de socio-économie.