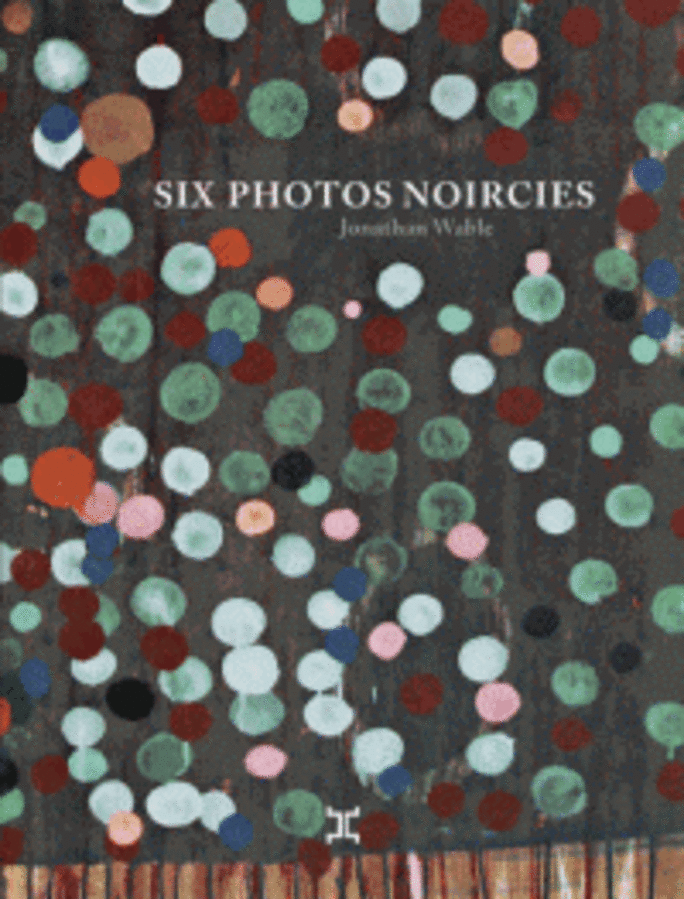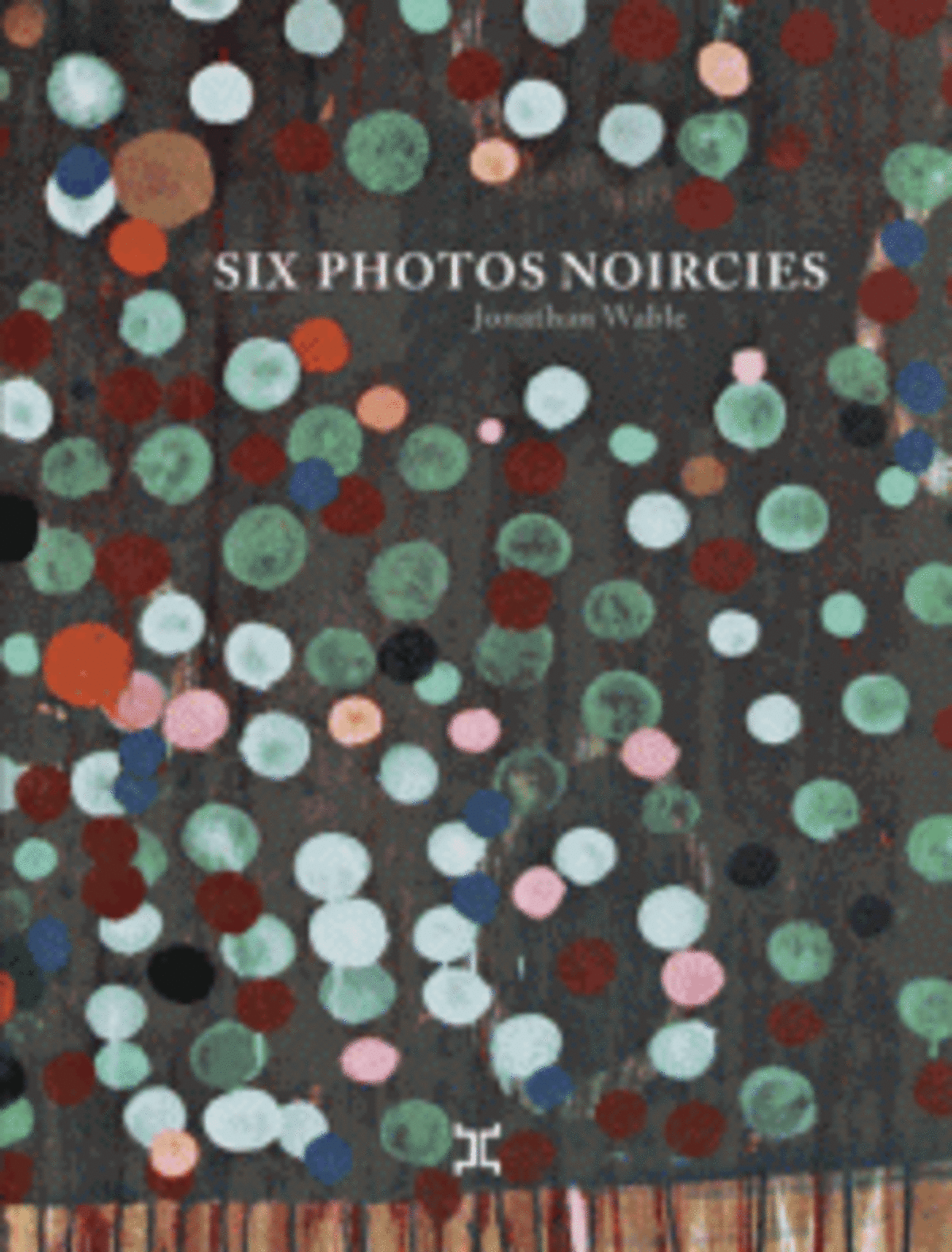
Premier livre du jeune Jonathan Wable, à la forme hybride et à la maturité surprenante, Six photos noircies nous plonge dans 20 tableaux successifs, espaces de reconstitution par touches et motifs d’un imaginaire foisonnant. Lecture et entretien avec l'auteur.
Ces 20 fables décrivent les découvertes énigmatiques et effrayantes de Valente Pacciatore et Tirenzo Perrochiosa, un biologiste et un médecin qui n’ont eu de cesse durant leurs vies de mettre à jour les anomalies perturbant la marche rationnelle du monde. Deux scientifiques inspirés et sensibles qui tentent de percer les secrets de faits dépassant l’entendement : disparitions, meurtres, objets et nature maléfiques et envoûtants, dessins et peintures rupestres énigmatiques... Y survivront-ils … ?
Ils sont tour à tour Alice chez les Freaks, Sherlock aventuriers, Dale Cooper à Twin Peaks, Ichabod Crane à Sleepy Hollow, héros extraordinaires d’Egard Allan Poe, perdus dans des immensités désertiques siliceuses ou glaciales, des réduits poussiéreux ou des ruelles de capitale...
Il va s’en dire que Jonathan Wable mêle un nombre incalculable de références littéraires, cinématographiques et mythiques. Pourtant, et c’est là que se situe une maturité formelle hallucinante : la densité des évocations passe inaperçue elle aussi à l’entendement du lecteur, qui a avant tout l’impression de se situer dans cet état de demi sommeil durant lequel les rêves et cauchemars prennent effet de réalité, et où se tirer des pages s’apparente au réveil.
Les cauchemars de Wable sont peuplés de divinités noires, d’êtres hybrides mi-hommes, mi- bêtes à la façon des dieux égyptiens, qui font figure de maîtres du chaos aux lisières des mondes réels et oniriques, (encore que la frontière soit ténue) au sein desquels ils interviennent, envoûtant, ôtant la vie, capturant, dévorant, tranchant les têtes, autant d’actes sauvages qui sont des sacrifices dont l’aspect expiatoire ou gratuit échappe complètement à nos deux protagonistes et au lecteur, par voie de conséquence.
Homme à tête de lion, mort-vivant réclamant l’expertise, cape maléfique, vers écœurant détruisant l’organisme de l’intérieur, écureuil à faux tranchante se délectant de nouveau-nés, forces impalpables ou incarnées dans des corps sulfureux, attirant irrésistiblement leurs proies vers une mort certaine… Wable revisite les contes et les mythes : sirènes, joueur de flûte, vierges sacrifiées, vampires, gémellité… Il parle à nos peurs enfouies, à nos instincts refoulés, à la clairvoyance de l’enfant disparu, à une sensibilité amputée par la rationalité à tout crin, nous perdant dans nos propres dédales intérieurs…
Les éditions Attila vont faire émerger un grand auteur doublé d’un conteur hors pair.
"En littérature, seul nous attire l'esprit sauvage. La monotonie n'est qu'un autre nom pour la nature apprivoisée. C'est la pensée libre, à l'état brut et sauvage que nous trouvons dans Hamlet, L'Iliade, toutes les Écritures et les mythologies, celle que l'on ne nous enseigne pas à l'école, qui nous enchante" (Henry D. Thoreau, Marcher, éd. Le Mot et le Reste)
Entretien avec Jonathan Wable autour de Six photos noircies
Révélateur sensible. C’est ce qui caractérise peut-être le mieux non seulement l’écriture et la méthodologie du jeune Jonathan Wable, mais aussi l’auteur lui-même. C’est seulement après l’avoir rencontré que l’on prend la mesure du travail d’orpailleur fantastique qu’il a effectué pour que nous puissions découvrir Six Photos noircies, son premier roman édité par Attila. Frénétiquement pointilleux, Jonathan Wable chasse sa propre sensibilité dans la couleur des mots et leur agencement, dans ses réminiscences cinématographiques et graphiques, dans ses souvenirs intimes et émotions passés au tamis de la fiction pour que n’en ressorte que la substantifique moelle, qui n’est autre pour l’auteur que leur évocation précise, leur image enfin révélée. Jonathan Wable est un chimiste, non loin des deux protagonistes scientifiques qui peuplent les pages de son texte hybride. A l’oral, il cherche aussi le mot, il bégaie le sens qu’on tente de lui extirper, semble passer du coq à l’âne jusqu’à ce qu’on se rende compte que se déploie devant nous une forme de logique extrêmement singulière. Et quand on lui présente une retranscription d’interview remaniée, il déplore qu’on ne puisse y lire ces tentatives échouées ou approximatives, « Je suis mauvais à l’oral, il faut pouvoir le lire ». Ni bon, ni mauvais, Jonathan Wable est cette sensibilité hors du commun, en prise avec le monde et la dépossession joyeuse et douloureuse que représente l’événement d’une première publication.
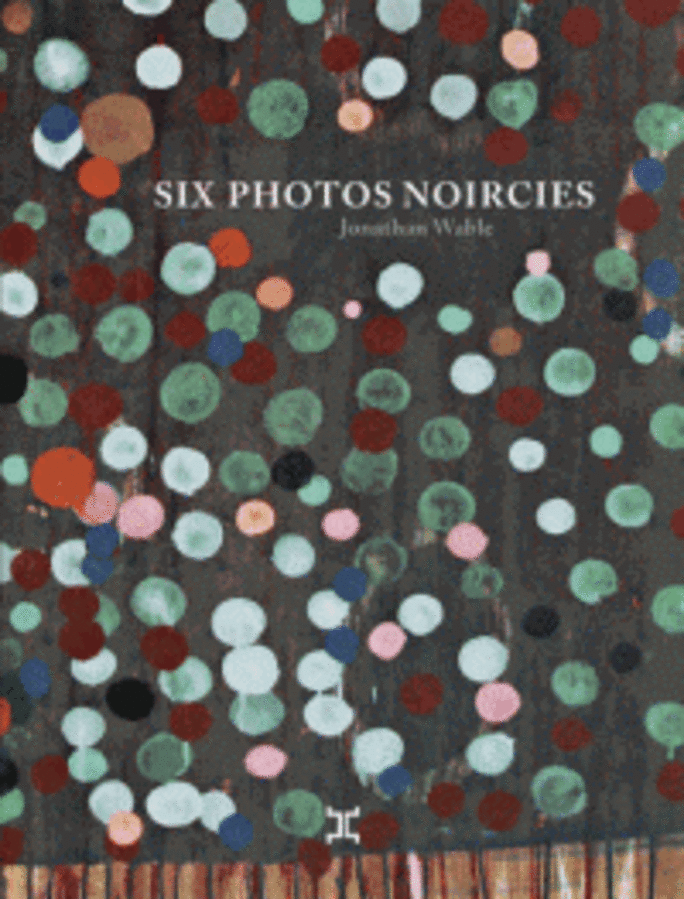
Quel est le lien entre Six Photos Noircies et l’artiste plasticienne Hélène Delprat ?
Jonathan Wable : Hélène était ma prof aux Beaux-Arts quand j’étais en première année. Nous avons tous deux quitté l’école et avons eu pendant longtemps une correspondance, elle m’a toujours poussé à écrire. En 2007 à l’occasion d’une exposition en Suisse, elle m’a demandé d’écrire des textes pour illustrer trois de ses tableaux, ce qui a donné les nouvelles Gorlitz, Squallow Woods et Beartooth Mountain. Je les ai écrites en collant vraiment aux tableaux, sans penser à rien et puis après petit à petit j’ai tissé les autres, le plan global, en restant dans cet univers, en gardant les personnages, sur ce principe de série… Comme si le personnage était Tintin et qu’on allait le suivre dans plein d’aventures. Au début il n’y avait d’ailleurs que Valente, c’était aussi beaucoup plus drôle, plus comme un jeu, il y avait beaucoup plus de dérision, le narrateur était plus présent et il se permettait beaucoup plus de commentaires sur ce qui se passait… Cela a été complètement gommé par la suite.
Est-ce vous qui avez choisi les trois premiers tableaux ?
C’est Hélène. J’ai ensuite choisi moi-même d’écrire sur certains autres tableaux et puis sur d’autres images qui me venaient en tête à partir d’association d’idées, à partir du peu de choses que j’avais créées. Dans l’écriture du livre il y avait aussi une tentative de compréhension des tableaux, j’écrivais pour mieux les apprécier, pour rentrer dedans. Si je ne me suis inspiré que de six tableaux, l’univers d’Hélène est resté tout de même la base de celui que j’ai développé par la suite, que ce soit le point de départ des sujets - la monstruosité, les horreurs - ou la façon dont je concevais les nouvelles : comme j’aurais composé un de ses tableaux, avec des trames, des motifs, des couleurs. Les tableaux pour moi ressemblent à… enfin dans mon idée… dans mon rapport intime avec le travail, les tableaux donnent vraiment… le… ce… cette cette …chose… d’un côté les corps, les monstres qu’on regarde et de l’autre côté… les…le… la trame et les motifs… La matière.
Quand je suis rentré aux Beaux-Arts, j’avais 17 ans et je suivais le cours d’Hélène qui nous demandait surtout d’écrire. Un des premiers exercices fut d’aller au Louvre, de choisir un tableau et d’écrire dessus. Et comme la relation que j’ai entretenue avec elle était de l’ordre d’une correspondance dense, on était de toute façon dans un rapport de… Elle voyait comment j’écrivais, et au début c’était la catastrophe, mais elle a toujours eu plus que moi le désir que j’écrive je dirais. Ça lui plaisait. J’ai aussi créé un blog à sa demande, c’était comme un exercice, un exercice super parce que je me concentrais vraiment sur la façon dont j’écrivais, puisque le sujet était tout trouvé… enfin il n’y avait pas vraiment de question sur la construction, je devais simplement réussir à décrire ma journée ou ce que j’avais ressenti etc. Et c’est déjà beaucoup… Pendant trois ans et demi, puis j’ai arrêté le blog au moment où j’ai commencé à écrire le livre. Il a pris la place du blog et de la correspondance, comme si je la continuais tout seul, et je ne lui ai donné le livre qu’une fois fini.

Un seul tableau est représenté au sein du livre, sur la couverture, et sous forme de détail…
C’est moi qui ai fait le choix de la couverture. Au tout début, durant l’exposition à la galerie, les nouvelles étaient distribuées à l’entrée, avec le tableau correspondant reproduit en miniature en en-tête de chacune d’elle. Tout le travail d’écriture que j’ai fait durant les cinq années qui ont suivi, a été un travail pour moi d’incarnation de ces tableaux, jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus faire partie du corps du texte. Mais c’était important qu’il y en ait un sur la couverture, un de ceux qu’Hélène avait choisis et avec lequel j’avais le plus d’affinités, parce que comme je le disais tout à l’heure, ils sont constitutifs de l’écriture. Sur ses tableaux on voit beaucoup le côté monstre, le côté figuratif et je voulais conserver des détails pour dire que c’était tout aussi important pour moi, le rapport à la matière, les dégoulinures, les taches de couleur, le temps qu’il fait, la météo, ça vient vraiment de sa peinture, de son travail sur le motif et la trame. Et c’est pour cela que j’ai choisi ce morceau du tableau, avec sa complicité.
Avez-vous dès le début conçu vos nouvelles dans la perspective d’en faire un livre, un tout cohérent et ‘fini’ ?
Je savais en le faisant que ça faisait un objet livre. Une fois que les trois premières nouvelles étaient faites, très rapidement j’ai eu l’idée d’une mise en place. Après, ça a beaucoup changé parce que j’ai écrit ça sur une assez longue période et que je n’ai pas écrit non stop en m’acharnant jour et nuit dessus. Plusieurs couches se sont superposées. Mais j’ai vraiment écrit à partir d’un plan et pas d’improvisations - d’improvisé, je dirais qu’il n’y a que la première nouvelle, qui est aussi la première du livre (les nouvelles sont plutôt dans l’ordre de leur rédaction).
J’ai travaillé comme dans certaines séries télé américaines, à partir d’une structure de base, d’un canevas mis en place dans les trois premières nouvelles : une quête, une obsession autour d’un fil qu’on tire et la découverte d’une image, d’une incarnation monstrueuse. Du coup, j’avais des idées d’images que je voulais mettre en place et je les ai listées, tout simplement, et petit à petit est venu l’ordre, sur la durée. C’était important que chacune des nouvelles puisse se lire toute seule et qu’en même temps elles forment toutes un ensemble cohérent et temporel. Pas une compilation mais un cheminement, qui nous amène d’un certain rapport au monde, d’une perception d’une image à une autre en fin de volume, à une métamorphose de la sensation. Et c’est aussi pour cela qu’il y a un second personnage, un passage de relais entre les deux personnages, un changement d’état. Valente est très présent dans les premières nouvelles et Tirenzio dans les suivantes.
Le duo Tirenzio/Valente a-t-il un lien avec le duo Jonathan Wable / Hélène Delprat ? Où se situerait dans ce cas la métamorphose créative entre vous deux ?
Sur cette métamorphose… Je peux essayer de l’expliquer mais cela restera certainement assez flou. Il s’agit avant tout d’une intuition, qui vient de deux explorations différentes du monde, de deux modes différents de rapport à la réalité, entre le naturaliste et le médecin… Effectivement Valente est surtout confronté à une monstruosité plus grotesque, quelque chose de plus… Tirenzio a un rapport au monde plus intérieur, de petites bêtes… Valente part d’Hélène, tandis que Tirenzio est beaucoup plus mon référent, il m’est plus proche, dans sa naïveté ou dans sa balourdise. Il est plus jeune aussi. C’est aussi simple que ça. Ils ont ensuite pris leur envol mais la base a créé beaucoup de choses. Leur rapport a également évolué, au départ Tirenzio était vraiment l’élève de Valente et puis petit à petit c’est devenu une autre génération, autre chose. Pour moi, c’est lié à la relation très différente qu’ils entretiennent avec la superstition : il y en a un qui vient d’une horreur fantasmée, de l’exploration, une exploration de territoire, qui cherche à repousser plus loin les frontières ou à savoir ce qui se cache derrière, et pour l’autre il s’agit plus des superstitions qui seraient liées à la science justement, celles « inventées » par la médecine, son exploration devient intérieure.
Ils restent tout de même deux scientifiques
Oui il s’agit plutôt d’un passage que d’une dichotomie entre les deux.
La figure de la gémellité et plus généralement du double est récurrente…
C’est une figure très intéressante et très présente dans le livre. Il y a beaucoup de nouvelles qui se répondent de ce côté-là. Des motifs qui fonctionnent par duo, pas seulement les deux personnages principaux. Il y a des figures monstrueuses traitées dans un sens puis dans l’autre, des motifs répétés, des situations, des mots, parfois des micro-choses, en miroir, résonances. C’est d’ailleurs assez étrange car au moment de la rédaction, je pensais vraiment aux nouvelles avec tous les échos qu’elles pouvaient contenir (j’en écrivais d’ailleurs toujours plusieurs en parallèle), alors qu’aujourd’hui, j’ai vraiment tendance à les considérer indépendamment les unes des autres. Comme si elles traitaient chacune d’un point précis dont je voulais parler, dans l’ordre dans lequel je voulais les traiter. Au début elles étaient toutes entremêlées.
Je l’ai vu dans la langue quand j’ai travaillé avec l’éditeur : les répétitions, c’était fou ! « A nouveau » « Une nouvelle fois » ou des personnages qui faisaient tout lentement : ils buvaient lentement, se levaient lentement…(rires) Il y en avait trois par pages ! C’est un bouquin qui se répète tout le temps.
Six Photos noircies présente de nombreuses figures monstrueuses empreintes d’une certaine morbidité…
Ce n’était pas tant la figure de la monstruosité qui m’intéressait que la figure du sauvage, je crois. Mais je n’ai pas choisi les figures monstrueuses, ce sont celles d’Hélène : elle m’a fait part de son désir et j’ai travaillé dessus et en travaillant dessus, je l’ai développé. Ses images sont très présentes, le lion, les ânes siamois… Ce qui m’intéresse personnellement c’est le sauvage derrière la figure monstrueuse.
Après, chaque nouvelle est une sorte d’incarnation d’angoisses, c’est là où ça serait le plus proche du cauchemar. C’est peut-être pour cela aussi que le livre est situé au XIXème siècle : de mon point de vue moins pour faire référence à la littérature de cette époque-là que pour se situer dans une sorte de passé un peu plus obscur, mais pas encore trop loin de nous, dans la mythologie des ancêtres, dont les angoisses se transmettraient de génération en génération et qu’on aurait aujourd’hui intégrées dans nos corps et nos cœurs : la peur de la mort, de la maladie, du parasite, des incarnations concrètes et puis d’autres moins, la peur du sauvage en nous, de l’altérité…

Ces personnages monstrueux ne parlent pas, sauf l’un d’eux, qui exprime d’ailleurs une grande mélancolie, une profonde tristesse
Oui, c’était important pour moi d’introduire une altérité là-dedans, de donner la parole à ces personnages qu’on voit depuis le début. Les autres parlent peut-être aussi un langage mais ils n’ont pas d’interactions avec Valente et Tirenzio, qui se situent à une place de simple observateur. Et ce n’est même pas eux qui décident d’aller à la rencontre de ce monstre, c’est le monstre lui-même qui décide de prendre la parole. C’est une des dernières nouvelles que j’ai écrites, j’en avais très peur et c’est finalement une de celle que j’aime beaucoup. J’avais peur parce qu’il n’y a pas tant de personnages finalement, de vrais personnages et c’est peut-être même pour moi l’unique personnage de ce livre (Valente et Tirenzio étant moins des personnages que des figures relais dans lesquels on peut investir tout ce qu’on veut). Elle (ou lui puisque son genre est grammaticalement indéfini) est un personnage de chair et d’os, qui a une vie, une histoire. Nous parlions d’ailleurs du double tout à l’heure, de la figure du double, et bien typiquement, la parole et l’histoire de ce loup trouvent un écho dans la nouvelle du désert et de l’éleveur d‘ours Bir El Khorbata - ce ne sont d’ailleurs pas tant des doubles que des motifs qui se transforment. Encore cette idée de la métamorphose à laquelle je suis très attaché. Je ne sais pas comment mais par le mouvement, la réalité en mouvement, le temps avance, c’est pour ça que les nouvelles ne sont pas toutes complètement indépendantes les unes des autres ; quelque chose avance. Et la dernière nouvelle est une métamorphose en soi.
Vous situez vos personnages dans une posture d’observation et provoquez même une distance supplémentaire vis-à-vis de la réalité en usant des témoins que sont la photo ou le dessin. Quel est l’apport de cette double distanciation ?
C’est un rapport presque… de mise en abyme même si je n’aime pas beaucoup ce mot. Avant d’écrire, je suis en train de regarder des tableaux d’Hélène, ou de regarder d’autres images. Du coup, la photographie c’est un retour à cet état-là. C’est comme si j’avais considéré que les tableaux que je regardais ou les images qui me servaient d’appui étaient en réalité les photos prises par le protagoniste : ils ont la même valeur. C’est aussi évidemment à cette époque que nait la photographie, elle bouleverse les rapports à la réalité et au fantasme… On n’y voit rien en regardant ces photos noircies.
Le livre maintient le lecteur dans un état de demi-conscience, entre rêve et réalité : les personnages sont d’ailleurs très souvent endormis, ou en passe de se réveiller…
Autant pas mal de choses sont voulues autant ça, ça m’a échappé, je n’y ai pas pensé du tout, mais oui ils dorment beaucoup ! C’est peut-être le seul rapport de la littérature fantastique du XIXème avec mon livre – selon le principe de base qu’on apprend au lycée : les doutes sur la réalité de ce qu’on a vécu.
La plus-value réside peut-être dans le fait que cet état transitoire, ce brouillage perceptif provient de la nature elle-même : l’influence météorologique est très importante, la géographie et la nature des espaces dans lesquels les personnages sont plongés les enfièvrent ou les immobilisent, orientent le récit… Les personnages sont de fait rendus poreux et très réceptifs au milieu dans lequel ils évoluent…
La météo est importante. Elle a même défini certaines de mes nouvelles : le monstre peut par exemple être uniquement l’eau comme c’est le cas dans la nouvelle Nadi Gus'sa. C’est une histoire de perception. C’est là que se fonde un rapport à l’image : ils voient les images, ils ne vivent pas ce qu’ils observent. Ce n’est plus, comme ça pouvait être le cas dans les textes fantastiques du XIXème, « est-ce que j’ai rêvé ce que j’ai vécu » mais « est-ce que je rêve ce que je vois » ; ou comment on peut être contaminé par une image, comment elle joue, contamine la perception et tout le rapport au monde qui va avec. Il n’y a pas d’étape psychologique, je ne parle pas de ce qu’ils pensent mais de ce qu’ils ressentent, du point de vue de la sensation et pas de celui de l’émotion. Les quelques passages plus sentimentaux qu’il y avait dans le livre, nous les avons finalement coupés.
Mais c’est vrai que chaque nouvelle a presque sa couleur de temps…
Est-ce la trame narrative qui est à l’origine de l’élaboration de vos nouvelles ou « les motifs » que vous avez déjà évoqués ?
Dans chaque nouvelle il y a une agglomération de plusieurs envies, que je ne peux pas totalement justifier, après je fais des tris, des ajustements… Je peux avoir un désir de monstre, un paysage, une météo, un morceau d’action, des mots, donc c’est vraiment comme si j’avais plusieurs fils et que je menais une enquête, comme si je faisais une recherche et que je trouvais ces éléments, comme si je trouvais un bout d’os… Je n’écris pas de façon chronologique du tout. J’écris des bouts de phrases, des morceaux, je fais des allers retours. L’ordinateur me permet d’écrire, je n’écrirais sans doute pas sans cet outil. Je travaille ensuite en élaguant.
Quand j’ai commencé le livre, je me suis retrouvé sans cesse confronté à mes limites d’écriture, le vocabulaire en grande partie, l’imprécision du vocabulaire. Et donc j’ai commencé à noter tous les mots que je ne connaissais pas dans les livres que je lisais. J’ai fait des listes de mots et parmi eux il y en avait certain que je voulais utiliser car c’était des couleurs au sens où ça semblait correspondre à ce faisceau de désirs dont je parlais. Parfois, j’avais ces mots devant moi et je me disais mais oui bien sûr, voilà ce qu’il manque à mon texte, c’est ce mot. C’est comme si j’avais conscience d’un trou et que la nouvelle ne pouvait se finir sans le combler, parfois cela m’a pris deux ans pour clore une nouvelle, pour trouver l’élément manquant.
Où situez-vous vos influences ?
Les références… (soupirs) Qu’elles soient cinématographiques ou littéraires, c’est là aussi plus un agglomérat de souvenirs ou d’impressions que de la référence. En gros il y a différents types d’influences. Il y a l’influence des images, des documents que je trouve, des figures littéraires, des motifs. Et le cinéma apporte plutôt une distance par rapport aux personnages, une sorte de mouvement de l’œil, qu’il n’y a d’ailleurs pas du tout dans la littérature fantastique du XIXème, qui plaçait la perception… plutôt dans le discours du personnage qui relatait son expérience. C’est le cinéma qui m’apporte ce recul, et qui m’a poussé à écrire à la troisième personne du singulier plutôt qu’à la première. Et les séries (pas forcément les séries télé, il peut s’agir aussi, surtout, de toute la littérature policière et sa cohorte de personnages récurrents), c’est la structure. La base.
Certaines scènes évoquent malgré tout assez précisément des scènes de cinéma ou de la littérature, je pense notamment à la scène de bal fastueuse…
Oui, j’avais des films en tête pour ce moment précis, la scène du ballet final d’Un américain à Paris, ou des images d’Orson Welles, un peu de Proust également et peut-être est-ce le seul moment où je pourrais citer Poe, et Le Masque de la mort rouge, qui est celle que je préfère.
On fait beaucoup le lien entre Six photos noircies et la littérature du XIXème siècle. Qu’en pensez-vous ?
La littérature fantastique du XIX au final je la connais mal - pour moi elle n’est pas si présente dans le livre. La plus grosse influence à la rigueur ce serait Jules Verne : ce côté un peu faiseur d’images ; il a un peu le même rapport aux couleurs, aux matières… Il faut voir, je choisissais mes couleurs comme quelqu’un devant les rayons de Castorama - je n’ai pas d’affinité particulière avec les couleurs, mais c’était important de bien les choisir. C’est un amour des mots aussi, des sonorités, qui colorent. Je peux choisir une couleur que j’aime moins mais dont le son m’apparaît plus cohérent. Sans vraiment pouvoir le justifier. C’est un mélange de grande prétention et en même temps de naïveté… je ne me suis pas senti écrivain du tout en écrivant, j’ai écrit ce livre, ce n’était pas tant dans l’objectif de faire un livre que de construire des images avec des mots, comprendre ce que c’était qu’écrire, comment on se cogne sur ses idées, comment on ne parvient pas à obtenir la fluidité souhaitée, le manque de précision… c’est vraiment être confronté sans cesse à ses limites. Je n’ai pas une langue fluide, le travail fut laborieux. La langue du livre m’est étrangère, dicté par un cahier des charges plutôt rigide.
Chaque expérience d’écriture est-elle toujours aussi fastidieuse ?
Ça dépend de ce que j’écris, si j’écris quelque chose qui m’est plus proche, ça n’est pas du tout laborieux mais là pour chaque monde il fallait découvrir, se documenter, sur le paysage, l’époque, les détails, certains faits scientifiques… du coup je me renseignais énormément pour avoir deux phrases… Il y avait quand même un petit côté « j’ai une grande image et ça fait trois lignes », merde. Comme si tu faisais du café et qu’il n’y avait que quelques gouttes qui sortaient. Les nouvelles réclamaient beaucoup pour être intéressantes. C’est dans cette langue bizarre qu’il fallait les écrire.
Chaque nouvelle porte le nom d’un lieu, les avez-vous tous inventés ? Pourquoi leur avoir donné cette place de choix, en tête de chaque nouvelle ?
Non, je ne les ai pas tous inventés. Il s’agit parfois de lieux précis, qui apportent un climat, des souvenirs, ou simplement un nom à la sonorité évocatrice. Je souhaitais inventer une sorte d’espace sur la carte. Il y avait au départ beaucoup d’indications de lieux, de date et d’heure. Seuls les lieux sont restés : on change de géographie à chaque nouvelle, donc d’images et on se situe du côté de l’exploration, on cherche les limites de l’espace, on veut tout voir, on s’enfonce. Le livre est vraiment un parcours programmatique. D’où leur présence sur le rabat en couverture. Quand j’invente ces noms, je puise dans des mots en langues étrangères, on se situe à la frontière de ces deux mondes, entre la réalité et le basculement dans le fantasme.
Six photos noircies est votre premier livre, comment s’est passé le travail avec l’éditeur ?
La rencontre avec Frédéric Martin a bouleversé les choses. Il ne s’agit pas tant de reconnaissance, qui n’est en soi pas très importante, mais plutôt du regard extérieur porté sur ce texte, regard dont la bienveillance m’a contaminé un petit peu. Ça m’a d’une certaine façon réconcilié avec le travail. Mais le fait d’être ‘publié’ ne devrait pas changer grand-chose, du moins j’en fais le pari. L’objet livre est en tout cas le résultat de notre rencontre, de nos discussions, nous l’avons fait ensemble, très simplement, en prenant beaucoup de plaisir à en explorer chaque recoin.
Je me sens en quelque sorte débarrassé du texte : je peux ne plus y penser et presque même ne plus l’ « assumer » ! Il s’agit vraiment du désir de Frédéric, qui a rencontré le texte, qui semble y être très attaché. La relation de confiance est très forte : je lui confie, même s’il voit certainement des choses que je ne vois pas dedans, je lui confie.
Jonathan Wable, Six photos noircies, éd. Attila, 193 p., 14 €