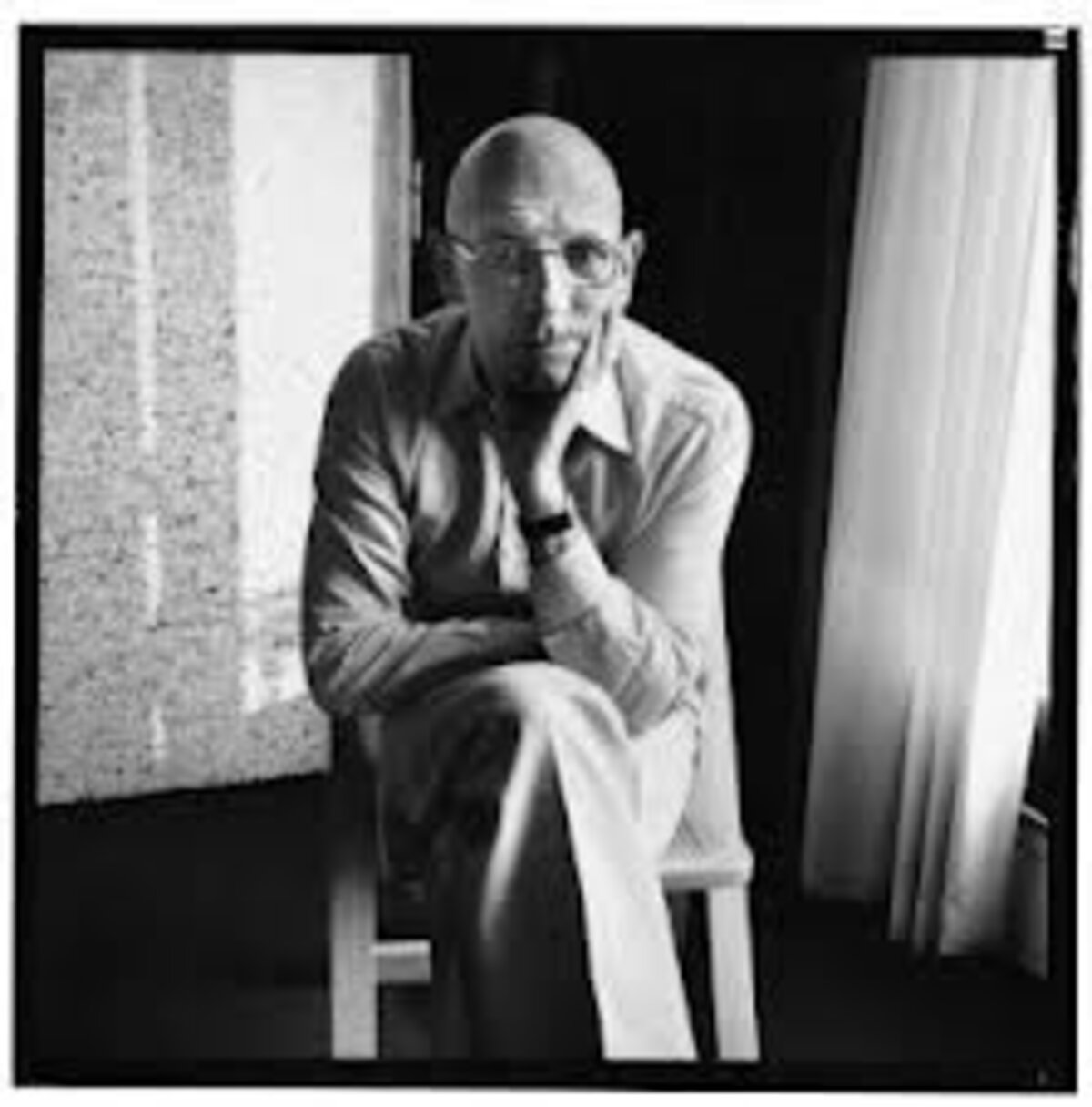
Revenons ici sur le récent livre de Geoffroy de Lagasnerie, La Dernière Leçon de Michel Foucault, et sur l’émoi qu’il peut provoquer. Dans son dernier cours au Collège de France, publié sous le titre Naissance de la biopolitique, Foucault accordait un intérêt fasciné au néolibéralisme, analysant de l’intérieur cette doctrine qui chaque jour nous hérisse. Le présent ouvrage voit son auteur reprendre méthodiquement ce travail, avec en arrière-plan la question : l’auteur de Surveiller et punir serait-il passé dans l’autre camp, aurait-il largué, en fin de vie, ses convictions de gauche ? Et de Lagasnerie de nous montrer que ce n’est pas le cas même s’il le fait avec un certain nombre de nuances.
En fait, Foucault soutient dans son cours que la doctrine néolibérale est loin de se réduire à une justification du capitalisme mais se veut avant tout une force d’opposition théorique à la philosophie politique née avec les Lumières et avec Rousseau. À cette dernière, les néolibéraux reprochent essentiellement d’avoir voulu sans relâche unifier la société sous la tutelle souveraine de l’État. Ce qui implique, sous une forme ou l’autre, une forte « mise au pas » des individus à travers institutions et contraintes. Et cela aurait conduit au communisme comme à la social-démocratie. Ou tout autant, dans un autre domaine, à la psychanalyse telle qu’elle ramène tout comportement à un même modèle originel. Est ainsi dénoncé le dirigisme dont toute pensée « progressiste » serait imbue et qui brimerait par avance les attitudes minoritaires.
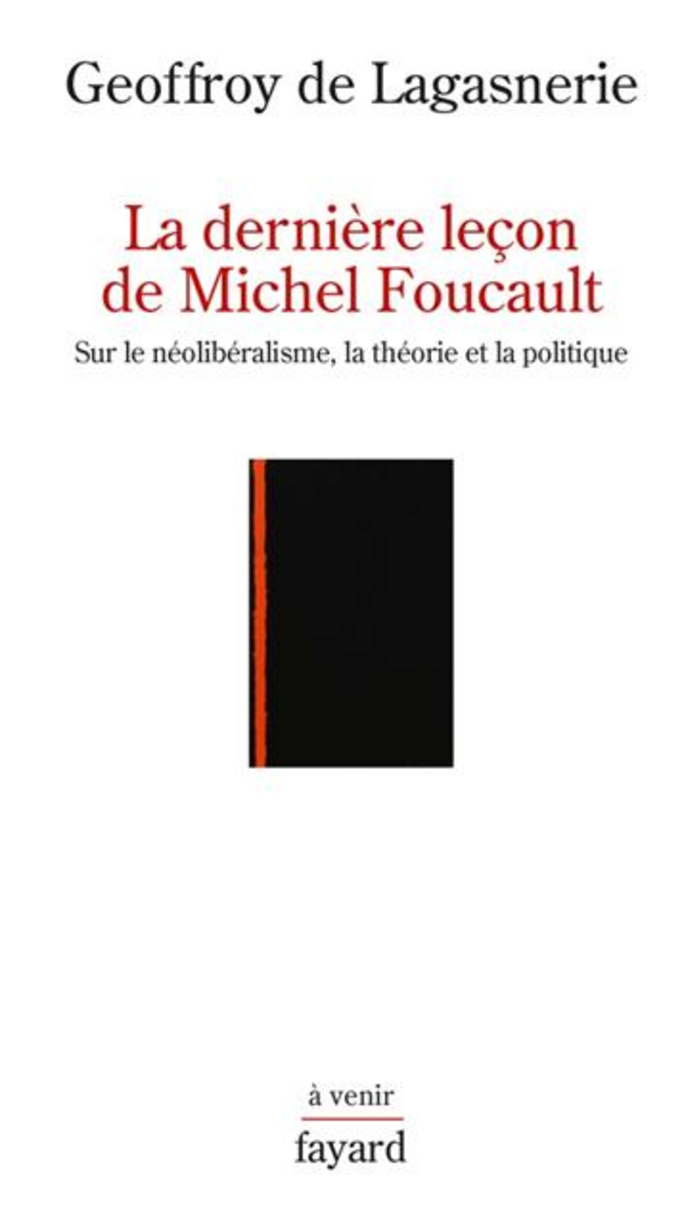
Agrandissement : Illustration 2
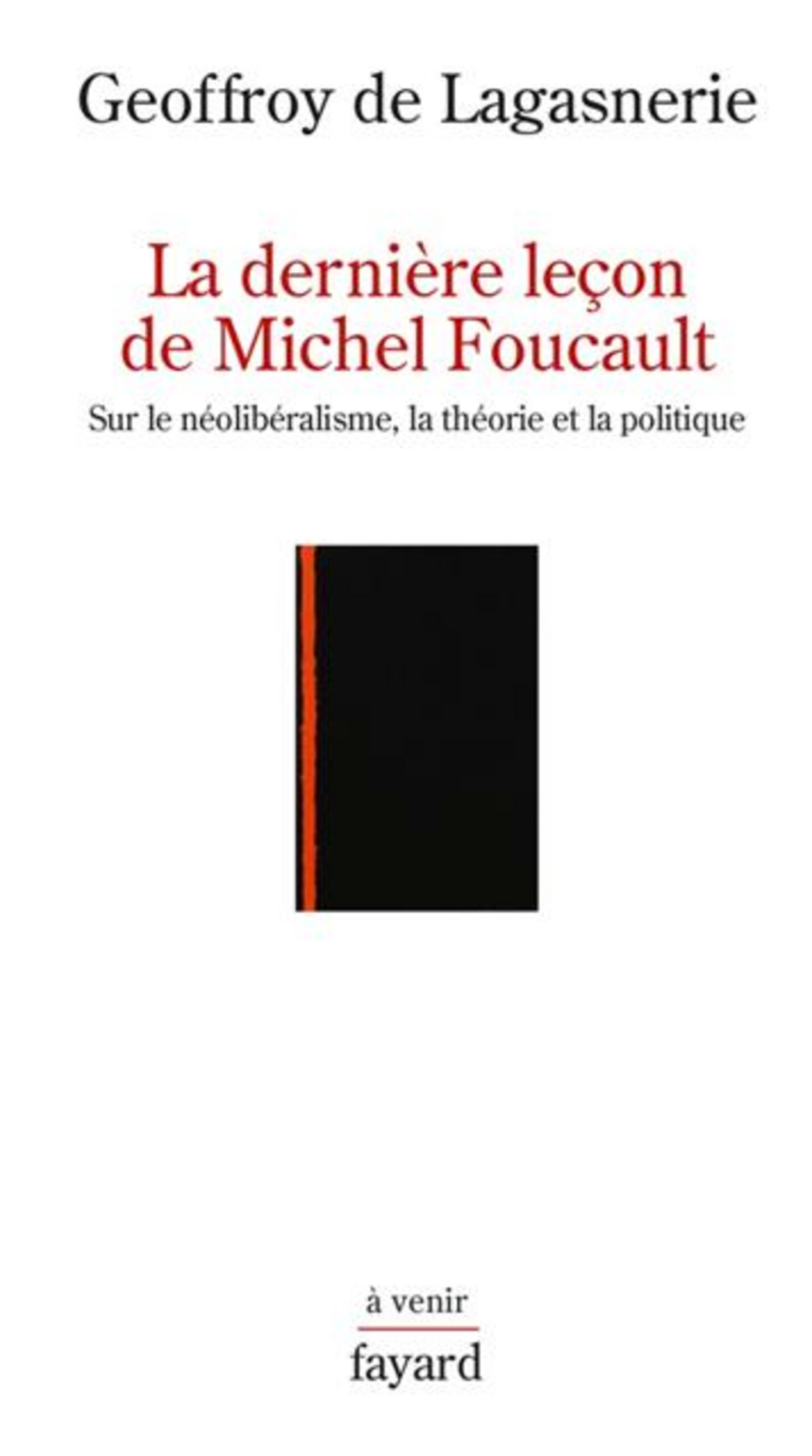
À cette uniformisation sociale qu’oppose donc le néolibéralisme théorique, qu’il vienne de l’école de Chicago (Hayek, Becker) ou de tel penseur allemand ou autrichien ? Pour ses tenants, la seule forme d’organisation satisfaisante est celle qui s’inspire à tout égard des relations de marché, relations à même d’inspirer une politique limitée et raisonnable d’intervention publique. Que l’État subsiste donc, mais qu’il soit régi par la seule règle économique. Telle est, selon Hayek par exemple, la bonne réponse au caractère hétérogène et au pluralisme de la société moderne, permettant à chacun de se déployer comme il l’entend dans ce cadre. Mais quel pluralisme ? Celui des classes sociales ? Voilà qui ne nous est pas dit. Toujours est-il que « la seule attitude envisageable serait le rejet de tout contrôle centralisé et la promotion de la logique marchande, qui laisserait les individus libres de leurs actions et ne les dirigerait pas. » (p. 67) Et de Lagasnerie de montrer encore que « notre » néolibéralisme remonte à des penseurs comme Herder ou Burke pour lesquels, selon un esprit de tolérance, il y aurait non pas une seule solution à un problème donné mais plusieurs pour la simple raison que des hommes différents désirent des choses différentes.
On peut donc concevoir qu’un Foucault soucieux ici comme ailleurs de défendre une politique des singularités contre les formes d’assujettissement abusif, soit allé voir du côté du néolibéralisme. On conçoit déjà plus mal qu’il se soit déporté vers un courant libertaire versant facilement dans un « libertarianisme » désireux de supprimer complètement le caractère coercitif de l’État. « Si, résume Lagasnerie, la charge antiétatiste à l’œuvre dans le néolibéralisme intéresse Foucault, c’est parce qu’elle ouvre la voie à la déconstruction du paradigme qui, selon lui, fabrique de l’obéissance dans les sociétés contemporaines. » (p. 127).
Il s’agit donc d’ébranler une longue tradition de philosophie politique qui fabriquerait sans trêve de la soumission et de la conformité. À quoi se rattache une « science » des choix rationnels, par ailleurs largement discutable : elle voudrait que l’on calcule en permanence les choix les plus adéquats pour les groupes sociaux en fonction de la rareté des biens et la concurrence entre buts poursuivis.
Mais précisément, parlons profit : en quoi est-il avantageux pour Foucault ou quiconque de comprendre le néolibéralisme de l’intérieur et de faire valoir sa cohérence ? En lieu et place du philosophe, de Lagasnerie répond 1° que mieux vaut prendre connaissance sérieusement d’une théorie « adverse » que de la percevoir en épouvantail absolu ; 2° que cette théorie fournit à la pensée de gauche une arme critique bien utile face à tout ce qui conduit à l’enrôlement des hommes en citoyens assujettis à l’intérieur d’un État « totalisant ».
Soit, et toute la démonstration ici menée est d’une grande rigueur. Reste pourtant la tache aveugle du présent ouvrage, qui évite à son auteur de conclure. C’est que, dans un temps comme le nôtre, où économie et finance font sans trêve leurs ravages, peut-on parler avec détachement d’une doctrine qui plaide pour le tout à l’économie et se voit reprise par les cercles les plus durs de la droite ? À cet égard au moins, le lecteur a de quoi se montrer perplexe.
Geoffroy de Lagasnerie, La Dernière Leçon de Michel Foucault. Sur le néolibéralisme, la théorie et la politique. Paris, Fayard, « à venir », 2012. 17 € (11 € 99 en format numérique)
Le livre de Geoffroy de Lagasnerie a depuis été chroniqué par Jean-Philippe Cazier, le 8 décembre 2012, dans ce même Bookclub. Lire ici — Ces deux perspectives sur un même livre illustrent ce que nous souhaitons tous faire de cette édition : un espace de lectures croisées, via les textes publiés ou les commentaires (CM).



