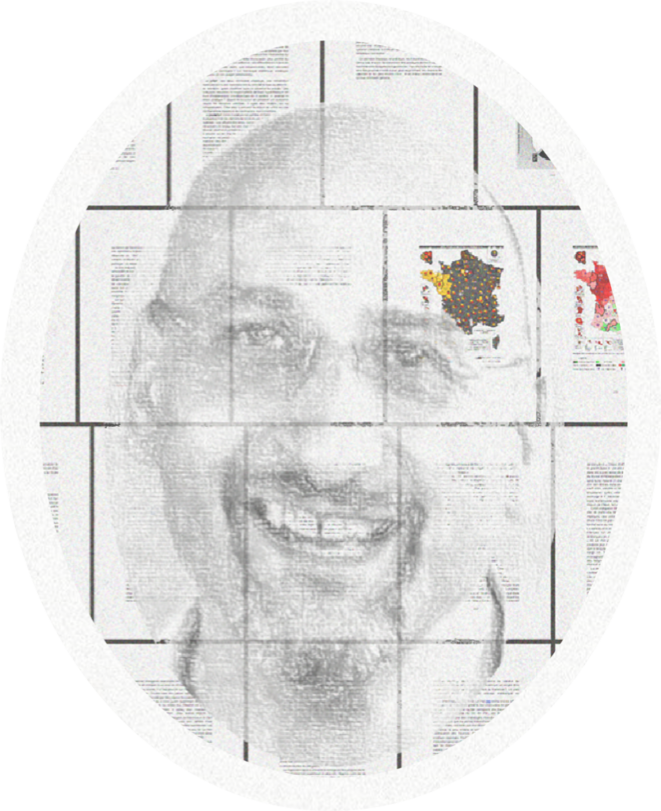Charte éditoriale :
Il s’agit de garantir au lecteur le sérieux du travail qui doit nourrir sa réflexion. En outre, comme indiqué dans la description de cette édition, « [ses] rédacteurs […] s'engagent à livrer des tableaux de la France et des Français dans un esprit d'impartialité. Chaque élection constitue un RDV du peuple avec son destin, dont il s'agit d'extraire les tenants et aboutissant, d'identifier et hiérarchiser les phénomènes déterminants. » Le but de l’auteur n’est pas de parler de lui, mais de la société française telle que les scrutins la révèlent.
La forme, entre questions pratiques, convenances sociales et rigueur scientifique :
- Le titre doit se présenter sous la forme « Election date, ( tour de scrutin ) – Titre ». En cas d’élection à deux tours, si l’article porte sur un seul d’entre eux, la mention en titre est bienvenue. Exemple : « Présidentielles 2002, T1 – La multiplication de candidats : un facteur de démobilisation ? ».
- Par politesse élémentaire, toute personne encore vivante doit être nommée soit avec l’initiale de son prénom et son nom ( « E. Macron » ), soit avec son titre de civilité ( « M. Macron » ), soit avec son titre officiel, quitte à l’abréger ( « le président Macron » ). Sans être impératives, ces convenances sont recommandées pour les défunts ( quand il ne s'agit pas de personnalités de siècles lointains, comme "Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu" ; dans un tel cas, l'appellation usuelle de "Montesquieu" convient parfaitement ).
- Transparence des sources : sans alourdir artificiellement le propos, il faut que les fondements essentiels de l’argumentaire soient clarifiés.
- Les principales sources doivent être non seulement signalées, mais aussi soumises à l’examen critique. Sur toute infographie traitant des données denses, une mention type « ministère de l’Intérieur » est acceptable, mais appelle soit une présentation détaillée indépendante[1], soit une présentation dans un passage synthétique de l’article, soit un article auxiliaire spécialement dédié à l’authentification des sources et à l’exposé des méthodes employées[2].
- Si la source est accessible par lien hypertexte, fournir ce dernier en note de bas de page peut convenir. Attention : certains liens sont désactivés avec le temps. En cas d’incertitude, mieux vaut ajouter les précisions en usage dans les travaux universitaires.
- Pour les sources secondaires, sur des points anecdotiques ou bien documentés par l’actualité, une évocation sommaire dans le corps du texte ( dans la formulation ou de manière plus formelle, type « ( auteur, date ) » ) suffit. Si un auteur s’intéresse à la médiatisation des jeux olympiques 2024 en contrefeux de l’actualité électorale, nul besoin de référencer l’existence de ces jeux olympiques. C’est à l’auteur de discerner quelle est la nécessité d’attester les phénomènes dont il parle.
Tout article doit être signé, aucun pseudonyme n’est admis. A cet égard, l’auteur assume la responsabilité de sa publication, cette édition bornant son contrôle au respect de la présente charte éditoriale.
Les exigences scientifiques :
- Tout auteur s’engage à faire preuve d’esprit de neutralité. Par cette expression, il faut entendre que les jugements de fait sont admis, contrairement aux jugements de valeur. Par exemple, dire que nos élus actuels sont nuls est un jugement de valeur : aucun argument, aucun critère, le tout joint à une formulation inconvenante. En revanche, si l’auteur prouve que nos élus ont des scores de plus en plus faibles, une expérience politique de plus en plus limitée, que leur impuissance s’accroît, leur nullité est alors démontrée de manière ouverte au débat contradictoire. A charge pour les contradicteurs de pointer les failles de l’argumentaire, par exemple les inconséquences du peuple qui les élit, la difficulté croissante à recueillir les suffrages de celui-ci… L’idée est la même, mais le jugement de valeur est le résultat d’une paresse, voire d’une malhonnêteté intellectuelle. L’examen rigoureux aboutit généralement à des conclusions plus nuancées.
- Pour toute analyse électorale, les pourcentages d’exprimés sont à proscrire sauf rares exceptions ( étude binaire des rapports de forces entre ensembles supposément hégémoniques, type « gauches vs droites » + autres situations restant à découvrir ? ). Ils sont à l’analyse du corps électoral ce que l’élastique est à la mesure des distances : un non-sens. Les comparaisons dans le temps et l’espace ne sont recevables qu’en pourcentages d’inscrits[3]. Dans certains cas, l’emploi des scores bruts illustre utilement les masses engagées dans les problématiques populaires ; encore faut-il les choisir et interpréter avec soin[4].
- Les sondages électoraux ne sauraient constituer que des sources d’appoint, en aucun cas les sources principales des articles. Aucune science ne saurait valider des conclusions fondées sur des échantillons, dès lors que des sources exhaustives sont disponibles. Chacun peut mesurer le potentiel d’erreur de telles études en confrontant les prospectives et rétrospectives sondagières sur les élections aux données disponibles. Dans le cas des prospectives, les sources accessibles au moment de la réalisation des sondages suffisent à démontrer leurs défaillances conceptuelles et structurelles ; à moins que leur qualité à venir progresse fortement par rapport aux productions passées[5]…
- Dès lors qu’un phénomène est traité avec des sources variées, des enquêtes d’opinion divergentes ou concordantes peuvent être mentionnées ; si et seulement si elles portent sur les pensées des masses populaires, si et seulement si elles constituent des enquêtes d’opinion au sens strict. Les sondages ont en effet le quasi-monopole de cette investigation : il faut bien demander aux masses populaires ce qu’elles pensent pour le savoir…
- Dans les situations intermédiaires, comme la composition sociologique d’un électorat, les sondages sont également proscrits. Il est possible d’accéder à des sources plus fiables en confrontant les résultats électoraux et les structures sociales des territoires auscultés ( INSEE ).
Bien entendu, les impératifs légaux encadrant la liberté d’expression, comme l’interdiction du plagiat, sont à respecter. Toute infraction relève de la responsabilité de l’auteur. Le responsable de l’édition n’est pas censeur et vérifie les seuls points émis dans cette charte, cela en admettant a priori l’honnêteté des auteurs.
Une fois ces points essentiels admis, il serait contreproductif de démultiplier à l’infini les clauses à respecter. Néanmoins, au cas par cas, des prescriptions méthodologiques peuvent être débattues entre édition et auteur, si l’article semble être fondé sur un socle fragile de sources et connaissances.
[1] Exemple pour les européennes 2024 : https://www.youtube.com/watch?v=Lgxz6wg7rFc&t=323s
Exemple pour les législatives 2024 : https://www.youtube.com/watch?v=p52y0WMxZ6Y&t=350s
[2] Cf, dans la présente édition, l’article à paraître sur les calculs du front républicain 2024, par bureaux de vote et par circonscriptions.
[3] Présentation simplifiée de cet enjeu à l’occasion des européennes : https://www.youtube.com/watch?v=noTo8XgAM4A&t=21s
Complément à l’occasion des législatives : https://www.youtube.com/watch?v=E9crJJLcg3M
[4] Exemple de contresens sur les données brutes, lequel contresens engage la définition d’électorat : https://studio.youtube.com/video/KFS0qsURew0/edit
[5] Un bref aperçu dans J. Morel, « Reports du 1er au 2nd tour 2022 – Emmerder l’autre France : projection électorale et extrapolation sondagière dans les sciences politiques », dans 2022 : prérogative présidentielle, scrutin insincère ?, L’Harmattan, Paris, 2024, pp. 177-222.