
Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine: Avez-vous pensé faire ce film comme document historique pour le futur ou plutôt pour le présent afin de comprendre ce qui s'est passé ces dernières années au Chili depuis 2019 ?
Tamara Uribe: Je pense que peut-être lorsque ces premiers jours de protestation ont eu lieu, l’épidémie s’est produite, nous tous, pas seulement les cinéastes, mais tout le monde, savions déjà immédiatement que c’était quelque chose d’historique, sans précédent, que ce n’était pas comme les manifestations auxquelles nous participions jusque-là. C’était quelque chose de différent et qu’on n’imaginait pas non plus pouvoir arriver. Il y a donc aussi quelque chose que nous sommes allés enregistrer le lendemain du début de ces manifestations, sans savoir encore que cela allait être un film... Ce n'était donc pas une décision, c'était plutôt une impulsion au départ.
Belén Krake: C'était donc l'idée que quelque chose d'historique était en train de se produire et qu'il fallait l'enregistrer ?
T. U.: Nous avons simplement commencé à enregistrer et pas seulement nous, mais encore de nombreux collègues. Des collectifs de films ont été créés qui n'existaient pas à cet effet. Je pense donc qu’au départ il y avait un sentiment de collectif pour un documentaire. Ayant la responsabilité de faire partie du mouvement, après quelques mois de protestation, ce processus d'écriture s'est poursuivi lorsque la nouvelle constitution a été annoncée. Nous avons décidé que ce serait un film et à partir de là je crois qu'une autre intention apparaît, celle de faire un film qui ne dépend pas de la contingence parce qu'il est là au milieu de l'incertitude.
C'était très difficile de penser que ce film puisse être utile pour l'avenir... Parce que nous ne comprenions pas grand chose à ce qui se passait. Nous rappelions sans cesse que ce film ne répondait pas seulement à la contingence du moment mais qu'il fallait penser à ce que nous voulions dire. C'est pourquoi nous avons non seulement enregistré le processus de rédaction de la Constitution au sein du congrès, mais nous en sommes partis pour explorer ce qui se passait dans d'autres territoires, autour du conflit environnemental.
B. K.: Personnellement, je ne suis pas de la capitale et j'ai beaucoup apprécié dans ce documentaire de pouvoir se déplacer sur le territoire. C'était précisément l'une des revendications de toute la mobilisation, de la protestation, de décentraliser le Chili...
T. U.: Oui, je pense que cela nous a beaucoup aidé, aussi parce que lorsque le premier processus constituant s'est terminé par un rejet. Cela donnait l'impression que le film s'arrêtait là mais nous aurions pu continuer à filmer.
Ensuite, il y a eu un second processus, que nous n'avons pas enregistré, donc je pense que ce sont deux choses : d'un côté, l'aspect historique et d’un autre côté, le film devait apporter une réflexion en vue d'une compréhension. Parce qu'à cette époque au Chili, il n'y avait pas de consensus sur ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce arrivé ? Pourquoi est-ce que je suis rejeté ? Ce sont donc des questions difficiles et je pense qu’elles nécessitent du temps.
C. L.: Avec quelles personnes avez-vous travaillé pour organiser le récit du documentaire?
T. U.: Nous avons travaillé uniquement avec le collectif. Nous travaillions déjà ensemble depuis 10 ans lorsque cela s'est produit. Ce qui était bien, c'est que nous avions une méthode de travail que nous connaissions déjà. Nous ne savions pas si notre manière de filmer était la bonne, car sortir avec une caméra fixe lors d'une manifestation était assez absurde, surtout lorsqu'il s'agissait de s'éloigner de la police avec un trépied...
Nous avions une méthode que nous connaissions, qui fonctionnait et qui avait beaucoup à voir avec les images. En général, quand nous avons des doutes, nous nous appuyons sur les images, c'est là que nous avons confiance que quelque chose peut apparaître. nous nous sommes aussi appuyés sur un large réseau de personnes avec qui nous avons travaillé auparavant, qui nous ont aidés à accéder aux lieux. Nous avons eu des contacts avec des gens qui travaillaient au sein de la convention, qui étaient des conseillers, avec des gens du monde politique et du mouvement social. Nous avons enregistré sur le territoire avec des personnes que nous connaissions déjà, qui avaient déjà enregistré quelque chose, donc nous avons profité de ces réseaux. C'est toujours bien d'avoir un ancrage local, parce qu'on ne va pas arriver comme ça de nulle part.

Agrandissement : Illustration 2

C. L.: Oasis semble étroitement lié au film de Patricio Guzmán, La Bataille du Chili en commençant ainsi dans l'espoir de mettre fin aux inégalités sociales.
B. K.: Et aussi capter ce mouvement historique, ce changement social...
T. U.: Quelque chose de curieux nous est arrivé dès le début, depuis que nous avons commencé à filmer. Cette comparaison avec La Bataille du Chili était inévitable. À cette époque-là, c’était la première fois que nous nous sentions dans un contexte avec ce niveau d’intensité en tant que génération. Le contexte des images était totalement opposé, c'est-à-dire qu'à cette époque, pouvoir avoir une caméra pour montrer quelque chose qui se passait et qui était nié était quelque chose de très important et au Chili il n'y avait pas de caméras.
Je pense donc que ce qu'a fait Patricio Guzmán était très important. Il nous est arrivé dès les premiers jours de réaliser que nous étions tout le contraire de son époque : il y avait trop de caméras ! Nous avons tous des caméras, la police a des caméras... et peut-être que la difficulté n'est pas seulement de sortir pour enregistrer, mais aussi de savoir comment enregistrer, et comment faire la distinction entre toutes ces images... Parce que finalement, aujourd'hui, c'est une guerre de l'information, sujet développé dans le film, autour de la désinformation. Parfois, ces images peuvent aussi être utilisées contre... Et je pense qu'en fait, nous avons commencé à publier des images, certaines de celles qui apparaissent dans le film, sur les réseaux sociaux au début. Parfois nous les publiions et ensuite nous devions les télécharger parce que nous disions bien sûr, peut-être que cette image était importante à diffuser. Tous ces gens sont identifiables, c'est dangereux... Cela se produit depuis de nombreuses années, ce qui est lié à la multiplicité des images et des supports médiatiques. Cela nous a fait quelque chose, un défi différent et je crois que le cinéma d'observation dans ce cas est un allié car il nous permet, au milieu de cette quantité d'images, de chaos et de mouvement... de rester immobiles, d'observer et d'essayer de vérifier, comme pour chercher ce reflet, cette compréhension. B. K.: Et en ce sens, en tant que Chiliens, nous nous sentions interpellés par ce mouvement, où que nous soyons, d'une manière ou d'une autre, chacun avait une opinion ou un sentiment sur ce qui se passait. Comment finalement parvenir à cette objectivité ?
T. U.: Je pense que nous recherchions cette objectivité. Je ne sais pas si cette objectivité est vraiment possible, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que notre image produit parfois cette sensation où elle a une certaine distance, comme si elle était objective. En fait, il nous arrive parfois de voir des images au milieu des manifestations où des gens apparaissent en train de prendre des photos sur l'image que nous avons enregistrée, et des gens commentent « combien ce photographe est courageux » comme s'il n'y avait personne dans notre appareil photo, comme s'il n'y avait personne.
Cet effet disparaît donc un peu. Je pense que ce que nous aimons dans ce film, c'est précisément cette non-intervention, car elle met le spectateur au défi de tirer ses propres conclusions, disons, pour pouvoir les interpréter. Je pense que ce qui enrichit le film, c'est d'avoir beaucoup de subjectivités, c'est-à-dire, au fond, d'avoir différents documentaristes et j'espère que chacun montre son point de vue là-dessus. Ne cherchez pas cette objectivité, mais cherchez plutôt son regard qui, disons, se produit dans la réalité. C'est peut-être pour cela que le public ne se sent pas manipulé parce que le film ne vous dit pas quoi penser, mais il vous dit d'où regarder. Il y a cet exemple de séquence où, au lieu de simplement regarder la personne qui parle avec le microphone, nous regardons de côté et nous nous concentrons sur les personnes qui font le ménage. Je pense que cela a à voir avec cette idée de chercher dans le bon sens du terme, de s'ouvrir à d'autres images qui ne sont pas des images créées, mais qui se produisent et parfois il est difficile de les voir.
C. L.: Travailler avec ces subjectivités plurielles, c'est aussi retrouver en chacun le désir d'une utopie.
T. U.: Oui, parfois nous avons ri alors que nous étions déjà à mi-chemin du processus. Parce que nous avons appelé le film Oasis à partir de cette phrase qu'avait dit l'ancien Président Piñera que nous remettons en question alors que pour lui « Le Chili est un exemple dans la région, de stabilité, de croissance... » Nous sentons aussi que ce premier processus vers la constitution et l'éclosion sociale était aussi une sorte d'oasis. Dans un certain sens, nous vivons aussi dans une sorte de mirage au fond, dans une sorte d'illusion qui, au début, nous a beaucoup surpris.
Avec un quota de peuples autochtones, qui n'ont jamais eu de représentation politique, un quota féministe, une majorité de gauche, issue de mouvements progressistes, de gens ordinaires, de manifestants à l'assemblée constituante, c'était alors incroyable ! Comment cette constitution n'a-t-elle pas été approuvée ? Cela aurait été aussi incroyable si elle n'avait pas été approuvée que si elle avait été approuvée... Ce serait très étrange de passer d'une des Constitutions les plus néolibérales du monde à l'une des plus progressistes, cela avait à voir avec une utopie ! Cela nous a permis de faire face à la réalité : ce n’est peut-être pas si facile. Je pense que le fait d'être enregistrés nous a fait, contrairement à un sentiment d'utopie, nous faire prendre conscience à chaque fois que c'était plus difficile que nous le pensions. Parce qu'au sein de la convention, on pensait que cela allait être approuvé, tout le monde s'inquiétait de finir à temps, c'était le seul problème. Mais bien sûr, à l’extérieur, vous avez commencé à réaliser que le système est bien plus enraciné dans la société, dans la terre, dans les communautés animales.
C. L.: Voyager avec le film, c'est partager ce désir, cette utopie et peut-être susciter aussi une envie de conversion dans un autre pays...
B. K.: Pour changer les choses !
C. L.: En France également, notre Constitution est issue d'un coup d'État. Pendant la guerre d'Algérie, le général de Gaulle a promu une Constitution dotée d'un pouvoir présidentiel très fort. En ce moment en France nous souffrons beaucoup de cette situation.
B. K.: Bien sûr il existe certains documents qui sont déjà obsolètes avec le temps… Et les envies de la société d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes. C'est, je crois, ce que représente le processus constituant au Chili, qui, oui, était utopique ! C'était un grand rêve... mais en même temps très beau, parce que justement nos générations actuelles veulent des terres respectueuses de l'environnement, elles veulent prendre soin des ressources, elles veulent une éducation pour tous, pour que les gens puissent penser par eux-mêmes. Ne plus être dans un contexte de dictature, de guerre où il faut consommer les ressources car sinon on va finir par être un pays très pauvre...
C. L.: Le désir politique peut-il se transmettre hors des frontières ?
T. U.: Oui, en tout cas et surtout en revenant à ce dont nous avons parlé sur le caractère ambitieux du projet ; Le projet constitutionnel est né de l'idée de changer cette Constitution, qui n'était pas démocratique et qui laissait beaucoup de choses bloquées qui permettaient, par exemple, qu'au Chili il n'y avait pas de droit au logement, qui permettait la privatisation de l'eau...
Ce sont donc des choses qui, peut-être, en les résolvant, nous auraient laissé en meilleur situation. Je crois que ce projet voulait aussi prendre en charge les défis que connaissent le monde entier et les démocraties contemporaines. Ce sont des problèmes nouveaux, surtout dans la façon dont nous les vivons... Je pense que c'était peut-être aussi quelque chose de très curieux pour le monde entier parce que si la Constitution avait été approuvée, ce serait une des Constitutions les plus récentes et plus ambitieuses malgré ses imperfections.

Agrandissement : Illustration 3

B. K.: Totalement avant-gardiste !
T. U.: Avec une intention avant-gardiste, oui, et en fait, cela me semble curieux que cette année-là également au Chili, 2019, il y ait eu de nombreux mouvements sociaux forts dans diverses parties du monde. Nous en étions un de plus, et aujourd’hui de nombreux mouvements parlent également de Constitution.
C'est quelque chose qui, bien sûr, était peut-être une discussion qu'on n'imagine pas tellement. il y a un besoin de se mettre à jour avec les problèmes actuels. Je pense que cela résonne beaucoup avec ce qui se vit dans de nombreux pays, dans certains plus que dans d'autres, mais ici en Europe, je pense que cela a aussi beaucoup résonné en France, en Allemagne, qui a à voir avec le conflit des médias, avec beaucoup de résurgence de l'extrême droite, la polarisation politique et cela nous aide aussi à réfléchir sur les outils dont disposent aujourd'hui les démocraties pour faire des changements... Il semble qu'il y ait là quelque chose qui n'est pas réalisé, qu'il y a d'autres forces plus puissantes.
B. K.: Peut-être que les mobilisations sont également obsolètes ? Peut-être que des réalisations telles que les oasis, les mouvements sociaux à travers le monde, nous invitent aussi à réfléchir précisément la mobilisation ? Si ces formes, la grève, la protestation, fonctionnaient il y a quelques siècles, elles ne fonctionnent plus aujourd’hui, alors qu’est-ce qui peut fonctionner pour générer un véritable changement ?
T. U.: Eh bien, au Chili, c'est curieux, parce que je pense que ce désir de désobéissance civile à grande échelle est quelque chose que nous, en tant que génération, considérions comme quelque chose d'impossible au Chili, parce qu'il y avait encore en nous quelque chose de l'ordre d'une obéissance à...
Je pense que le fait que ce processus, si populaire, si violent dans les rues, ait été transformé en quelque chose de si démocratique, d'institutionnalisé, en témoigne également de nombreuses personnes qui critiquent l'institutionnalisation du processus. C'est là que nous avons commis une erreur.
Quand j'étais à la convention constitutionnelle, que les gens de la presse disaient que, même pour nous qui étions là tous les jours, c'était très difficile de suivre le processus parce que c'est complexe, parce qu'on entend moins les débats, on entend l'article 1, l'article 2... Il y a donc quelque chose qui devient très aride et qui rend la tâche très difficile pour les gens.
Personne ne croit qu'il est possible d'apporter des changements en s'organisant, et les seules données qui sont restées aussi élevées qu'avant, c'était le niveau de colère et d'inconfort. Je pense que c'est aussi très intéressant parce que d'une certaine manière, cela nous rappelle que les demandes sont tout à fait actuelles et que nous devons nous en occuper d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi beaucoup de déception, beaucoup d’usure et de désenchantement face à cette grande énergie déployée à grands frais, c’est-à-dire des gens qui sont morts, des gens qui ont été touchés pour le reste de leur vie. Il y a pas mal d'usure et du moins, de mon point de vue, je crois qu'au Chili il y a beaucoup de culture politique parmi les lycéens, et je sens que cette force se renouvelle beaucoup plus vite.
B. K.: L'autogestion, des gens qui s'informent...
T. U.: Oui, mais il est encore en train de se régénérer.
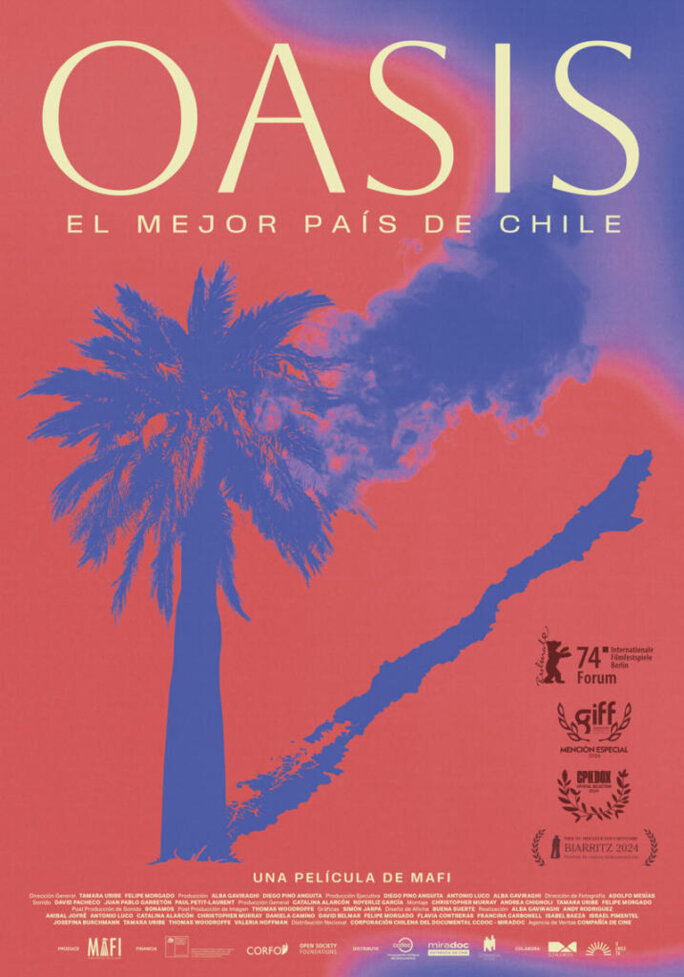
Agrandissement : Illustration 4
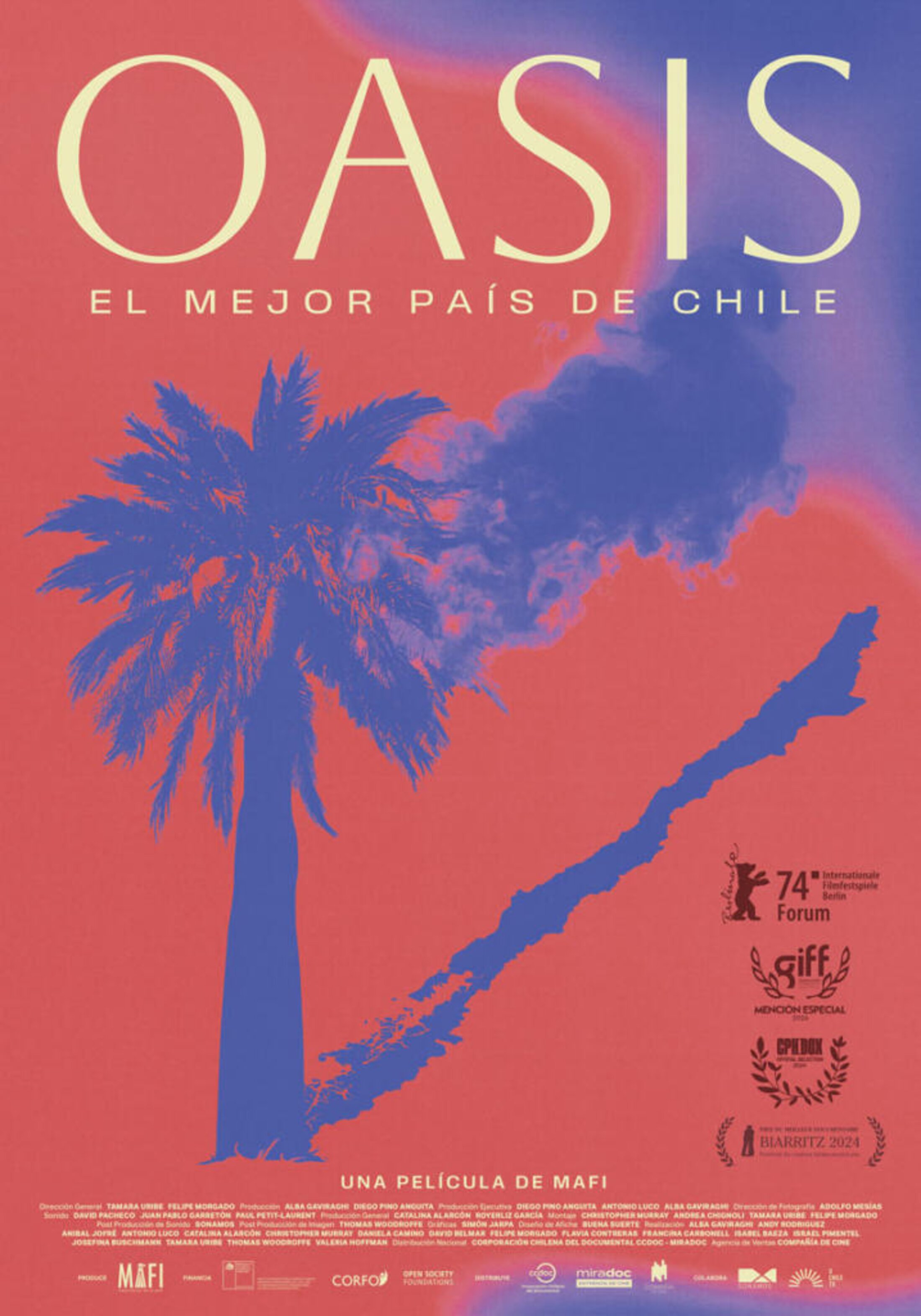
Oasis
de Tamara Uribe et Felipe Morgado
Documentaire
80 minutes. Chili, 2024.
Color
Langue originale : espagnol
Scénario : Tamara Uribe, Felipe Morgado
Images : Adolfo Mesías
Montage : Felipe Morgado, Tamara Uribe, Christopher Murray, Andrea Chignoli
Son : David Pacheco, Juan Pablo Garretón
Sound design : Roberto Espinoza
Production : Alba Fabiola Gaviraghi Espinoza, Diego Pino Anguita
Production exécutive : Alba Gaviraghi, Diego Pino Anguita, Antonio Luco
Société de production : MAFI Collective



