Dans son ouvrage, Marie Durand fait un récit autobiographique de ses années passées en Bolivie, de 1971 à 1985, en tant que responsable des actions de développement participatif auprès des femmes aymaras de communautés rurales. S’il est question dans un premier temps de sensibilités qui conduisent l’auteur à s’engager dans cette aventure et si la narratrice utilise la première personne du singulier pour s’exprimer, ce récit met en avant la découverte d’un pays au cours d’une histoire sombre et peu connue. Marie Durand arrive en Bolivie quelques années après la mort d’Ernesto Guevara qui avait tenté de lever un front révolutionnaire armé bolivien face à la dictature du général Barrientos. Le militantisme de Marie Durand ne s’affirme pas dans la clandestinité mais bien dans la reconnaissance du droit international : c’est le concept en plein essor alors du « développement participatif ». L’enjeu est pour elle d’insérer progressivement les femmes dans la vie politique locale et du reste du pays, en les invitant à gérer elles-mêmes l’aide alimentaire venue de pays étrangers. Il est aussi question de projets d’activités économiques féminines, qu’il s’agisse d’agriculture biologique ou d’artisanat, afin de créer des ressources locales. La période d’activité de Marie Durand est marquée en Bolivie par la dictature du général Banzer et la sinistre « doctrine de sécurité nationale ». Son expérience est aussi une opportunité de vivre de l’intérieur l’histoire de la Bolivie des années 1970 et comment des foyers de résistance ont pu malgré tout se maintenir, en même temps que le terreau essentiel du retour à la démocratie à venir. Alors que les politiques de développement sont sous le flot de nombreuses critiques de cette époque à nos jours, il est intéressant de pouvoir aiguiser son jugement à l’aune du témoignage d’une de ses actrices. Plus qu’un ouvrage de justification sur ses actions menées, il y a aussi cette part autobiographique du doute fondamental qui parcourt cette femme prise entre deux mondes, deux familles, deux cultures. L’auteur a en outre la pudeur de taire la vie personnelle de ses proches, afin de décrire davantage ses activités de terrain. On prend un véritable plaisir à lire ces différents chapitres comme une suite d’aventures trépidantes menant pas à pas à la compréhension des enjeux dans ces communautés rurales boliviennes qui conduiront quelques décennies plus tard à la présidence Evo Morales, même si le livre s’achève en 1985, date du retour définitif de Marie Durand en France. La lecture de cet ouvrage est en outre d’autant plus appréciable que son auteur s’y exprime avec une brillante aisance littéraire.
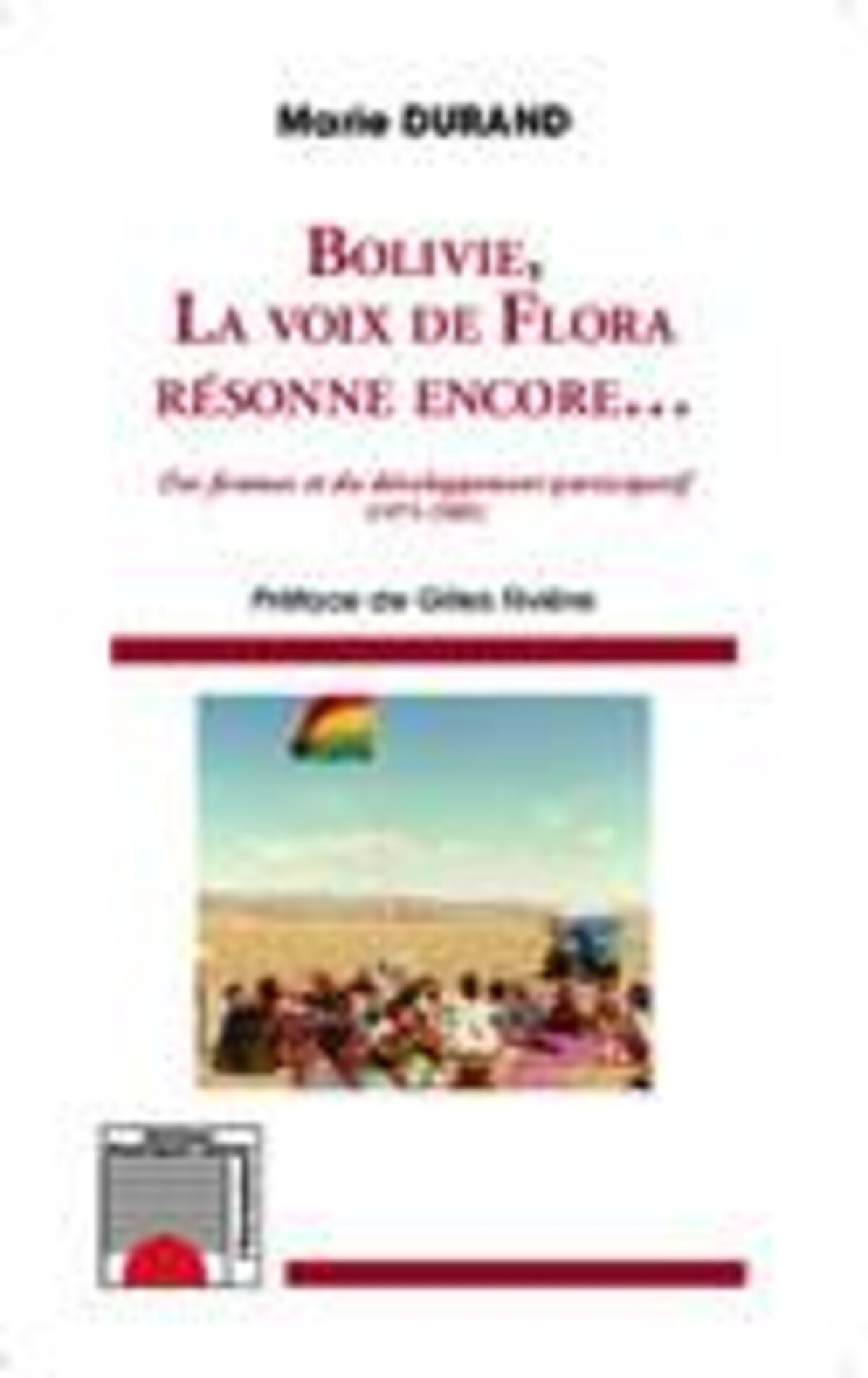
Bolivie, la voix de Flora résonne encore…
Des femmes et du développement participatif (1971-1985)
de Marie Durand
France, 2013.
Nombre de pages : 314
Date de sortie (France) : 22 octobre 2013
Prix public conseillé : 32,00 €
Éditeur : L’Harmattan
Collection : Horizons Amériques Latines



