
Cédric Lépine : Tout en plongeant dans l'histoire intime de votre protagoniste, le récit finit par se révéler politique au sens de la confrontation de son parcours face à la société urbaine : le dénouement est à ce titre éclairant. Comment avez-vous envisagé cette approche politique ?
Yennifer Uribe Alzate : Oui, c'est un personnage très politique, parce que d'une certaine manière, pour moi il est très important de trouver dans la vie de tous les jours les petits gestes qui finalement nous construisent en tant que personnes et qui nous permettent aussi d'être en relation avec l'autre, avec la communauté, avec le monde, avec l'extérieur, dans une dynamique plus ouverte, plus grande, plus large. Je crois donc que ce sont ces petits gestes qui nous transforment vraiment.
Il en est de même par exemple, du corps. Dans l'histoire de l'humanité, la colonisation a signifié soumettre, abuser et piller l'autre, prendre tout ce que l'autre a de précieux pour lui. Je pense que cela arrive souvent aux femmes, que le regard masculin et le regard de la publicité, le regard capitaliste aussi, de la télévision, de certains films, viennent utiliser le corps féminin d'une manière qui finit par ressembler à un corps très construit par un regard masculin, un regard hégémonique, un regard qui recherche une certaine complaisance.
Ici, c'est comme si la protagoniste était propriétaire de son corps, elle le découvre aussi. Je pense que ce que vit Sandra, c'est aussi un processus de découverte de son pouvoir dans la vie de tous les jours et qui consiste à se gouverner, gouverner son corps qui est son territoire, où personne ne va lui donner un avis, où personne ne va entrer, où elle le fait respecter. Je crois donc que le point de vue politique que je défends est là.
Pour moi, c'est quelque chose de très personnel, parce que pour moi, dans mes recherches, je pense que tous les manifestes et toutes les idéologies qui existent et qui nous aident à être libres, c'est très bien, mais je pense que c'est dans les petits gestes du quotidien, que l'on trouve vraiment la réalisation de tous ces slogans. Il s'agissait donc pour moi de construire un personnage qui découvre et façonne également sa force, comme s'il s'agissait d'un personnage pas nécessairement conscient de ce qui lui arrive. D'un autre côté, je pense qu'elle commence à se découvrir et à se comprendre dans la société.
C'est un personnage qui contraste, comme s'il y avait une force extérieure en elle, mais parfois aussi des faiblesses, c'est une femme seule. Nous sommes donc habitué es à penser que les femmes célibataires sont incomplètes, qu'il leur manque quelque chose. Lorsque son fils est avec sa petite amie et qu'elle est heureuse parce qu'ils sont à la maison et qu'ils vont partir, elle prend conscience qu'elle va être à nouveau seule mais elle finit par découvrir qu'elle n'a besoin de personne non plus.
C. L. : Tout ce que vous défendez ici politiquement dans votre film, passe par un souci méticuleux de la mise en scène plus que par le dialogue explicite. Pouvez-vous expliquer l'importance de générer des émotions pour comprendre une situation sociale ?
Y. U. A. : C'était un défi pour moi et c'est quelque chose que je me suis fixé dès l'écriture du scénario et même dès le moment où j'ai commencé à penser à ce film. En effet, je ne souhaitais pas de dialogue explicatif. Ce qui arrivait à Sandra ne devait pas arriver par des mots, mais par sa peau, par ses actions, pour que cela se passe comme si c'était plus un film d'actions que de mots, surtout parce que le dialogue a presque toujours la fonction d'expliquer, communiquer des informations et il fait aussi avancer l'intrigue. Ici, je cherchais plutôt une progression dramatique donnée dans les sens ou par les sens, où le public était amené à ressentir d'une certaine manière en même temps qu'il vivait les scènes. D'où l'importance de la musique, du son, des bruits, des voix, et aussi, par exemple, des textures, à commencer par celle de sa peau, mais aussi des murs, des objets, pour que tout l'univers qui l'entoure soit expressif.
Je souhaitais réaliser un film très sensible, qui donnerait aux spectateurs.trices l'impression d'être dans un bus à Medellín, de se promener dans la ville et d'écouter toutes les conversations. Je voulais donc explorer cela, comme s'il s'agissait d'un film expérimental d'une certaine manière, ou d'un film fantastique, comme s'il pouvait faire ressentir au public avant tout des émotions et des sensations.
C. L. : Pourquoi avoir fait de Medellín votre personnage central ?
Y. U. A. : La vie urbaine de Medellín a été une grande source d'inspiration pour moi. Le film est donc le fruit de ma vie dans la ville, de mes promenades dans la ville, de mes trajets en bus à Medellín, de mon expérience personnelle. Je pense que le film, les détails et tout l'univers qui est construit, est également dû à cette expérience. Le fait que mon moyen de transport à Medellín soit le bus ou la marche, que je vive et vienne d'environnements qui ne sont ni centralisés ni hégémoniques, mais plutôt de quartiers plus périphériques, pour ainsi dire.
C'est donc comme si toute ma fascination pour la ville et pour ces dynamiques de quartier était concentrée dans ce film. Bien sûr, il y a eu des décisions esthétiques qui m'ont permis de contenir cette ville en tant que personnage sans entrer en compétition avec elle. C'est comme si la ville était toujours présente, ainsi que tout ce qui se passe autour d'elle, sans avoir à filmer d'autres choses, mais que tout passait par elle. Comme si la ville entière était traversée par sa propre expérience.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : Teniez-vous également à raconter une histoire d'amour en déconstruisant le modèle traditionnel ?
Y. U. A. : Au début, on pourrait croire qu'il s'agit d'une histoire d'amour, quand une fille rencontre un garçon. En revanche, je souhaitais déconstruire complètement les codes du mélodrame classique et des films d'amour, même dans le cinéma latino-américain où le réalisme social de la violence est si important.
Je souhaitais aussi sortir du réalisme social incarné avec force par Víctor Gaviria, le cinéaste qui a immortalisé Medellín dans les festivals internationaux et qui est longtemps resté une grande référence. Je voulais défendre une voix alternative contre tous ces genres locaux, nationaux et étrangers qui pèsent sur le cinéma. Lorsque j'ai commencé à avancer dans l'écriture, dans la recherche et le développement du film, j'ai réalisé que, plus qu'un film sur l'amour entre un homme et une femme, La Piel en primavera est un film sur le désir d'une femme.
Il y a de l'amour, par exemple, pour son fils, pour ses amies, pour son travail aussi, parce que finalement le travail ici n'est pas présenté comme quelque chose d'asservissant, mais peut-être plutôt comme quelque chose d'émancipateur, d'une certaine manière, et nous devrions en parler davantage. Ce travail de Sandra en tant qu'agent de sécurité, mais aussi celui de ses collègues est difficile et représente la classe moyenne ouvrière, non seulement le travail.
C'est aussi comme si toutes ces heures de travail n'avaient pas eu raison de ces corps qui sont aussi des corps qui désirent, qui demandent du plaisir, qui vivent du plaisir. Le travail coexiste et leur donne en fait plus de vie.
C. L. : Le travail est en effet omniprésent dans votre film. C'est pourquoi votre film est politique, parce qu'il parle de la nécessité de survivre ou d'avoir un emploi.
Y. U. A. : Je souhaitais rendre le travail et certains emplois plus dignes parce que ces emplois sont ceux qui soutiennent une société. Les emplois qui se trouvent au bas de la pyramide soutiennent tout. Il s'agit donc aussi par le film de démocratiser la représentation de leurs plaisirs, comme s'ils n'étaient pas seulement définis par leur travail mais bien au contraire.
Le film entretient une horizontalité entre les personnages sans enjeu de pouvoir sur l'autre. Il y a aussi une horizontalité narrative dans le sens où chaque plan est une scène et chaque scène a une valeur en soi qui ne dépend pas de la valeur qu'elle donne à une autre. Dans le cinéma narratif classique, on trouve la relation de cause à effet où chaque élément est plus fort que le précédent et ainsi de suite jusqu'à atteindre un point culminant, comme une relation progressive.
Ici, je voulais que chaque situation soit un événement esthétique en soi qui me permet également de penser au présent. Il s'agissait ainsi d'ancrer les personnages dans un présent absolu où il n'y a pas d'attentes envers l'avenir mais où il n'y a pas non plus de mention d'un passé qui doit être résolu.
Quand Sandra mangeait, elle mangeait vraiment, et elle le faisait à ce moment-là, comme dans la vie de tous les jours, nous n'avons presque pas de coupures. J'étais ainsi très intéressée par le respect du temps des actions et du travail des acteurs et actrices dans cet espace et dans ce temps continu, sans manipulation, et pour que l'émotion vienne de là. C'était un vrai défi parce que nous sommes habitué.es aux ellipses, à créer de l'emphase pour donner du rythme, mais ici nous recherchions un rythme de tous les jours.
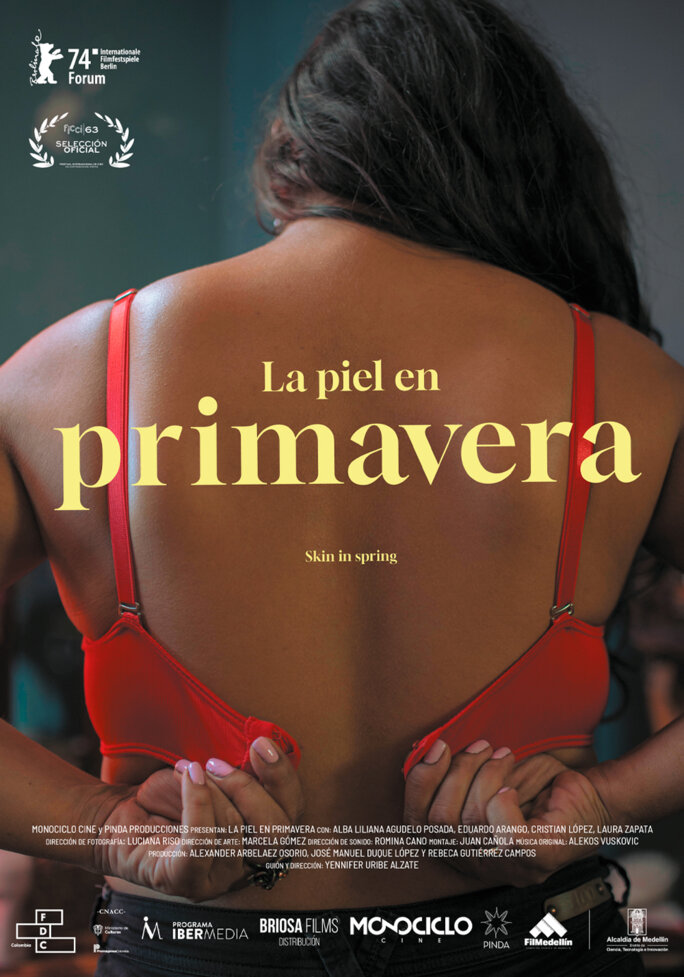
Agrandissement : Illustration 3
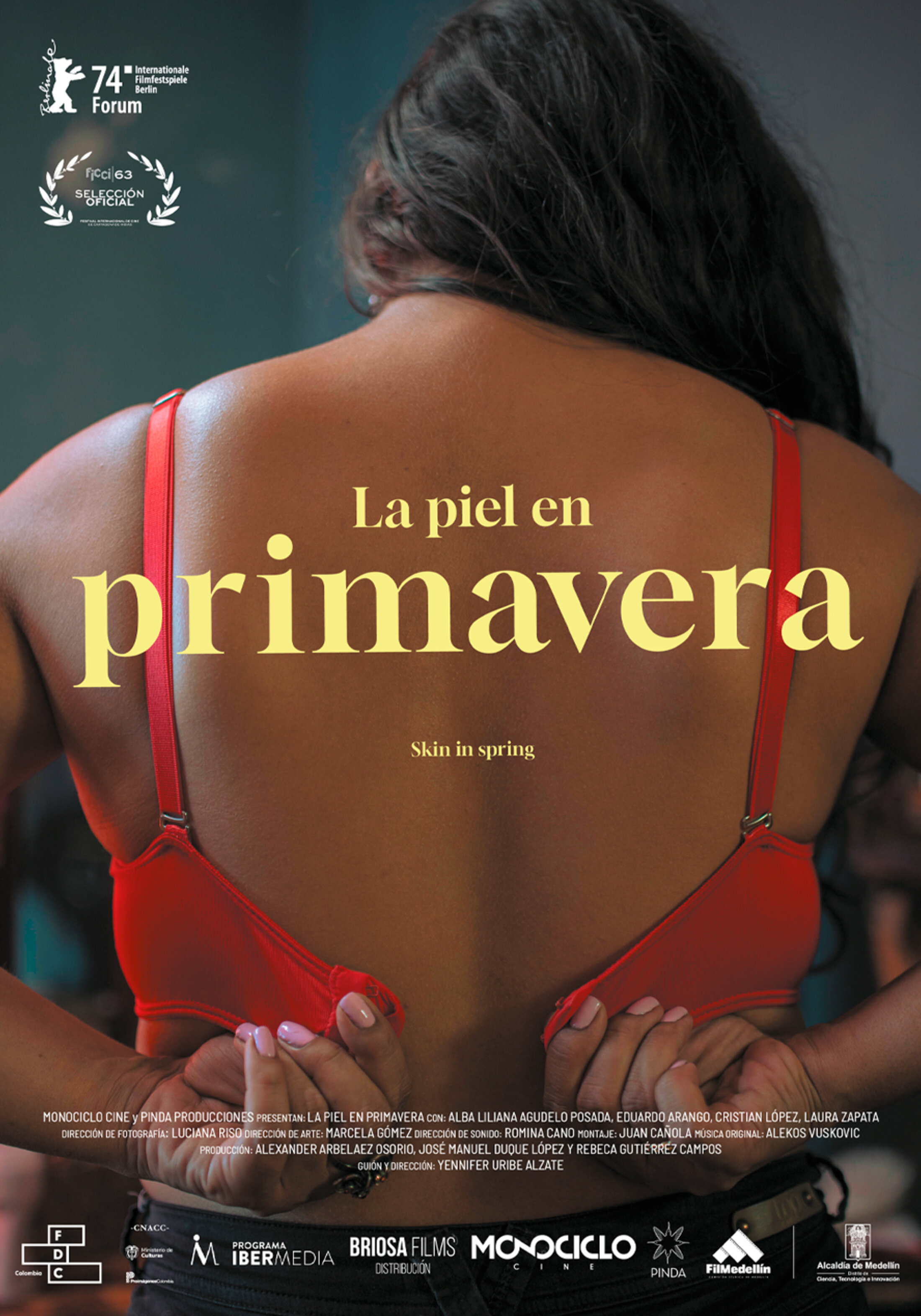
La Piel en primavera
de Yennifer Uribe Alzate
Fiction
100 minutes. Colombie, Chili, 2024.
Couleur
Langue originale : espagnol
Avec : Alba Liliana Agudelo Posada Sandra), Luis Eduardo Arango Correa (Javier), Julián López Gallego (Julián), Laura Zapata Acevedo (Andrea)
Scénario : Yennifer Uribe Alzate
Images : Luciana Riso Soto
Montage : Juan Cañola Vélez
Musique : Alekos Vuskovic
Son : Romina Cano
Direction artistique : Marcela Gómez Montoya
Décors : Marcela Gómez Montoya
Costumes : Juliana Hoyos Vivas
Maquillage : Juanita Santa Maria Vélez
Production : Alexander Arbelaez Osorio, Jose Manuel Duque López
Coproduction : Rebeca Gutierrez Campos
Production exécutive : Jose Manuel Duque López, Rebeca Gutierrez Campos, Alexander Arbelaez Osorio, Miguel Yilales Agelvis
Sociétés de production : Monociclo Cine, Pinda Producciones



