
Agrandissement : Illustration 1

Adeline Bourdillat : Quand le projet de ton film, Alba, a-t-il commencé ?
Ana Cristina Barragán : J’ai commencé à le filmer à l'université de cinéma à Quito en 2010, et mon projet de thèse était le scénario du film. À ce moment-là, c'était encore un projet très « en superficie », puis j'ai travaillé sur le scénario pendant trois ans. En 2010, je l’ai inscrit à un concours de scénarios en Équateur et j'ai gagné le prix de 8000 dollars qui a permis de le développer encore un peu plus. J'ai donc travaillé sur le scénario tout au long de cette année-là, et on a commencé à envoyer des éléments au Mexique. Ensuite on est allé au Morena Lab, au RivieraLab et aussi à une rencontre d'auteurs mexicains. Le scénario est aussi passé par un atelier du Talent Campus de Buenos Aires et au BAFICI (Festival International de Cinéma Indépendant de Buenos Aires), ce qui fut une expérience formidable parce qu'il a pu se développer encore davantage. L'exposer à d'autres regards aussi, en dehors de l'Équateur, où il n'y a pas autant d'espaces critiques, a été très sain. Et en même temps on continuait à obtenir des fonds. On a obtenu un fond de développement au « Consejo de Cine », et un autre fond de production au même « Consejo de Cine » l'année suivante. Dès lors, nous étions prêts à tourner. Le tournage a duré six semaines. Et au travers de tous ces voyages à Mexico s'est formée cette coproduction avec le Mexique, de manière naturelle. Je souhaitais que le directeur artistique du film soit mexicain. La relation était bien organique. Donc quand on a commencé à tourner on avait déjà cette coproduction. Le casting s’est déroulé sur cinq mois, où six cents jeunes filles se sont présentées avant de trouver la protagoniste. Ensuite, le processus de montage a duré autour d’un an et demi. J'avais commencé à faire une version du film différente du scénario. Jamais je ne me suis tenue à faire une version calquée sur le scénario, je me suis donc perdue, puis je suis revenue au scénario. Le scénario fonctionnait beaucoup mieux que l'autre version ! Il y a eu trois monteurs pendant tout le processus. J'ai énormément appris du montage. Et au final, le processus de post-production du son et de la couleur a été un peu plus serré parce qu'on a été sélectionné au festival de Rotterdam. Quand nous avons su que nous étions sélectionnés, nous avons décidé d'accélérer un peu les choses pour pouvoir y arriver. Donc le processus autour du son a duré à peu près un mois, mais on est arrivé à Rotterdam avec un son provisoire... Que je suis en ce moment même en train de terminer. Et pour la couleur aussi, ça a duré autour d'une semaine et demie.
Cédric Lépine : À propos du casting, quels ont été les critères qui t’ont conduite à choisir Macarena Arias dans le rôle d’Alba ?
Ana Cristina Barragán : Je cherchais une jeune fille qui ait une énergie très spéciale, un mélange entre quelqu'un d'un peu étrange et qui aurait quelque chose d'hypnotique, de très contenu. Je voulais qu'avec peu de gestes et peu de réactions on puisse entrevoir un monde intérieur assez profond. Une jeune fille qui serait à la fois belle, étrange, et aussi qui ait un âge bien particulier. Les filles qui ont cet âge sont au bord d'être consciente d'elles-mêmes, parce qu'elles sont en train d'entrer dans un âge dans lequel on commence à voir les choses depuis l'extérieur. Elles commencent à être conscientes de qui elles sont, et de comment jouer ; avec beaucoup de pression sociale. Et à la fois il est possible d'avoir 11 ans et d'avoir encore ce côté très enfant, où tu te laisses porter, où tu te mets dans un jeu. J'ai rencontré beaucoup de jeunes filles lors de ce casting qui étaient très dépendantes de leur propre image, qui voulaient savoir si elles étaient belles, etc. Et j'ai rencontré d'autres jeunes filles du même âge qui ne parvenaient pas encore à s’immerger. Macarena, elle, réussissait à s’immerger totalement. De plus c'était une jeune fille très mature, parce qu'elle était dans une situation assez particulière. Sa maman avait une maladie très grave, un peu comme dans le film. Sa situation de vie en a fait une petite fille très mûre pour son âge. Du coup elle était très impliquée. J'ai tourné six semaines, tous les jours, c'était beaucoup d'heures de travail, et elle n’abandonnait jamais. Évidemment, il y avait des moments où elle était plus fatiguée, mais elle n'a jamais laissé tomber. La préparation avec elle a été assez dense, parce que c'était une fille très intelligente mais parfois elle avait du mal à « sentir ». Ainsi, on a fait une session d'essais de deux mois et demi de sensibilisation, où elle a appris à manger les yeux fermés, à peindre la couleur de ses émotions, jusqu'à « jouer à sentir » pour que cela paraisse naturel. C’est ainsi qu’elle a vraiment commencé à « sentir » : être face à la caméra, mais en train de « sentir ». L'avantage c'est que c'était une fille très forte, très extravertie, contrairement au personnage du film. Elle était surtout très sensible, comme le personnage, mais aussi très sûre d'elle-même, entourée de beaucoup d'amies, ce qui était super, du coup elle n'était pas trop affectée par le scénario.

Agrandissement : Illustration 2
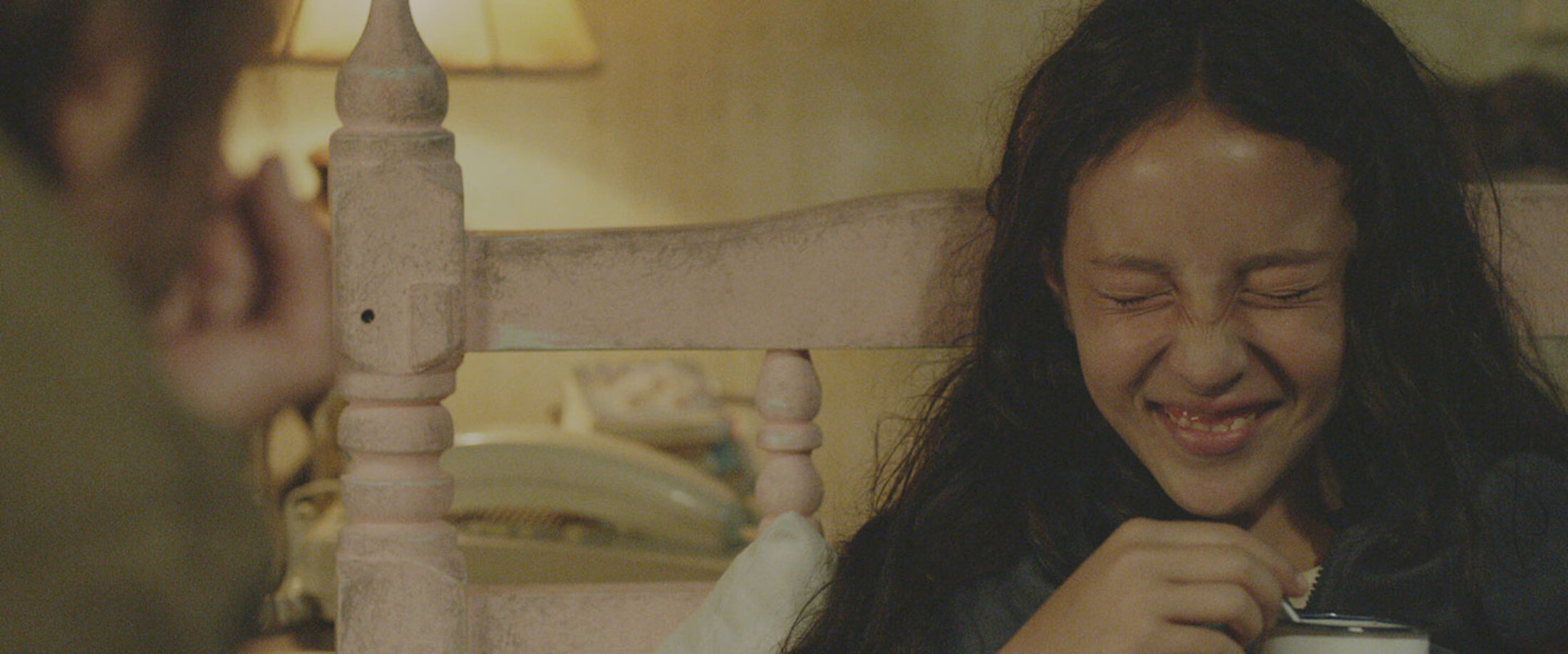
Cédric Lépine : Comment s'est passé le tournage ? Tu as tourné de manière chronologique ?
Ana Cristina Barragán : Oui, le tournage était pour l’essentiel dans l’ordre chronologique du scénario, mais en fonction aussi du lieu de tournage. Par exemple, si on était dans la maison du père on filmait tout de manière chronologique, mais on tournait toutes les scènes qui se passaient dans sa maison en une fois. On les sortait du scénario et on les regroupait. Pareil pour le collège. Et s'il y avait un moment où elle devait passer d'une émotion à une autre, là oui évidemment, c’était un peu plus compliqué. On faisait toujours un essai avant de filmer avec elle ou avec le père. La direction d'acteurs a été très importante pour moi sur ce film.
Adeline Bourdillat : Pourquoi as-tu choisi d'explorer ce thème de la vie intérieure d'une jeune fille de 11 ans ?
Ana Cristina Barragán : Pour certaines raisons j'étais dans cette nécessité de parler de cette forme d’angoisse de la préadolescence. J'ai fait trois courts métrages avant et dans les trois il y avait des jeunes filles de 11 ans. Et c'est un thème que j'avais en moi. Le film ferme un peu ce thème issu de ma vie, je suppose qu'à présent je parlerai d'autres choses. Mais oui, j'étais dans cette nécessité de traiter de cette anxiété, de ce mélange entre tendresse et douleur, de cette arrivée dans l'âge adolescent. Je suppose que cet âge a aussi été un moment très fort de ma vie à moi, d'une autre manière. J'étais donc dans une forme d'urgence, de parler de cet âge, et aussi de la nécessité d'acceptation, de ce qui est apparemment normal... La normalité extérieure dans laquelle les personnages évoluent et combien Alba se sent étrange, comme son père, ou ce qu'il y a à l'intérieur d'elle-même ou du père, comme par exemple cette timidité extrême... En comparaison de personnages qui sont sans cesse en train de parler, qui évoluent dans un monde apparemment très normal auquel elle aimerait appartenir, mais elle ne peut pas. Et d'un autre côté, je ne pense pas que ce film soit autobiographique, mais plutôt très personnel. Il y a donc aussi des choses qui se réfèrent beaucoup à ma vie, par exemple le fait que durant mon adolescence j'ai vécu une rupture très forte avec mon père. J'étais très proche de lui quand j'étais petite et ensuite il y a eu cette rupture, ça m'a beaucoup marqué. Aujourd'hui tout va bien mais bon... Même si la situation dans le film est très différente de ma vie, je voulais parler de cette rupture.
Cédric Lépine : En tant que spectateur on ne voit pas seulement les choses par le regard d'Alba, on est aussi en dehors de son regard, on peut voir ce qui se passe du côté du père et éprouver une certaine sympathie pour lui. Comment as-tu pensé les points de vue et la vision du spectateur ?
Ana Cristina Barragán : Le point de vue du film se construit à partir de son regard à elle. Le film est très proche d'elle, le spectateur vit ses émotions à elle. Pour ce qui est du père, c'était très important pour moi qu'on ressente de l'empathie pour lui. Ça a été une décision difficile. À un moment ça a été difficile de choisir s'il y aurait des scènes où l’on verrait seulement le père, ou pas. Il est possible que j’aie dit à certains moments que le père apparaîtrait seulement quand il y a Alba. Mais à un moment le voir encadrer le puzzle, ou voir certaines choses de lui seulement, permettait que le spectateur puisse se connecter avec lui. Et c'était important pour l'histoire d'Alba. Parce qu'on doit comprendre que le père essaye de se rapprocher de sa fille. C'est un point sensible, parce que le père peut apparaître à première vue comme un personnage très froid. Si le spectateur ne peut pas voir son côté sensible il passe à côté de ce qui la concerne, elle. Donc la décision a été de varier de temps en temps les points de vues, de passer de temps en temps à son point de vue à lui. Je crois que le film tisse sans cesse des fils entre des choses très proches d'Alba et des choses que le spectateur doit voir de l'extérieur et comprendre, comme pour le thème du harcèlement scolaire, ou parfois comprendre des choses qui sont au-delà d’Alba.
Adeline Bourdillat : D'un autre côté tu travailles aussi sur les petites choses, sur l'infiniment petit, comme pour le papillon. Tu mets aussi beaucoup de silence dans ton film. C'était une manière de laisser l'espace suffisant à l'exploration de l'intimité d'Alba ?
Ana Cristina Barragán : Oui, les détails dans le film son très importants. Il y a des plans très serrés comme pour le papillon, ou ses doigts à elle qui caressent sa mère, ou les mains du père... C'était une idée de direction, qu'avec ces tous petits détails on pouvait entrevoir des choses plus grandes. En fait j'aime les films où les détails sont très importants. Par exemple, les films de Lynne Ramsay, Ratcatcher ou We need to talk about Kevin. Ce sont des films dans lesquels les détails disent parfois beaucoup, comme des métaphores de choses plus grandes qui sont en train de se passer. Mais aussi, plus que raconter une histoire, ce qui m'intéresse c'est donner une sensation. Quand je commence à écrire un scénario, bien plus que penser une histoire je pense à la sensation que va donner cette histoire. Et ensuite apparaissent les conflits et tout ça. Quand tu penses aux sensations, souvent, ce sont des images qui viennent en premier. Les premières images qui me sont venues en tête quand j'ai commencé à écrire le scénario sont restées jusqu'au résultat final. Comme cette petite fille qui nage dans une piscine pleine de vieilles dames et de corps plus gros, on passe d'une féminité presque grossière à ses premières règles. Ce sont des sensations ponctuelles, qui restent.

Agrandissement : Illustration 3

Cédric Lépine : Nous pouvons aussi voir tout cela comme une invitation à explorer nos propres expériences, à revivre des sensations que l'on a déjà connu. Comme par exemple ce moment des premières règles, c'est un souvenir que toute femme a en mémoire. Il y a aussi le thème de la relation du père et de sa fille. Le père souffre beaucoup de ne pas pouvoir exprimer ouvertement à sa fille tout l'amour qu'il ressent pour elle.
Ana Cristina Barragán : Oui, il paraît toujours très limité dans l'expression de ses sentiments. Je crois que les deux personnages sont très limités dans leur capacité à communiquer. Ils sont tous les deux très seuls, ils pourraient se tenir compagnie, mais ils n'en ont pas la capacité. Ils sont prisonniers de leur solitude et de leur timidité. J'aime beaucoup les films qui laissent comme une saveur, quelque chose qui perdure dans le temps. Une atmosphère, une saveur, une sensation, bien plus qu'une histoire ponctuelle. Je crois que ça a beaucoup plus de force quand ça te reste dans le temps, parce qu'il en est ainsi de la vie en général. Le thème des règles, je l'avais déjà exploré dans un court métrage. Et je me rappelle qu'une fois je me suis réveillée autour de 4 heures du matin parce que j'avais soif. Je suis donc allée à la cuisine, j'ai bu plusieurs verres d'eau, et là une image m'est venue, de coccinelles descendant des cuisses puis des jambes. J'ai beaucoup pensé à cette image des règles, et j'ai fait un court métrage dont l'idée principale était cette image : une fillette qui fermait les yeux, qui rêvait qu'elle courrait dans un champ dans un paysage très beau, comme une image très belle de l'enfance, et d'un coup apparaissait une coccinelle qui descendait de sa robe, et ensuite de plus en plus de coccinelles. Ça représentait cette sensation un peu embrumée de lorsque l’on commence à grandir. D'un coup on le rationnalise. Mais ce qui vient en premier c'est une sensation. La sensation me paraît toujours beaucoup plus pure, beaucoup plus honnête.
Adeline Bourdillat : Tu parles des sensations. Le traitement de la lumière semble aussi participer à tout cela. Comment as-tu pensé le traitement de la lumière dans ton film ?
Cédric Lépine : Et la lumière en relation avec les lieux, aussi. Par exemple cet espace très fermé de la maison du père dans lequel à un moment la lumière entre, comme une invitation à voir que la vie est à l'extérieur. Il y a beaucoup d'ombres dans cette maison, que l’on peut aussi voir comme un lieu très « émotionnel » ou « psychologique », où l’on peut notamment rencontrer la psychologie du personnage du père. C’est comme si à un moment il fallait sortir de là, revenir à la lumière. Et ton film commence avec la lumière, dans cette première scène où Alba est dehors. Et dès que le père arrive, l'espace et la lumière se ferment.
Ana Cristina Barragán : Oui, je suis personnellement très sensible à la lumière, dans ma vie personnelle. S’il se met à pleuvoir je vais être triste toute la journée, s’il le ciel est ensoleillé je vais me sentir heureuse. Je me sens très connectée à la lumière. C'est très inconscient. La lumière, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, dans le sens où c'est elle qui m'apporte énergie et motivation. Donc les décisions que j'ai prises sur le traitement de la lumière ont été prises de manière tout à fait inconsciente. J’ai donné comme consigne au directeur de la photographie que la lumière paraisse la plus naturelle possible. Nous n'avons presque jamais utilisé de lumière artificielle pour ce film. La sensation que je voulais donner, c'était que la maison du père soit un lieu très fermé, très étrange, et que quand Alba se rapproche de la lumière c’est qu’elle se sent mieux. Quand ils sont à la plage et qu'il y a ces plans généraux avec beaucoup de lumière, elle se sent super bien. Lorsqu'elle ouvre la fenêtre de l'étage et que la lumière entre, c'est un moment bien à elle. Et tout le reste du film est beaucoup plus fermé. Il y a aussi des moments au collège où il y a de la lumière, mais il y a aussi ces fillettes qui sont là, qui font que ce moment à passer lui paraît interminable et très inconfortable.
Cédric Lépine : On a beaucoup parlé d'intimité, mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir aussi dans ton film une forme de portrait de la société d'aujourd'hui ? Il traite aussi du grand thème des différences sociales. Alba ne se sent pas à l'aise avec ses amies parce qu'elle provient d'un autre monde social. Comment peut s’envisager ce thème des discriminations sociales dans ton film ?
Ana Cristina Barragán : Mon idée de départ était qu’Alba, son père et sa mère vivaient ensemble quand elle était petite, et lorsque Alba et sa maman sont parties, le père est resté bloqué dans une classe sociale à laquelle peut-être il n'appartenait pas avant. Ce personnage, qui était peut-être plutôt issu de la classe moyenne, s'est retrouvé coincé à travailler dans cette administration des registres civils dans un état dépressif. Il est arrivé là, s'est adapté et est resté dans ce monde-là. Mais d'abord, il y a une différence entre Alba et son père, parce qu'Alba et sa mère n'appartiennent pas non plus à une classe sociale très élevée, mais il y a des éléments, par exemple Alba est inscrite dans ce collège, etc. De toute façon, économiquement parlant elles ne sont pas en bonne posture parce que la mère est malade, donc déjà un peu en marge. Pour ce qui est de la discrimination que les fillettes exercent sur Alba, il s'agit plus du fait qu'elle paraît un peu étrange, un peu abandonnée parce que sa maman est malade, que d'un motif de différence de classe sociale. En revanche, la honte que ressent Alba face aux filles de sa classe concernant son père, là oui, ça a à voir avec le thème de sa classe sociale. Comme quand elle va dans cette maison d'une des filles de sa classe, qu'elle voit tous ces objets, et qu'elle ressent ce besoin de voler des choses, mais par nécessité. Il y a deux choses, ça et la manière dont elle voit ces jeunes filles. Ce n'est pas tant une question de savoir que leur famille ont de l'argent, que le fait qu'elles paraissent plus âgées, plus assurées, plus adolescentes, alors qu'elle continue d'être une petite fille. Comme ces conversations des filles qui racontent leurs voyages, et la réalité d'Alba qui est totalement opposée à cause de la situation économique de son père et de la maladie de sa mère. En Équateur, à présent, je pense que le harcèlement scolaire est relativement repéré, que tout le monde connaît, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Par exemple, moi j'étais dans un collège où ce type de problème était très présent. Il y avait des filles un peu comme Alba, très angoissées, qui passaient leurs journées à se gratter les jambes tellement elles étaient nerveuses du fait que les autres les embêtaient ou se moquaient d'elles. Par exemple, l'une d'elle venait d'un collège de classe plus populaire. Je me rappelle quand elle est arrivée... Toutes les filles mettaient des chaussettes bleues, qui allaient avec l'uniforme, et elle, elle venait au collège avec des chaussettes blanches, parce qu'elle ne savait pas. Il y avait certains détails qui faisaient que ça se voyait, qu'elle venait d'un autre milieu, et moi je ressentais la même chose que mes amis de classe. Mon collège était plutôt un collège de classe moyenne, en général ce genre de constat se fait plus dans les collèges de classes plus aisées. Je crois que c'est quelque chose qui se passe dans le monde entier, je ne pense pas que cela soit particulier à l'Équateur. Je pense que maintenant c'est un peu moins présent, parce qu'il y a plus de contrôle sur tout ça. Enfin, oui, le harcèlement dont il est question dans le film est un mélange entre le thème de la différence de classe sociale et celui de l'étrangeté d'Alba.
Cédric Lépine : L’un des intérêts du scénario tient au fait qu’il traite d’un père qui rencontre des difficultés à la fois émotionnelles, psychologiques et économiques. Dans ces conditions et aux vues de toutes les responsabilités que requiert le fait de s’occuper d’une jeune fille qui va entrer dans l’adolescence, il semble très difficile d’être père. Le père d’Alba ne peut pas lui donner ni le confort ni la protection dont elle a besoin pour pouvoir se construire.
Ana Cristina Barragán : Je crois que ce qui est difficile c’est qu’Alba entre dans un âge de floraison, d’épanouissement, mais qu’elle ne peut pas s’épanouir. Parce qu’elle est dans un âge très sensible dans lequel si l’on n’a pas toute l’attention de nos parents, cette acceptation de notre évolution ne peut pas avoir lieu, parce que grandir est un grand changement. Si personne ne t’accepte, autour de toi ou au collège, avoir un semblant d’acceptation à la maison serait ce qui pourrait aider à grandir. Et ce qui se passe pour Alba au départ c’est qu’il ne s’agit pas d’un épanouissement mais au contraire d’un blocage, d’un obstacle. Dans un sens il n’y a aucune beauté, il y a surtout de l’angoisse. Et d’un autre côté je voulais parler de ce thème social de manière subtile et liée à l’intimité de l’histoire, dans cette précarité, dans cette maison… En partant plutôt des différences qu’il y a. Par exemple le père lui prépare un œuf mais la manière dont il l’a préparé ne plaît pas à Alba ; il lui prépare une soupe mais elle n’aime pas cette soupe. Elle ne mange presque rien de ce que son père lui prépare. Ou quand son père fait l’effort de l’emmener au cinéma alors qu’il a si peu d’argent, elle n’en profite pas car il l’emmène voir un film qui s’adresse à un public beaucoup plus jeune, alors qu’elle souffre à ce moment-là de l’absence de sa mère et du fait qu’elle est malade. Donc oui, c’est un sujet très présent, mais que je voulais lier à la réalité et à l’intimité de l’histoire, comme quelque chose qui en faisait partie intégrante. Et le manque de soutien dont souffre Alba n’est pas tant économique qu’émotionnel. Le père a un problème social très important. Bien au-delà de ses problèmes économiques, c’est un ermite plein de blocages qu’il ne parvient pas à dépasser de manière suffisante pour pouvoir s’occuper de sa fille.

Agrandissement : Illustration 4

Cédric Lépine : Tu as étudié en Équateur, puis tu es allée présenter ton projet dans d’autres pays. Comme si le projet s’était construit petit à petit, avec quelque chose qui ne vient pas seulement de toi mais aussi de l’international, d’idées, d’intérêts et d’influences qui viennent d’ailleurs. Comment la vois-tu, cette histoire très personnelle qui peu à peu t’amène à travailler avec d’autres personnes, dans d’autres pays, jusqu’à la Grèce ?
Ana Cristina Barragán : Tout cela a été pour moi comme un cadeau énorme, parce qu’en Équateur, il s’agit d’un cinéma qui commence tout juste, qui n’a pas encore beaucoup de références, qui est tout juste en train d’émerger. Si je n’avais pas eu la possibilité d’aller au Mexique ou en Grèce, ou dans certains labos à Buenos Aires, ce projet serait resté à un état beaucoup plus limité, faute d’avoir été exposé à d’autres regards plus expérimentés. Ces expériences m’ont fait grandir énormément, moi et le film. C’est très impressionnant. Par exemple, quand j’ai vu le film à Rotterdam, j’étais entourée de sept cents personnes, dans une salle gigantesque. C’était complètement fou, parce que c’était la première fois que je le voyais en salle, et c’est un projet qui remonte directement de ton cœur cinq ans auparavant et d’un coup ça devient une réalité projetée sur un écran, vue par sept cents personnes dans un autre pays. Des personnes qui n’ont rien à voir avec l’Équateur, mais d’un coup cette réalité leur apparaît. Tout cela m’a fait énormément grandir. Et travailler avec des gens du Mexique ou de Grèce, a été super intéressant parce que cela m’a permis d’appréhender leur propre vision du film, parce qu’ils viennent d’une culture très différente, et à la fois, ils ressentent une certaine empathie pour certaines choses. Cela m’a fait évoluer énormément de pouvoir travailler avec des gens qui avaient beaucoup plus d’expérience que moi. Ainsi, le monteur du film avait déjà monté trente films, alors qu’en Équateur aucun monteur n’a déjà fait trente films. Donc c’est un pas de plus en avant. Et c’est par là que je veux aller. Maintenant j’aimerais réaliser certains films avec des coproductions, ou aller filmer à Mexico, etc. Je reviendrai toujours en Équateur parce que je pense qu’il y a là-bas quelque chose de très riche, et parce que je viens de là-bas. Il y a aussi un certain silence. L’Équateur a cela de particulier, pas autant de références, de salles de cinéma, ou de bonnes écoles… Les bonnes écoles existent mais pas autant que dans d’autres pays… Il y a donc une forme de silence, et ce silence ouvre un espace qui permet de créer et de pouvoir s’entendre soi-même. Ce que je ressens, c’est que si j’avais étudié le cinéma à Paris, ou à Buenos Aires, ou dans d’autres endroits où le cinéma est très développé, j’aurais été entourée de tant de références et de choses qu’il aurait peut-être été difficile pour moi d’entendre ma propre voix de manière aussi claire que dans ce silence que je trouve en Équateur. C’est un mélange entre ça, et le fait d’exposer le film à d’autres regards.
Adeline Bourdillat : Quels sont tes projets ?
Ana Cristina Barragán : En ce moment je suis en train d’écrire deux scénarios. L’un s’appelle La Piel pulpo et l’autre Mujer conejo. Quand j’ai terminé Alba, j’ai appris beaucoup de choses. Je vois le film, je sens qu’il a une âme, mais je vois aussi sur quoi je me suis censurée. Comme si l’on était prêt à tourner un premier film juste le jour où on le termine. J’ai cette impression que tout ce que t’enseigne un premier film, aucun autre film ne pourra te l’enseigner. Et à présent je souhaite insuffler tout cet apprentissage dans un autre projet. J’ai commencé à écrire ces deux scénarios il y a un petit moment, et je ne souhaite pas prendre trop de retard. J’aimerais mettre moins de temps cette fois à réaliser ces deux projets, peut-être trois ans au lieu de cinq. L’un d’eux traite de la relation de deux frères à l’âge adulte qui perdent leur sœur. Il s’agit de leur relation très intime, sur une plage, où les animaux ont une place très importante : les mollusques, les raies… C’est une histoire qui revêt aussi un caractère sexuel. Et l’autre histoire c’est une histoire de fantasmes, qui aborde beaucoup de thèmes féminins difficiles. Je suis contente de ces deux projets.
Entretien réalisé par Cédric Lépine et Adeline Bourdillat le 14 mars 2016 dans le cadre des 28e Rencontres Cinélatino de Toulouse. Traduit de l'espagnol par Adeline Bourdillat.



