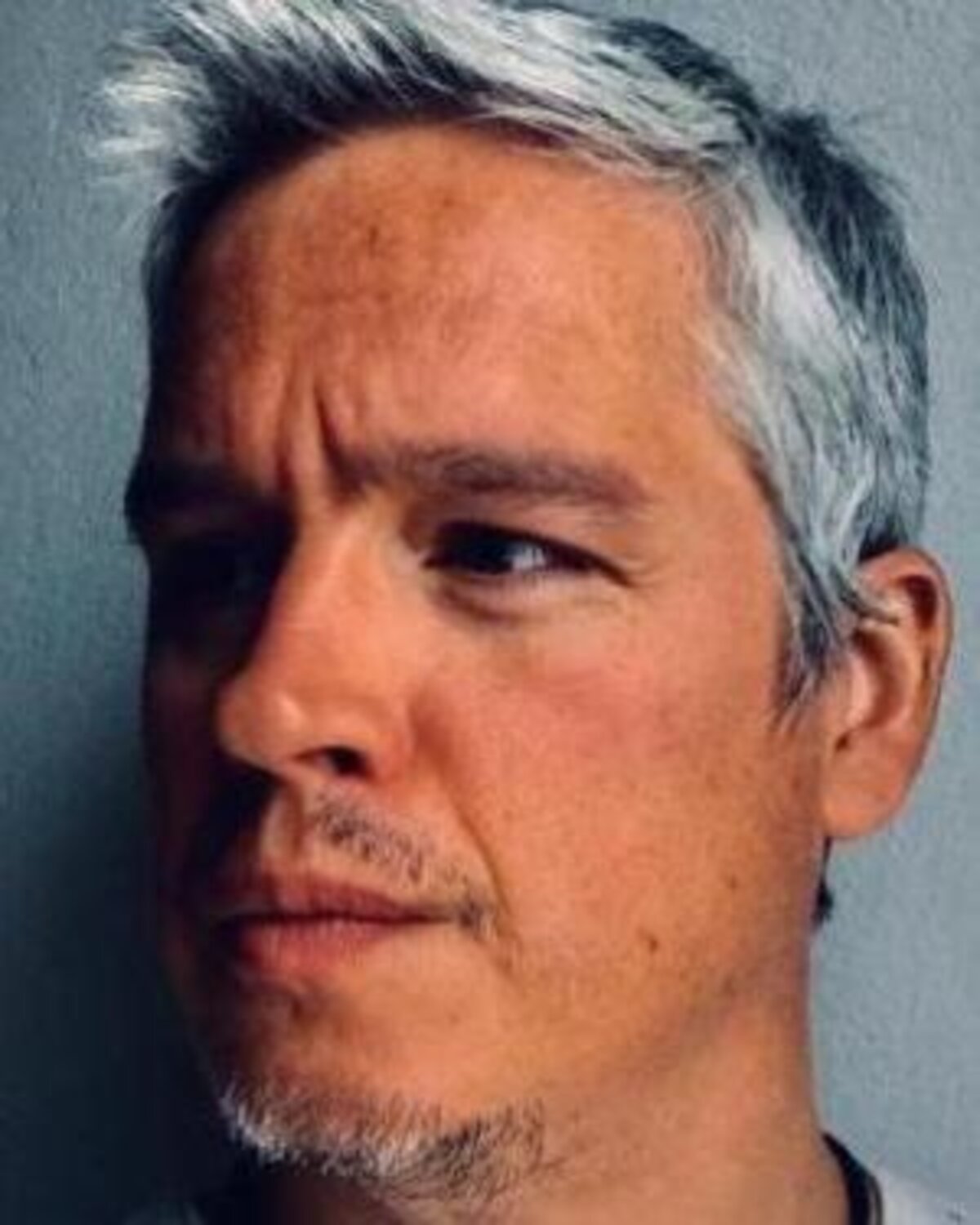
Cédric Lépine : Connu comme producteur dans le cinéma paraguayen avec Las Herederas (2018, Marcelo Martinessi), était-ce pour vous poussé par une urgence de réaliser ce documentaire ?
Sebastiàn Peña Escobar : Ce projet est né d'une urgence interne. Et je souffre d’une grande mélancolie pour les forêts. Il n’y a pas si longtemps encore, le Paraguay était un point vert peu connu sur la carte du monde. Au début des années 1980, environ 70 % du pays était encore couvert de forêts vierges et Asunción était une ville couverte de grands et vieux arbres, entourée de montagnes luxuriantes. Dans certains quartiers, il n'était pas rare de croiser des singes, des renards, de grands lézards et des tatous. Ce contexte a grandement influencé la formation précoce de mon imaginaire et de ma sensibilité. Depuis que je suis enfant, je ressentais une étrange attirance pour les forêts. Mais quand j’ai grandi, il m’est arrivé quelque chose de non moins étrange.
Lorsque j’ai commencé à prendre conscience que les sociétés humaines semblaient avoir une attitude hostile à leur égard, j’ai regretté ces forêts que je n’avais jamais vues, mais aussi celles que je pouvais voir mais qui, évidemment, cesseraient bientôt d’exister. Un jour, j'ai rencontré Ulf et Jota et, au cours des 18 années suivantes, nous avons voyagé dans tellement de réserves forestières et de parcs nationaux qu'au fil du temps, ce mouvement constant ressemblait à un long voyage circulaire.
À un moment donné, je suis devenu cinéaste et j’ai ressenti le besoin irrémédiable de raconter cette expérience sous la forme d'un récit. Cependant, lorsque j'ai commencé à réfléchir au film, j'ai réalisé qu'il ne parlerait pas seulement de ces personnages et des forêts du Paraguay, mais aussi de ma propre obsession pour les forêts. Comment quelque chose qui couvrait d’immenses zones de la planète peut-il disparaître ? Quelle est la racine de ce comportement étrange de notre espèce ? Est-ce un trait biologique ou culturel ? Ou peut-être les deux ?
C. L. : Comment décidez-vous du ton du film où certaines références aux films d'horreur surgissent avec une force destructrice invisible pour témoigner de la situation environnementale ?
S. P. E. : Quand j’ai commencé à imaginer la musique, j’ai essayé de rationaliser les sentiments qui m’ont poussé à réaliser ce documentaire. J'ai commencé à les écrire : angoisse, peur, anxiété, horreur, incertitude, contemplation, solitude, solitude, menace, communion, beauté bouleversante, tristesse, bonheur immense.
À partir de là, j'ai essayé d'écouter dans ma tête la musique qui pouvait articuler toutes ces sensations. J'ai commencé à me souvenir de musiques de films qui me faisaient ressentir certaines de ces choses ; des films de mon enfance, des nouveaux classiques des 20 dernières années, voire des documentaires qui sont pour moi emblématiques. C'est ainsi que je suis arrivé à Rectum (Thomas Bangalter), dans Irréversible de Gaspar Noé ; sur la musique sonore de Gambling, Gods and LSD, de Peter Mettler ; le thème principal d'Halloween (Trent Reznor & Atticus Ross) de John Carpenter, et celui du Vendredi 13 (Harry Manfredini) ; à la musique d'ambiance de Dean Hurley, dans Twin Peaks de David Lynch, à l'ambiance sonore des films de Travis Wilkerson.
J'ai senti que ces univers musicaux pouvaient parler les langages de l'anxiété inhérents à mon film : l'angoisse d'une menace tapie, la terreur d'un danger imminent, parfois caché, parfois déchirant à la vue de tous. J'ai pensé à la partition sonore comme à l'exposition d'un monde désolé et dystopique qui sort de sa coquille, comme un nouvel insecte ; mais en même temps je le pensais comme le souffle de la forêt, ce murmure pléthorique qui invente son propre registre sonore, une rumeur incompréhensible qui entoure tout. Un jour, pendant le montage, Fernando Epstein, mon monteur, m'a fait écouter des thèmes musicaux qui avaient été composés pour un autre film, mais qui n'avaient pas été utilisés. C'est ainsi que j'ai découvert le travail du talentueux Ismael Pinkler. C'était une immense chance. Sa superbe imagerie musicale correspond parfaitement à celle du film.
C. L. : Quelle est la situation politique au Paraguay qui permet cette exploitation de la jungle, sans respect des droits des peuples guarani ?
S. P. E. : La situation des peuples indigènes du Paraguay est fondamentalement celle que l’on observe dans toute l’Amérique depuis 500 ans. Nous savons tous que ce qui se passe au Paraguay n’a rien de nouveau. Ni ici, ni en Afrique, ni en Europe même. Le déplacement des peuples indigènes et le démantèlement de la forêt, au-delà d'une situation politique conjoncturelle (qui date d'environ 40 ans), et au-delà d'un symptôme endémique de la société paraguayenne (qui remonte à l'époque coloniale), il s'agit plus globalement d'un effet symptomatique des sociétés humaines des derniers millénaires.
Plus précisément, les 300 dernières années, ou la période englobant le siècle des Lumières et ses enfants jumeaux les plus notoires : la révolution industrielle et la Révolution française élargie (1789-1848). Au cours des trois derniers siècles, plus ou moins, s'est configuré un modèle d'organisation de la société humaine basé sur l'exploitation de la nature à une échelle et à un taux de croissance jamais vus auparavant. Le libéralisme démocratique, puis le capitalisme moderne, ont renforcé un processus qui se préparait depuis la révolution agricole du Néolithique.
La nouvelle société capitaliste établit la matrice cognitive qui sera désormais la façon dont nous nous percevons par rapport au monde ; et la manière dont nous comprenons et nous approprions ce monde. Comme le pensent Ulf et Jota, il s’agit en fin de compte de la façon dont le comportement de l’homo sapiens se manifeste lorsque les écailles de l’espèce sont radicalement modifiées.
C. L. : Existe-t-il un journalisme d’investigation au Paraguay pour dénoncer les crimes écologiques ?
S. P. E. : Nous avons la chance qu'il existe El Surti, un groupe de journalistes-chercheurs rigoureux, passionnés et engagés, avec une réputation internationale qui les précède.
C. L. : L’impunité vient-elle du pouvoir des propriétaires fonciers qui exerçaient leurs activités sous la dictature de Stroessner ?
S. P. E. : Il existe sans aucun doute un héritage de Stroessner qui a en partie marqué la configuration culturelle de notre société. Cette marque est toujours valable à la fois dans les expressions de notre société, dans les groupes politiques et chez de nombreuses personnes. Mais en plus de cela, l’impunité pratiquée au niveau local a beaucoup à voir avec la dynamique d’impunité typique de la mondialisation : la manière dont le marché mondial se rapporte à des pays comme le Paraguay.
Le monde entier est une grande entreprise et, d’une manière ou d’une autre, nous sommes tous obligés de trouver un moyen de survivre. Le Paraguay, comme n'importe quel autre pays du monde, doit lutter contre ses propres grandes contradictions, il doit chercher le moyen de créer une société dans laquelle le "progrès" signifie travail et recherche constante du maximum de bien-être possible - physique, intellectuel et spirituel - de ses citoyens. Un bien-être considéré de manière aussi globale implique inévitablement la protection de la nature en général (le respect des lois environnementales existantes et la promulgation d'autres lois complémentaires), ainsi que la préservation, l'entretien et l'expansion des parcs nationaux, des réserves naturelles et des territoires autochtones.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : Cette réalité d’écocide locale reflète-t-elle pour vous une crise mondiale ?
S. P. E. : Il existe de nombreuses perspectives pour nommer cette crise. La crise est une crise des systèmes biologiques, des écosystèmes due à la surexploitation des ressources naturelles et aux effets qu'ont sur elles les déchets générés par cette exploitation. Déchets au sens des simples déchets que nous générons, mais aussi au sens résiduel des effets nocifs que la vie dans une société de consommation a sur nous en tant qu'individus et en tant qu'espèce.
En parallèle, je pense que nous traversons une autre crise, liée au fait que nous sommes des milliards de personnes qui ont le droit de (survivre). La quasi-totalité de la consommation de la population mondiale est liée à un certain type d’effet nocif, soit pour la planète, soit pour certains êtres humains. Le paradigme de cette mondialité – et de cette dépendance à un modèle mondial de production et de consommation – est qu’elle peut être aussi néfaste que bénéfique. À cette échelle de l’humanité (c’est-à-dire nombre d’individus, niveau de consommation, niveau d’interconnexion mondiale), nombreux sont à la fois ceux qui sont du côté de ceux qui subissent le préjudice comme ceux qui sont du côté de ceux qui en bénéficient.
Des milliards de personnes ont de quoi manger parce que le modèle mondial de production alimentaire, aussi nocif soit-il pour la planète et pour de nombreuses personnes, peut produire de la nourriture à grande échelle et à des prix non prohibitifs. C’est une énorme contradiction et un dilemme. Et c'est justement une des observations/réflexions du documentaire : le défi que nous avons est au niveau de l'espèce et, plus précisément, au niveau de cette échelle de l'espèce, et de la manière dont elle organise sa société à ladite échelle. Cette échelle d'humanité nécessite des méga-processus de « maintenance », afin que la société continue de fonctionner et qu'il n'y ait pas d'effondrement catastrophique chronique (plus de famines, d'épidémies, de guerres mondiales, etc.). Eh bien, ces méga-processus auront inévitablement un impact sur l’environnement, en soi, en raison de leur propre ampleur : nous sommes nombreux et nous devons trop produire.
Si l’on ajoute à cela que bon nombre de ces méga-processus, en plus d’être gigantesques, sont inefficaces en termes de minimisation de l’impact social et environnemental, alors les choses deviennent encore plus compliquées. À mon avis (et bien sûr je peux me tromper) le grand défi, ou du moins l’un d’entre eux, est que jusqu’à présent nous n’avons pas trouvé les moyens de parvenir à une production à grande échelle, avec un impact « minimal-optimal » sur la planète, pour avoir au moins le temps de se régénérer dans des délais raisonnables. Il existe un déséquilibre entre la forme, l’échelle et l’espace qu’occupe la société humaine et les conditions environnementales optimales pour que nous puissions continuer à habiter la planète pendant longtemps. Il s’agit d’un défi énorme, car la contradiction qui en est le centre est également énorme.
C. L. : Pouvez-vous nous raconter comment est née l’idée d’accorder une forte importance aux dialogues dans le film pour faire prendre conscience de ce qui s’est passé ?
S. P. E. : J’avais déjà évoqué que depuis mon enfance j’avais une étrange attirance pour les forêts. Il aimait grimper aux arbres, jouer dans un ruisseau sous le dôme vert de la canopée. Je pense souvent à cette enfance, à la fin des années 1970, dans la ferme familiale, où Jota a passé une grande partie de sa jeunesse, vendant du lait et du fromage aux voisins dans un vieux camion. Avec mon cousin, pieds nus et torse nu, nous nous perdions dans de longues expéditions dans les forêts voisines.
J'ai adoré le sentiment d'être perdu dans la jungle. En tant qu'adulte, j'ai continué ainsi et je n'ai pas manqué l'occasion de visiter une forêt – n'importe quelle forêt –, mais j'ai aussi commencé à réfléchir à l'origine de cette attraction. Alors, lorsque j'ai rencontré Ulf et Jota, mon intérêt est devenu une obsession : Pourquoi les forêts me fascinent-elles ? Que peut-on considérer comme une forêt ? Disparaissent-elles à jamais ? Finalement, voyager avec un entomologiste et un ornithologue à travers les dernières forêts du Paraguay pendant des années m'a amené à me poser d'autres questions et à étudier, entre autres, l'évolution des sociétés humaines.
Comment en sommes-nous arrivés à ce point ? La déforestation et la dégradation générale de la planète sont-elles le résultat d’un trait évolutif distinct et irrémédiable de notre espèce ? Où et quand l’humanité a-t-elle commencé à suivre cette voie ? Si cela est irréversible – parce que cela semble l’être – que faire alors de notre époque ? Il m'a semblé, et me semble toujours intéressant, tant sur le plan esthétique qu'éthique, d'aborder ces questions dans un contexte de forêts dont la disparition semble imminente. D’autant plus que leur extinction peut être attribuée à un système mondial et à une tradition culturelle humaine qui semble les mépriser.
Los Últimos
de Sebastiàn Peña Escobar
Documentaire
87 minutes. Paraguay, France, Uruguay, 2023.
Couleur
Langue originale : espagnol
Scénario : Sebastiàn Peña Escobar
Images : Pascual Glauser
Montage : Fernando Epstein
Musique originale : Ismael Pinkler
Son : Rafael Álvarez
Sound design : Rafael Álvarez
Production : Sebastiàn Peña Escobar, Marcelo Martinessi, Agustina Chiarino, Fernando Epstein, Xavier Rocher, Marina Perales Marhuenda
Société de production : La Babosa Cine
Sociétés de coproduction : Bocacha Films, Mutante Cine, La Fabrica Nocturna Cinéma



