Le roman La Peste apporta à Albert Camus, la reconnaissance totale avec le prix Nobel de littérature en 1957. Oui, La Peste est un des grands opus de l’écrivain. D’ailleurs, qu’est-ce que la Corona aujourd’hui ? Et surtout, que nous dit La Peste de nous-même ?
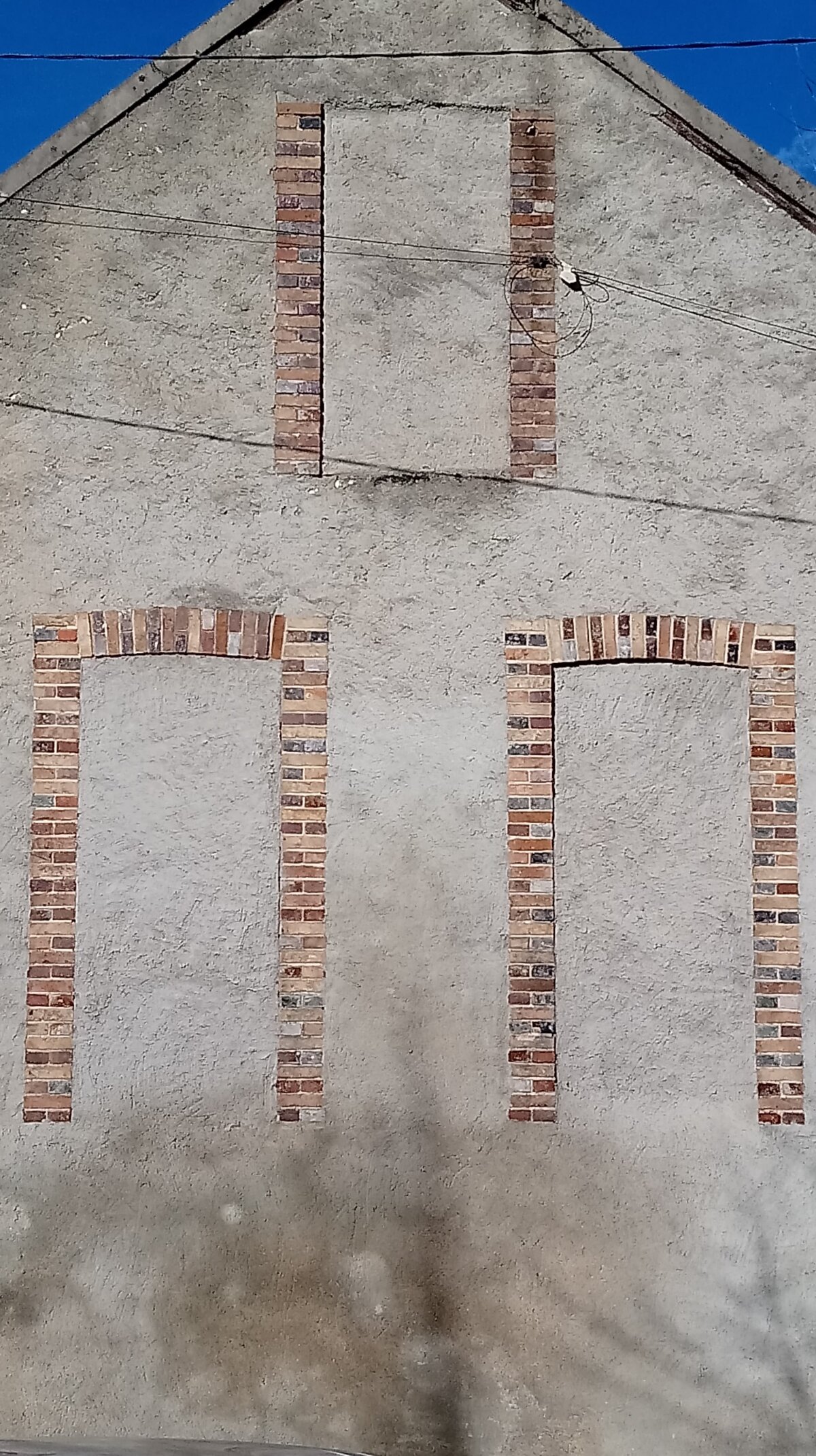
Agrandissement : Illustration 1
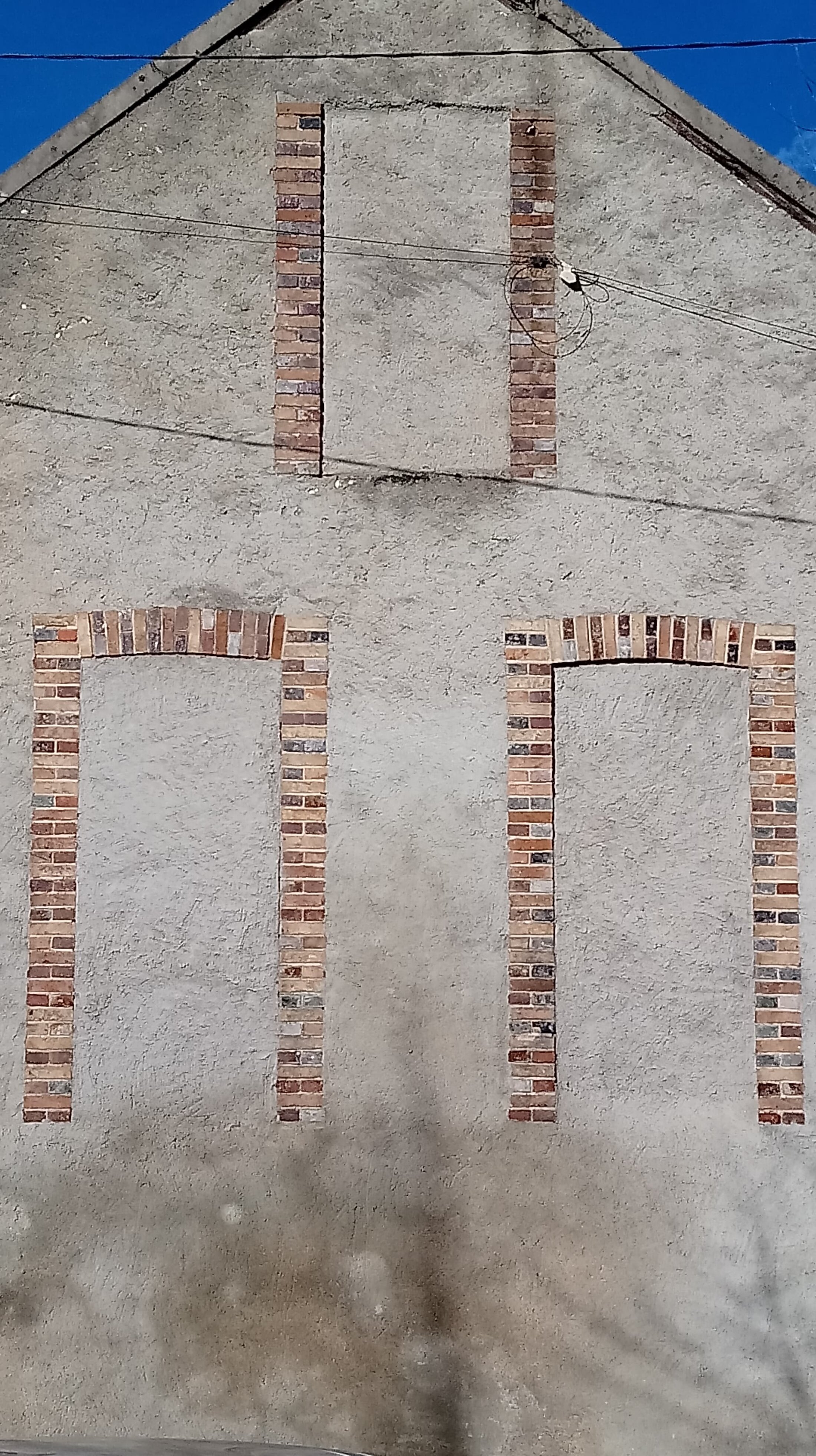
Tout débute à Oran, ville d’Algérie où les rats sortent de terre et viennent mourir aux pieds des hommes et des femmes. Elle court vite la Peste et vient s’installer en bubons, en fièvres et en souffrances révulsées si vite que le diagnostique vient heurter les protagonistes dans leurs vérités. Elle est là, dans les remparts d’Oran, dans ses cafés, sous les lampadaires au milieu des Oranais qui n’apprennent pas à vivre avec, car vivre avec signifierait déjà en mourir. Les volets des maisons se ferment, les lumières de la ville ne se reflètent plus dans le ciel des pestiférés, elle est évidence : elle, ce mal, se nomme La Peste.
Force est de constater que Camus était non seulement un témoin des émotions de son temps mais aussi un visionnaire en étant l’écrivain des existences, l’écrivain qui par conscience met l’homme face à cette seule absurdité : la maladie fulgurante, la mort qui à chaque instant se louvoie dans toutes nos attitudes de la vie : vie seule opératrice de la mort. Que la Peste soit un accident de voiture, une Peste sournoise et moderne comme notre corona, qu’importe les hommes habitent la Peste, comme la Peste modélise le moindre geste, la moindre parole, tait les plus belles histoires d’amour, crée des amitiés pour aussi vite les défaire, lie les hommes en définitive enfin aux éléments, au cosmos retrouvé. La Peste est le catalyseur du quotidien même médiocre, que l’on préfère revivre au réveil suivant, puis encore au suivant. Que l’on ne puisse plus enterrer les morts en solitaires, mais dans des fosses communes laissant ainsi toute l’aisance aux encore-vivants de vivre, le temps d’un dernier souffle, d’une dernière vague qui viendrait heurter la digue, d’une dernière représentation d’Orphée et d’Eurydice, car La Peste est la théâtralité même de la vie qui mène à la mort.
Camus lorsque l’on lui apprit qu’il avait le prix Nobel s’écria que c’était à Malraux de l’obtenir, plus tard après sa mort en janvier 1960 de l’écrivain, Sartre le refusa ; peut-être comme ce dernier défie envers son frère existentialiste ?
La Peste est aussi un écrit sur la gestion par les technocrates, tout comme les médecins ou les journalistes d’une crise loin d’être informe, car la peste est de retour, là au détour des ruelles de la ville d’Algérie, elle s’organise parallèlement aux process de l’Etat, aux états d’âmes des protagonistes du roman. La Peste est là puissante et vindicative et rien, rien pas même les plans, les pronostiques, les listes, les arrêtés, le couvre-feu ne peuvent stopper sa propagation.
Lorsqu’il reçut son prix, Camus commença par remercier son instituteur Monsieur Germain, qui dans son enfance l’avait poussé afin qu’il continue ses études, lui évitant peut-être La Peste d’une vie sans littérature, et sans philosophie. Lors de l’hommage rendu à Samuel Paty à la Sorbonne, cette lettre a été lue par une lycéenne, contre La Peste tentaculaire de l’obscurantisme islamique, du fascisme islamiste, contre ce corona donc qui s’infiltre dans le corps même de notre humanité. La Peste est multiple, elle est cette hydre, elle surgit, s’installe, puis s’éteint, après avoir fait son office, s’éteint après de multiples combats, elle s’éteint, s’épuise après avoir épuisé les hommes, là à terre, elle meurt, elle meurt, se fait oublier un temps, le temps au moins de toutes les reconstructions.



