
Drago Jančar ou la mélancolie de la résistance
En décernant le Prix européen de littérature à Drago Jančar, le jury a tenu à honorer, comme les années précédentes, une voix majeure de la littérature actuelle du Vieux Continent. Après deux poètes, la Grecque Kiki Dimoula en 2009 et le Britannique Tony Harrison en 2010, le prix qui est remis aujourd’hui a été attribué en 2011 à un romancier et nouvelliste slovène qui est également essayiste et auteur de pièces de théâtre. En rappelant les noms des précédents lauréats, l’occasion m’est donnée souligner que le jury du Prix européen de littérature se refuse à entériner une vision hémiplégique de la littérature qui consiste à reléguer dans l’ombre les poètes, vision aberrante quand on pense que nous sommes issus d’un siècle, le XXe, qui fut l’un des plus grands et des plus féconds de toute l’histoire de l’humanité dans le domaine de la poésie. Au demeurant, sous certains aspects, le roman et la poésie ne sont pas imperméables l’un à l’autre. À propos de Drago Jančar, Claudio Magris a pu écrire avec pertinence qu’Aurore boréale, bouleversante et admirable radiographie d’un moment tragique de l’histoire européenne, était un roman animé « d’une profonde pitié humaine et d’une lancinante poésie capable de faire entendre les sentiments, les demandes frustrées de vérité et de bonheur, la morsure de la solitude ».
Il y a comme un surcroît de pertinence ou à tout le moins une plénitude de sens dans l’attribution du Prix à Drago Jančar, car à bien des égards il fait partie de la constellation des grands écrivains de la conscience européenne. C’est avec la rigueur éthique, la passion investigatrice et la puissance imaginative du romancier que Drago Jančar sonde les zones troubles et douloureuses de l’Histoire des Slaves du Sud au XXe siècle. Des zones difficiles, orageuses, complexes, où la grandeur côtoie l’atroce tragédie, où la quête du sens est frôlée par l’absurde et la pitié par la dérision, où l’aiguille de la boussole d’humanité s’affole face aux pathologies de l’Histoire mais continue de chercher le nord magnétique du cœur.
On est irrésistiblement tenté de peindre Drago Jančar sous les traits mythologiques de Persée, dans la mesure où l’Histoire semble être à la fois pour lui Méduse et Andromède. Elle est la Gorgone que l’écrivain doit affronter et dont le regard pétrifie, mais elle est aussi la fascinante Andromède, la belle captive en attente de délivrance, la vérité désirable enchaînée à un sombre roc.
Claudio Magris est l’un des écrivains qui, à mon sens, a su le mieux parler de Drago Jančar, aussi voudrais-je le citer encore un peu longuement, mais pas vainement : « Jančar sait représenter avec une force poétique singulière la violence, la folie, la réalité déformée et mutilée,comme le révèle aussi une nouvelle exceptionnelle, Éthiopiques, la répétition, qui raconte un massacre épouvantable dans les montagnes de Slovénie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’Histoire semble une répétition de l’horreur ; on trouve un épisode similaire, rappelle Jančar, au début des Éthiopiques,le roman hellénistique d’Héliodore, mais dans le texte grec ancien l’Histoire, même sanguinaire, dévoile le plan divin qui la sous-tend et lui donne sens ; plan divin qui pour nous, ajoute Jančar, n’est plus possible. »
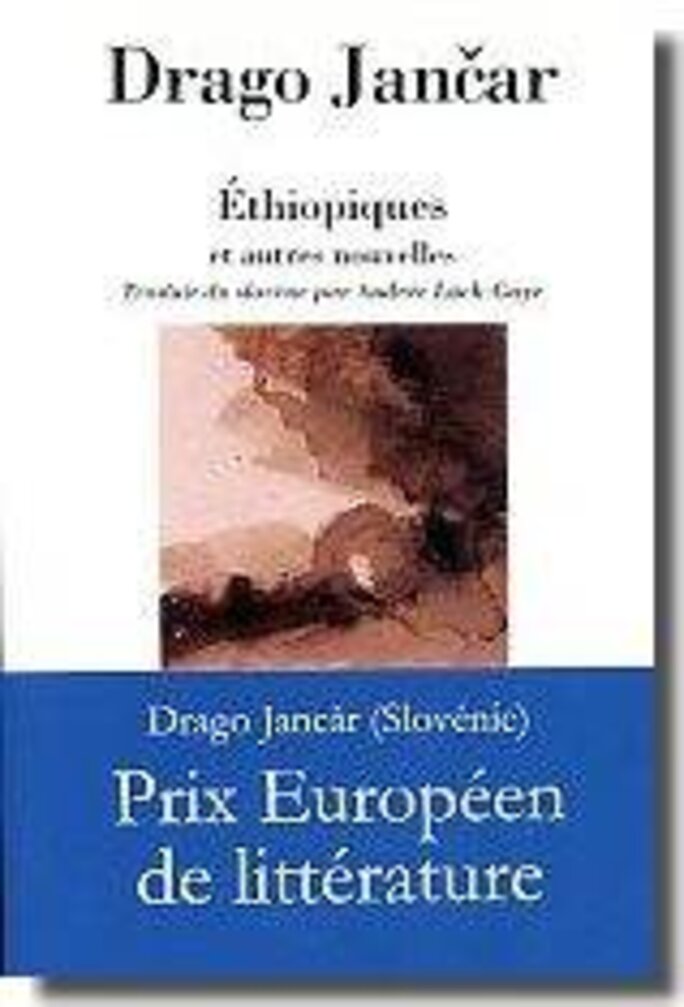
À titre d’hypothèse, je dirais que l’ironie, quand elle n’est pas une posture, est une sorte d’art martial qui permet d’affronter assez loyalement les paradoxes. L’ironie de Jančar n’intervient pas seulement à propos de l’histoire passée, même si le souvenir en est encore brûlant, elle s’applique aussi au temps présent, comme on le voit dans L’homme qui regardait dans le gouffre, une formidable nouvelle traduite dans le recueil paru chez Arfuyen. Jančar nous conte l’histoire d’un homme qui, à un moment de grande bascule de l’histoire, quand la Slovénie abordait aux rivages désirés de la démocratie, a prononcé une phrase somme toute banale sous l’œil d’une caméra de télévision. Cet homme n’a rien dit d’extraordinaire, mais il l’a dit au bon moment et le propos banal diffusé en boucle par les médias lui a valu une célébrité foudroyante qui l’a brusquement tiré de l’anonymat. Puis une page de l’Histoire a été tournée et le train-train de la nouvelle démocratie a peu à peu relégué le héros d’un jour dans les friches de l’indifférence et les terrains vagues de l’oubli. La démocratie triomphante a en quelque sorte excommunié cet homme de l’Histoire, une excommunication qu’il ne parvient pas à admettre et qui le conduit, de façon pathétique et grotesque, à radoter désormais ses discours sur les droits de l’homme sous l’œil torve de la caméra de surveillance d’un supermarché.
Cette nouvelle a de toute évidence valeur de parabole. Un écrivain de la génération de Drago Jančar, qu’il ait vécu sa jeunesse et une partie de son âge d’homme en Yougoslavie ou dans un pays d’Europe centrale, est nécessairement marqué par une expérience de la vie qui diffère de celle de ses confrères d’Europe occidentale. Dans un essai sur Czesław Miłosz, encore inédit en français, Jančar dit en substance qu’il lui a été donné de connaître successivement la mélancolie de la résistance et la monotonie provinciale de la démocratie. Le déchirant paradoxe, qui réclame sans doute pour être compris autant d’ironie que de sensibilité, c’est que sans pleurer l’époque des régimes autoritaires comme Andromaque pleurait Troie, puisqu’il est au contraire de ceux qui abattirent de l’intérieur les murs de la Troie socialiste, Drago Jančar n’en considère pas moins que la vie était alors « plus excitante et audacieuse », « plus riche en solidarité, en courage et en prise de risque ». Surtout, dit-il, depuis la chute de Troie la littérature a cessé d’être « au centre de l’attention », la créativité a cessé d’être « le royaume de la liberté », et tout se passe comme si la culture était entrée dans le royaume arrogant de la marchandise et de l’entertainment.
Le Prix européen de littérature qui vous est remis, cher Drago Jančar, en honorant l’écrivain que vous êtes, est aussi le signe qu’ici comme sous d’autres latitudes, les marchands du temple n’ont pas tout pris, qu’on sait encore saluer comme il se doit les éveillés, les éveilleurs, ceux dont l’art sans compromis a le pouvoir de nous ravir, de nous troubler, de nous donner à penser, de nous transformer peut-être, de maintenir vivant en nous le rêve paradoxal d’un monde différent — un rêve paradoxal car il nous faut à la fois en accueillir les énergies et passer au crible les illusions qui s’y attachent. Mais c’est de cela aussi que nous fait don la littérature, le rêve et la critique du rêve, l’utopie et la critique de l’utopie, et c’est sa manière d’intervenir dans nos vies.
À l’hommage qui vous est rendu, je voudrais associer votre traductrice Andrée Lück-Gaye, grâce à laquelle nous connaissons en France non seulement votre œuvre, mais aussi celle de votre aîné et ami Boris Pahor. Le destin de la parole humaine se joue aussi dans la traduction. « On ne peut traduire, et pourtant on y est obligé. C’est cette impossibilité que j’aime », disait Antoine Vitez. Et il ajoutait : « On est convoqué devant le tribunal du monde à traduire. C’est presque un devoir politique, moral, cet enchaînement à la nécessité de traduire les œuvres. » Que Madame Lück-Gaye trouve ici l’expression de notre gratitude pour le travail admirable qu’elle accomplit.
Je voudrais enfin saluer la présence parmi nous d’un poète slovène de tout premier ordre, Boris A. Novak. J’avais eu naguère le plaisir d’accueillir quelques-uns de ses poèmes dans la revue Europe, dans une belle traduction de Zdenca Štimak, et de réaliser avec lui un entretien radiophonique. L’univers auquel il nous donne accès est tout différent de celui de Drago Jančar. Il nous introduit dans un domaine absolument indemne d’ironie. Sa poésie porte le haut témoignage d’une délicatesse d’âme et d’une acuité du regard qui accordent indissociablement leur patience et leur attention au langage, aux êtres et aux choses. C’est une poésie qui ne fait pas plus de bruit que la neige qui tombe, mais comme la neige qui transforme le paysage et nous le donne à voir sous un jour nouveau, au contact de la poésie de Boris A. Novak c’est notre regard sur le monde et sur la vie qui se trouve doucement raffermi, décanté, rafraîchi.
Jean-Baptiste Para
Texte © ACEL
Pour une prise de vue sur Drago Jančar voir le site du Prix Européen. Voir également une présentation de sa traductrice, Andrée Lück-Gaye, lauréate de la Bourse de traduction du Prix Européen de Littérature.
PRIX EUROPÉEN DE LITTÉRATURE 2011
Europska nagrada za kniževnost
European Prize for Literature
Europäischer Literaturpreis
Drago Jančar
(Slovénie)
DISCOURS DE RÉCEPTION
prononcé à Strasbourg, au Palais du Rhin,
le samedi 24 mars 2012
dans le cadre de
TRADUIRE L’EUROPE- 7e Rencontres Européennes de Littérature
Franchir les frontières de son monde linguistique par la traduction de ses livres est un événement excitant pour un écrivain. Soudain il est chez lui dans des pays qu’il n’a jamais vus, que peut-être il ne verra jamais, parmi des lecteurs dont il ne sait rien, son travail est exposé au jugement d’amateurs de littérature qui ont sur sa dimension esthétique et sur son contenu des points de vue qui diffèrent de ceux de l’endroit où il a été élaboré.
[…]
Chaque art est porteur de contradictions qui l’empêchent d’être manichéen. La littérature est écrite pour un lecteur qui est capable d’entrer dans son monde ; et, dans ce monde, on s’aime et on se trahit, on aide et on simule ; des gens généreux peuvent aussi être sexistes et racistes, souvent la générosité et la bassesse coexistent en la même personne. La littérature n’a pas besoin de lecteurs et de critiques qui la jugent selon des critères moraux, religieux ou idéologiques, mais de lecteurs et de critiques qui comprennent sa tension interne, ses contradictions, son destin, ses évolutions et son style. Les malentendus s’accumulent quand le lecteur et le critique essaient de comprendre ou d’interpréter l’œuvre littéraire selon des critères extra-littéraires, notamment quand ils le font du point de vue d’un système de valeurs ou d’opinions constitué. En plus des désaccords avec les hommes de pouvoir, j’ai vécu aussi des désaccords avec les manichéens de toutes les couleurs.
Il n’est pas possible de définir le rôle de la littérature au moyen d’instruments extérieurs mais il est vrai que, dans l’histoire slovène comme dans celle des autres peuples d’Europe centrale, elle a joué un rôle particulier. Et comme le Prix que je reçois aujourd’hui porte aussi le qualificatif d’« européen », qu’il me soit permis de remercier les organisateurs de m’avoir proposé de parler en slovène. C’est la langue d’un petit peuple qui, entouré de ses grands voisins, n’a pas été autorisé pendant longtemps à l’utiliser pleinement et librement. Cependant elle s’est développée et a atteint une plénitude qui, depuis au moins deux siècles, lui a permis de produire une littérature européenne de valeur. Pendant un temps, la littérature a même été pour les Slovènes une sorte de substitut à la liberté nationale, à l’absence de liberté, et il s’est passé bien des choses dans la littérature plutôt que dans la politique et la société. Dans les rues et sur les places des villes slovènes, a écrit un écrivain américain avant la Seconde Guerre mondiale, vous ne trouverez pas de monuments de politiciens ou de chef de guerre mais des monuments de poètes, d’écrivains et de grammairiens. La littérature slovène a toujours été liée à l’engagement, même si, parallèlement, elle s’est plongée dans la question de l’existence de l’homme. La première pièce de théâtre slovène fut une adaptation de la satire de Beaumarchais, la Folle Journée ou le Mariage de Figaro, écrite par le libre-penseur Tomaž Linhart (1756-1795). Malgré la censure autrichienne qui a tenté d’empêcher sa représentation, elle a été jouée à Ljubljana à peine six ans après la sortie de la pièce originale en France. Et, depuis lors, cette littérature vit dans une incessante tension avec la société. Il ne s’agissait pas seulement d’affaire de nation et de langue. Au milieu du siècle dernier, une partie de cette littérature était socialement engagée et, pour cette raison, était aussi en butte au pouvoir. En ces temps agités, le poète Edvard Kocbek (1904-1981), qui était en contact actif avec les philosophes personnalistes français, s’est allié aux communistes dans la résistance slovène et a vécu pendant quatre ans dans le maquis. Et, quand la liberté est arrivée et avec elle le nouveau régime, c’est lui, le poète fier et sensible, qui est devenu, en raison de sa littérature anti-manichéenne, une « non-personne », traquée, persécutée, interdite de publication. Ce n’est pas un hasard si c’est précisément de ce milieu – culturel et surtout littéraire – qu’est arrivée ensuite une partie de l’énergie critique qui, à la fin du xxe siècle, a fait basculer la société slovène de la dictature à la démocratie. Mais j’insiste : ce n’est pas le rôle central de la littérature. Si un auteur veut vivre dans sa tour d’ivoire – il en existe à toutes les époques –, qu’il vive ainsi ! Et celui qui veut écrire de façon engagée et critique, qu’il le fasse lui aussi ! Moi-même, j’essaie de me partager : quand je veux m’engager, j’écris un essai ou un article, mais lorsque j’écris un roman ou une pièce de théâtre, je suis un autre homme. Bien sûr, dans toute œuvre, l’expérience sociale a sa place, aucune littérature ne vit hors de l’espace et du temps. Même dans les littératures les plus hermétiques, on trouve des traces de la période dans laquelle elle est apparue.
Comme je me suis formé dans cette langue, que j’y ai vécu, que je l’ai écrite et lue, je considère ce Prix qui m’est attribué comme un honneur pour tous ces prédécesseurs et contemporains que je viens de nommer, mais aussi pour tous ceux que l’espace européen élargi ne connaît pas encore. Et cependant, en même temps, je le reçois comme quelque chose de tout à fait personnel : comme la confirmation d’une ancienne décision de tenter d’exprimer mon agitation rebelle, ma peur et mon courage, mon incertitude, mes doutes, le sens et l’absurdité, de tout ce que ressentait cet enfant qui, il y a longtemps dans ses moments de solitude, regardait les étoiles dans la nuit et se demandait avec une vague intuition : Qu’y a-t-il là-bas, qu’y a-t-il au-delà ? Et que suis-je moi sous ces étoiles ? Cet enfant, dans chaque phrase que j’écris, est toujours en moi. Merci.
Traduit du slovène
par Andrée Luck-Gaye
© ACEL
Drago Jancar est né en 1948 à Maribor, dans une Slovénie alors englobée dans la « République fédérative socialiste de Yougoslavie ». Son père a été interné en camp de concentration pour faits de résistance contre l’occupant nazi. Dès ses études de droit, Jancar, rédacteur d’un journal étudiant, s’attire des difficultés de la part du régime. En 1974, il est condamné à un an de prison pour « propagande en faveur de l’ennemi ». Entre 1978 et 1980, il travaille à Ljubljana pour des studios cinématographiques mais, là encore, se heurte à la censure.
En 1981, il entre comme secrétaire aux éditions Slovenska Matica où il travaille aujourd’hui encore comme éditeur. Il se lie d’amitié avec le grand écrivain slovénophone de Trieste Boris Pahor auquel il rendra hommage en 1990 dans son essai L’homme qui a dit non. Ce n’est qu’après la mort de Tito en 1980 qu’il peut donner libre cours à son œuvre de romancier, nouvelliste et dramaturge.
En 1987 Drago Jancar est l’un des signataires du manifeste des intellectuels pour une Slovénie démocratique et indépendante. De 1987 à 1991, il prend une part de plus en plus active à la démocratisation de son pays en tant que Président du PEN Club de Slovénie. Durant la guerre de Bosnie, il apporte publiquement son soutien aux Bosniaques et se rend à Sarajevo assiégée pour apporter des aides. Dans son « Rapport succinct sur une ville longtemps assiégée », il s’interroge sur le rôle des intellectuels dans les conflits ethniques ou nationaux. Il polémique sur ce sujet avec l’écrivain autrichien Peter Handke.
« Sismologue d’une histoire chaotique », Jancar choisit le plus souvent pour personnages des êtres marginalisés et écrasés par la société et pour lieux des espaces clos tels que prisons, casernes ou hôpitaux psychiatriques. Il se garde pourtant de verser dans la compassion ou la protestation. La distance et l’ironie sont la marque de son style.
Il a obtenu en 1993 le plus prestigieux des prix littéraires slovènes, le prix Preseren, pour l’ensemble de son œuvre. Il a également reçu en 1994 le Prix européen de la nouvelle, en 1997 le Prix autrichien Jean Améry et en 2003 le Prix Herder. Ses récits et essais son traduits en plus de vingt langues. Son théâtre a été représenté dans de nombreux pays et est régulièrement joué en Slovénie.
Texte © ACEL
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES PUBLIÉS
Romans : Petintrideset stopinj (Trente-cinq degrés), 1974 • Galjot (Galiote), 1978 • Severni sij (Aurore boréale), 1984 • Pogled angela (Le regard de l’ange), 1992 • Posmehljivo poželenje (Désir moqueur), 1993 • Zvenenje v glavi (Des bruits dans la tête), 1998 • Katarina, pav in jezuit (Katerina, le paon et le jésuite), 2000 • Graditelj (Le Bâtisseur), 2006 • Drevo brez imena (L’Arbre sans nom), 2008 • To noc sem jo videl (Je l’ai vue cette nuit), 2010.
Théâtre : Disident Arnož in njegovi (Le dissident Arnož et sa bande), 1982 • Veliki briljantni valcek (La Grande valse brillante), 1985 • Vsi tirani mameluki so hud konec vzeli ... (Les tyrans mamelouks ont tous une triste fin), 1986 • Daedalus (Dédale), 1988 • Klementov padec (La Chute de Clément), 1988 • Zalezujoc Godota (Après Godot), 1988 • Halštat (Hallstatt), 1994 • Severni sij (Aurore boréale), 2005 • Niha ura tiha (Le balancier silencieux de l’horloge), 2007.
Essais : Razbiti vrc (La cruche brisée), 1992 • Egiptovski lonci mesa (Plats de viande égyptiens), 1994 • Brioni (Brioni), 2002 • Duša Evrope (L’âme de l’Europe), 2006.
TRADUCTIONS EN FRANÇAIS
Plusieurs textes de Drago Jancar ont été traduits en français : L’Élève de Joyce, nouvelles, L’Esprit des Péninsules, 2003 • Nouvelles slovènes, Autres Temps, 1996 • La Grande valse brillante, théâtre, l’Espace d’un instant, 2007 • Aurore boréale, roman, L’Esprit des Péninsules, 2005 • Katarina, le paon et le jésuite, roman, Passage du Nord-Ouest, 2009 • Des bruits dans la tête, roman, Passage du Nord-Ouest, 2009.
OUVRAGES PUBLIÉS À L'OCCASION DU PRIX
À l’occasion de la remise du Prix Européen de Littérature à Drago Jancar le samedi 24 mars 2012, paraîtra aux Éditions Arfuyen, partenaires du Prix, un nouveau livre, Éthiopiques et autres nouvelles, traduit par Andrée Lück-Gaye.
Texte © ACEL



