
Agrandissement : Illustration 1
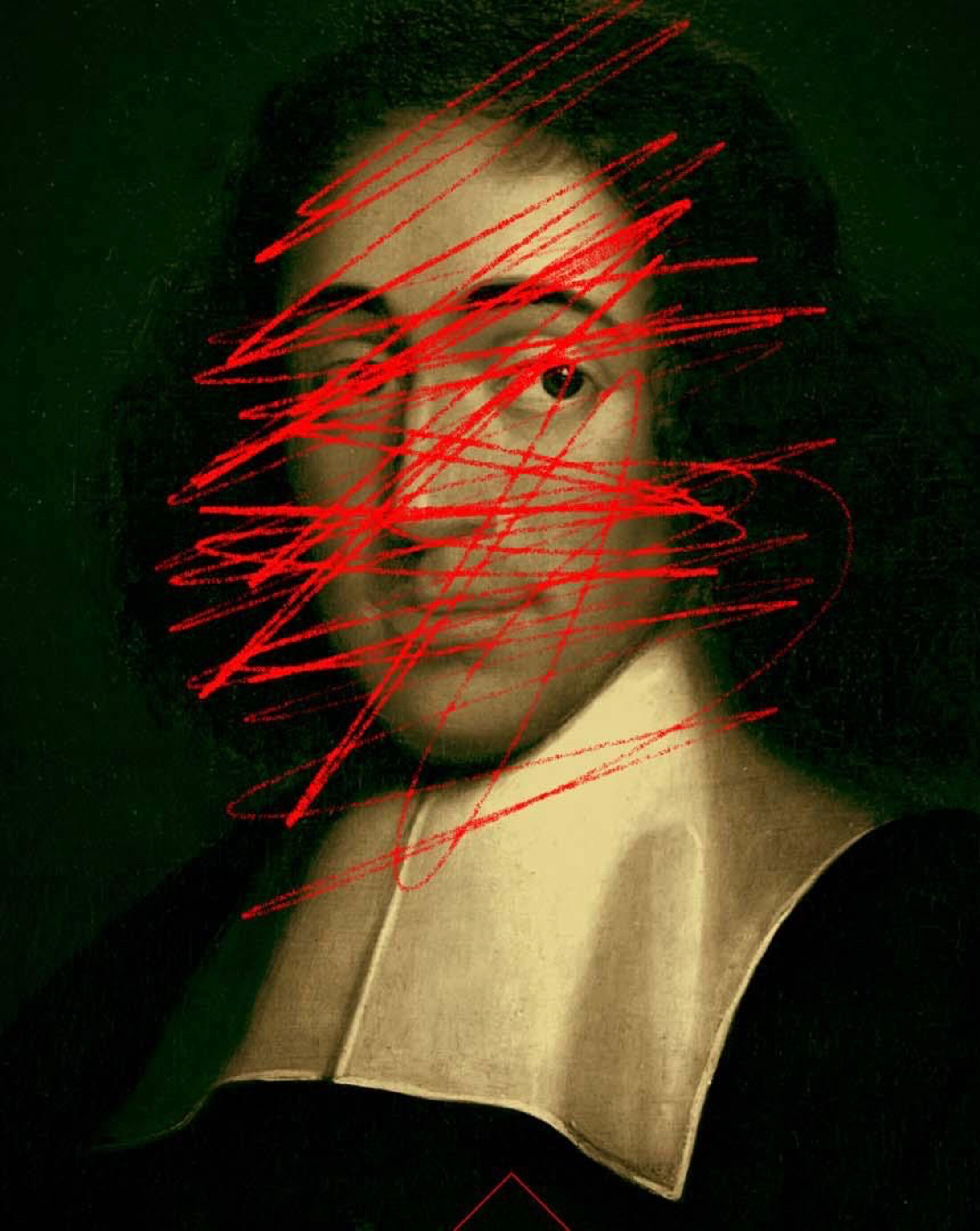
La philosophie s’oppose en théorie à la croyance, ou à la foi. C’est là un des maux de notre époque. Ce que Spinoza nomme « liberté de philosopher » dans une lettre à Oldenburg en 1665 correspond aujourd’hui à nos libertés de penser et de s’exprimer. Spinoza abolit l’hérésie. De nos jours, il abolirait le blasphème.
Depuis plus de trois siècles que Spinoza, plongé dans la pourtant tolérante vie hollandaise, se fut trouvé en buttes aux « prédicants », la notion s’est un peu déplacée : au 17ième siècle, on philosophe souvent tout seul, en écrivant. Certes, il y a des « salons ». Mais démocratisation aidant, de nos jours, il s’agit de « saloons », de « réseaux », de « forums ». Ce que Spinoza nomme le « vulgaire » est à présent partie prenante du débat. Ça se constate partout. Ça a des avantages, et des inconvénients.
De nos jours, la liberté de philosopher est toujours aussi entravée. Pas de discussion possible avec un islamiste, si tu plaides pour la liberté et l’égalité, ou si tu estimes que la fraternité s’étend au genre humain entier, au delà de l’Oumma. Pas de discussion possible avec un néo-féministe à qui tu parles de clause de conscience, ou à un écologiste à qui tu voudrais expliquer qu’une éolienne est une vraie catastrophe environnementale. On ne peut pas non plus débattre avec un indigéniste des chrétiens et des juifs harcelés et persécutés, à l’école, dans le quartier, dans certains pays, etc. C’est que de nos jours, le fanatisme s’est laïcisé ! La crédulité « vulgaire » dont parle Spinoza concerne à présent d’autres sectes que les sectes religieuses. Devant les peurs modernes (pollution par exemple), on retombe « prisonnier de la superstition », « bien que cent fois trompés ». La raison et la sagesse semblent vaines devant l’adversité (le consumérisme effréné, dont nous sommes responsables, en plus) ; alors que l’ineptie est toujours disponible (la voiture électrique, qui marche au charbon, et au kérosène alimentant des moteurs de Boeing mobilisés pour faire face à la pénurie d’électricité).
Pourtant, cette superstition n’est pas le sentiment de la divinité. Jusque là, vous avez peut-être eu l’impression, par ma faute, que Spinoza est athée ! C’est d’ailleurs l’opinion que ses « hérésies » provoquaient souvent, et qui lui valurent mille avanies. Eh bien non. Il a la foi, une foi en mouvement, assise sur ses racines juives, mais aussi sur la continuation catholique et humaniste. Il place en exergue de son Traité Théologico-politique une parole de Jean :
« Nous connaissons à ceci que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous : il nous a donné de son esprit. »
Quinze siècles avant Descartes, voici un argument qui vaut examen.
Spinoza distingue donc deux attitudes : la crédulité, soumission aveugle, et la foi, croyance en quelque part justifiée.
La première est de nature superstitieuse, et se renforce de la crainte. Comme les peurs sont multiples, et les avidités aussi, la superstition est multiple. Et peu persévérante. Avide de nouveauté. Avide de nouvelles tromperies. Un peu comme un électeur moderne ! Selon Spinoza, la superstition est le meilleur moyen de gouverner la multitude. Le prédicant sait faire adorer, ou au contraire exécrer, le roi. Il suffit de maintenir un apparat pour inspirer le respect du culte.
La seconde introduit la question de la philosophie : bien que Spinoza sépare clairement la philosophie de la foi, il explique qu’elles cohabitent en nous, et qu’elles peuvent coexister en paix. Il y a la lumière naturelle, faite de raison et de sagesse, et la lumière divine, l’esprit dont parle Jean, et qui vient de Dieu. Et les zélotes qui prétendent être les seuls détenteurs de cette lumière divine affichent le plus grand mépris de la raison et de la lumière naturelle. La comparaison avec le Wokistan actuel, qui écarte le réel, décrète fascistes la science et l’histoire, tient toujours.
_________________
Voici la préface du Traité Théologico-politique, qui permet de réunir les hommes de bonne volonté autour d’un consensus naturel, quelles que soient leurs religions, leurs athéismes, leurs libertés. Bien sûr, préface comme traité sont interdits aux cons, non pas par la loi des hommes, mais par loi biologique : un con ne peut comprendre, c’est à cela qu’on le reconnaît.
_________________
Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté ou encore si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition. Mais souvent réduits à une extrémité telle qu’ils ne savent plus que résoudre, et condamnés, par leur désir sans mesure des biens incertains de fortune, à flotter presque sans répit entre l’espérance et la crainte, ils ont très naturellement l’âme encline à la plus extrême crédulité ; est-elle dans le doute, la plus légère impulsion la fait pencher dans un sens ou dans l’autre, et sa mobilité s’accroît encore quand elle est suspendue entre la crainte et l’espoir, tandis qu’à ses moments d’assurance elle se remplit de jactance et s’enfle d’orgueil. Cela, j’estime que nul ne l’ignore, tout en croyant que la plupart s’ignorent eux-mêmes. Personne en effet n’a vécu parmi les hommes sans avoir observé qu’aux jours de prospérité presque tous, si grande que soit leur inexpérience, sont pleins de sagesse, à ce point qu’on leur fait injure en se permettant de leur donner un conseil ; que dans l’adversité, en revanche, ils ne savent plus où se tourner, demandent en suppliant conseil à tous et sont prêts à suivre tout avis qu’on leur donnera, quelque inepte, absurde ou inefficace qu’il puisse être. On remarque en outre que les plus légers motifs leur suffisent pour espérer un retour de fortune, ou retomber dans les pires craintes. Si en effet, pendant qu’ils sont dans l’état de crainte, il se produit un incident qui leur rappelle un bien ou un mal passés, ils pensent que c’est l’annonce d’une issue heureuse ou malheureuse et pour cette raison, bien que cent fois trompés, l’appellent un présage favorable ou funeste. Qu’il leur arrive maintenant de voir avec grande surprise quelque chose d’insolite, ils croient que c’est un prodige manifestant la colère des Dieux ou de la suprême Divinité ; dès lors ne pas conjurer ce prodige par des sacrifices et des vœux devient une impiété à leurs yeux d’hommes sujets à la superstition et contraires à la religion. De la sorte ils forgent d’innombrables fictions et, quand ils interprètent la Nature, y découvrent partout le miracle comme si elle délirait avec eux. En de telles conditions nous voyons que les plus adonnés à tout genre de superstition ne peuvent manquer d’être ceux qui désirent sans mesure des biens incertains ; tous, alors surtout qu’ils courent des dangers et ne savent trouver aucun secours en eux-mêmes, implorent le secours divin par des vœux et des larmes de femmes, déclarent la Raison aveugle (incapable elle est en effet de leur enseigner aucune voie assurée pour parvenir aux vaines satisfactions qu’ils recherchent) et traitent la sagesse humaine de vanité ; au contraire les délires de l’imagination, les songes et les puériles inepties leur semblent être des réponses divines ; bien mieux, Dieu a les sages en aversion ; ce n’est pas dans l’âme, c’est dans les entrailles des animaux que sont écrits ses décrets, ou encore ce sont les insensés, les déments, les oiseaux qui, par un instinct, un souffle divin, les font connaître. Voilà à quel point de déraison la crainte porte les hommes. La cause d’où naît la superstition, qui la conserve et l’alimente, est donc la crainte ; que si, outre les raisons qui précèdent, on demande des exemples, je citerai Alexandre : alors seulement qu’aux portes de Suse il conçut des craintes sur sa fortune, il donna dans la superstition et eut recours à des devins (voir Quinte-Curce, liv. V, § 4) ; après sa victoire sur Darius, il cessa de consulter devins et aruspices, jusqu’au jour de grande anxiété où, abandonné des Bactriens, provoqué au combat par les Scythes, immobilisé lui-même par sa blessure, il retomba (ce sont les propres paroles de Quinte-Curce, liv. VII ; § 7) dans la superstition qui sert de jouet à l’esprit humain, et chargea Aristandre, en qui reposait sa crédulité, de savoir par des sacrifices quelle tournure prendraient ses affaires. On pourrait donner ici de très nombreux exemples mettant le fait en pleine évidence : les hommes ne sont dominés par la superstition qu’autant que dure la crainte, le vain culte auquel ils s’astreignent avec un respect religieux ne s’adresse qu’à des fantômes, aux égarements d’imagination d’une âme triste et craintive, les devins enfin n’ont jamais pris plus d’empire sur la foule et ne se sont jamais tant fait redouter des rois que dans les pires situations traversées par l’État ; mais cela étant, à ce que je crois, suffisamment connu de tous, je n’insisterai pas.
De la cause que je viens d’assigner à la superstition, il suit clairement que tous les hommes y sont sujets de nature (et ce n’est pas, quoi qu’en disent d’autres, parce que tous les mortels ont une certaine idée confuse de la divinité). On voit en outre qu’elle doit être extrêmement diverse et inconstante, comme sont diverses et inconstantes les illusions qui flattent l’âme humaine et les folies où elle se laisse entraîner ; qu’enfin l’espoir, la haine, la colère et la fraude peuvent seuls en assurer le maintien, attendu qu’elle ne tire pas son origine de la Raison, mais de la Passion seule et de la plus agissante de toutes. Autant par suite les hommes se laissent facilement prendre par tout genre de superstition, autant il est difficile de faire qu’ils persistent dans la même ; bien plus, le vulgaire demeurant toujours également misérable, il ne peut jamais trouver d’apaisement, et cela seul lui plaît qui est nouveau et ne l’a pas encore trompé ; c’est cette inconstance qui a été cause de beaucoup de troubles et de guerres atroces ; car, cela est évident par ce qui précède, et Quinte-Curce en a fait très justement la remarque (liv. IV, chap. X) nul moyen de gouverner la multitude n’est plus efficace que la superstition. Par où il arrive qu’on l’induit aisément, sous couleur de religion, tantôt à adorer les rois comme des dieux, tantôt à les exécrer et à les détester comme un fléau commun du genre humain. Pour éviter ce mal, on s’est appliqué avec le plus grand soin à entourer la religion, vraie ou fausse, d’un culte et d’un appareil propre à lui donner dans l’opinion plus de poids qu’à tout autre mobile et à en faire pour toutes les âmes l’objet du plus scrupuleux et plus constant respect. Ces mesures n’ont eu nulle part plus d’effet que chez les Turcs où la discussion même passe pour sacrilège et où tant de préjugés pèsent sur le jugement que la droite Raison n’a plus de place dans l’âme et que le doute même est rendu impossible.
Mais si le grand secret du régime monarchique et son intérêt majeur est de tromper les hommes et de colorer du nom de religion la crainte qui doit les maîtriser, afin qu'ils combattent pour leur servitude, comme s'il s'agissait de leur salut, et croient non pas honteux, mais honorable au plus haut point de répandre leur sang et leur vie pour satisfaire la vanité d'un seul homme, on ne peut, par contre, rien concevoir ni tenter de plus fâcheux dans une libre république, puisqu'il est entièrement contraire à la liberté commune que le libre jugement propre soit asservi aux préjugés ou subisse aucune contrainte. Quant aux séditions excitées sous couleur de religion, elles naissent uniquement de ce que des lois sont établies concernant les objets de spéculation et de ce que les opinions sont tenues pour coupables et condamnées comme si elles étaient des crimes ; leurs défenseurs et partisans sont immolés non au salut de l'État, mais à la haine et à la cruauté de leurs adversaires. Si tel était le droit public que seuls les actes pussent être poursuivis, les paroles n'étant jamais punies, de semblables séditions ne pourraient se parer d'une apparence de droit, et les controverses ne se tourneraient pas en séditions. Puis donc que ce rare bonheur nous est échu de vivre dans une République, où une entière liberté de juger et d'honorer Dieu selon sa complexion propre est donnée à chacun, et où tous tiennent la liberté pour le plus cher et le plus doux des biens, j'ai cru ne pas entreprendre une œuvre d'ingratitude ou sans utilité, en montrant que non seulement cette liberté peut être accordée sans danger pour la piété et la paix de l'État, mais que même on ne pourrait la supprimer sans détruire la paix de l'État et la piété. Telle est la thèse que mon principal objet a été de démontrer dans ce Traité. Pour y parvenir, il a été nécessaire d'abord d'indiquer les principaux préjugés concernant la religion, c'est-à-dire les restes de notre servitude antique ; puis aussi les préjugés se rapportant au droit des autorités souveraines de l'État. Beaucoup en effet, dans leur licence effrontée, s'efforcent de leur enlever ce droit en grande partie et de détourner d'elles sous couleur de religion le cœur de la multitude encore sujet à la superstition des idolâtres, ce qui nous ferait retomber dans une servitude universelle. Je me propose de dire un peu plus loin en quelques mots dans quel ordre je montrerai cela, mais auparavant j'exposerai les causes qui m'ont poussé à écrire.
J'ai vu maintes fois avec étonnement des hommes fiers de professer la religion chrétienne, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la continence et la bonne foi envers tous, se combattre avec une incroyable ardeur malveillante et se donner des marques de la haine la plus âpre, si bien qu'à ces sentiments plus qu'aux précédents leur foi se faisait connaître. Voilà longtemps déjà, les choses en sont venues au point qu'il est presque impossible de savoir ce qu'est un homme : Chrétien, Turc, Juif ou Idolâtre, sinon à sa tenue extérieure et à son vêtement, ou à ce qu'il fréquente telle ou telle Église ou enfin à ce qu’il est attaché à telle ou telle opinion et jure sur la parole de tel ou tel maître. Pour le reste leur vie à tous est la même. Cherchant donc la cause de ce mal, je n'ai pas hésité à reconnaître que l'origine en était que les charges d'administrateur d'une Église tenues pour des dignités, les fonctions de ministre du culte devenues des prébendes, la religion a consisté pour le vulgaire à rendre aux pasteurs les plus grands honneurs. Dès que cet abus a commencé dans l'Église en effet, un appétit sans mesure d'exercer les fonctions sacerdotales a pénétré dans le cœur des plus méchants, l'amour de propager la foi en Dieu a fait place à une ambition et à une avidité sordides, le Temple même a dégénéré en un théâtre où l'on entendit non des Docteurs, mais des Orateurs d'Église dont aucun n'avait le désir d'instruire le peuple, mais celui de le ravir d'admiration, de reprendre publiquement les dissidents, de n'enseigner que des choses nouvelles, inaccoutumées, propres à frapper le vulgaire d'étonnement. De là en vérité ont dû naître de grandes luttes, de l'envie et une haine que les années écoulées furent impuissantes à apaiser. Il n'y a donc pas à s'étonner si rien n'est demeuré de la Religion même, sauf le culte extérieur, plus semblable à une adulation qu'à une adoration de Dieu par le vulgaire, et si la foi ne consiste plus qu'en crédulité et préjugés. Et quels préjugés ? Des préjugés qui réduisent des hommes raisonnables à l'état de bêtes brutes, puisqu'ils empêchent tout libre usage du jugement, toute distinction du vrai et du faux, et semblent inventés tout exprès pour éteindre toute la lumière de l'entendement. La piété, grand Dieu ! et la religion consistent en absurdes mystères, et c'est à leur complet mépris de la raison, à leur dédain, à leur aversion de l'entendement dont ils disent la nature corrompue, que, par la pire injustice, on reconnaît les détenteurs de la lumière divine. Certes, s'ils possédaient seulement une étincelle de la lumière divine, ils ne seraient pas si orgueilleux dans leur déraison, mais apprendraient à honorer Dieu de plus sage façon et, comme aujourd'hui par la haine, l'emporteraient sur les autres par l’amour ; ils ne poursuivraient pas d'une si âpre hostilité ceux qui ne partagent pas leurs opinions, mais plutôt auraient pitié d'eux — si du moins c'est pour le salut d'autrui et non pour leur propre fortune qu'ils ont peur. En outre, s'ils avaient quelque lumière divine, cela se connaîtrait à leur doctrine. J'avoue que leur admiration des mystères de l'Écriture est sans bornes, mais je ne vois pas qu'ils aient jamais exposé aucune doctrine en dehors des spéculations aristotéliciennes et platoniciennes ; et, pour ne point paraître des païens, ils y ont accommodé l'Écriture. Il ne leur a pas suffi de déraisonner avec les Grecs, ils ont voulu faire déraisonner les Prophètes avec eux. Ce qui prouve bien clairement qu'ils n'ont pas vu, fût-ce en rêve, la divinité de l'Écriture. Plus bas leur admiration les incline devant ses mystères, plus ils montrent qu'en eux la soumission (1) à l'Écriture l'emporte sur la foi, et cela se voit encore à ce que la plupart posent en principe (pour l'entendre clairement et en deviner le vrai sens) que l'Écriture est partout vraie et divine, alors que ce devrait être la conclusion d'un examen sévère ne laissant subsister en elle aucune obscurité ; ce que son étude directe nous démontrerait bien mieux, sans le secours d'aucune fiction humaine, ils le posent d'abord comme règle d'interprétation.
Telles étaient donc les pensées qui occupaient mon esprit : non seulement je voyais la lumière naturelle méprisée, mais beaucoup la condamnant comme une source d’impiété ; des inventions humaines, devenues des enseignements divins ; la crédulité prise pour la foi ; les controverses des philosophes soulevant dans l'Église et l'État les passions les plus vives, engendrant la discorde et des haines cruelles et par suite des séditions parmi les hommes ; sans parler de beaucoup d'autres maux trop longs à énumérer. J'ai résolu sérieusement en conséquence de reprendre à nouveau, sans prévention, et en toute liberté d'esprit, l'examen de l'Écriture et de n'en rien affirmer, de ne rien admettre comme faisant partie de sa doctrine qui ne fût enseigné par elle avec une parfaite clarté. Avec cette précaution donc j'ai formé une méthode (2) pour l'interprétation des livres saints et, une fois en possession de cette méthode, j'ai commencé à chercher avant tout ce que c'est qu'une prophétie, et en quelle condition Dieu s'est révélé aux Prophètes ? et pourquoi ils ont été reconnus par lui ? c'est-à-dire, si c'est parce qu'ils ont eu sur Dieu et la nature de hautes pensées, ou à cause de leur seule piété. Quand j'eus répondu à ces questions, je pus aisément établir que l'autorité des Prophètes a du poids seulement en ce qui concerne l'usage de la vie et la vertu véritable ; quant au reste, leurs opinions nous touchent peu. Ces points acquis, j'ai cherché pour quelle raison les Hébreux ont été appelés les élus de Dieu ? Ayant vu que c'est simplement parce que Dieu a choisi pour eux une certaine contrée où ils pussent vivre en sécurité et commodément, j'ai compris que les Lois révélées par Dieu à Moïse n'étaient autre chose que le droit propre à l'État des Hébreux et par suite que nul en dehors d'eux n'était obligé de les admettre ; bien plus qu'eux-mêmes n'y étaient obligés que pendant la durée de leur État. En outre, pour savoir si on peut conclure de l'Écriture que l'entendement humain a une nature corrompue, j'ai voulu rechercher si la Religion catholique, c'est-à-dire la loi divine révélée à la totalité du genre humain par les Prophètes et les Apôtres, est autre que celle qu'enseigne aussi la lumière naturelle ? Puis, si les miracles ont eu lieu contrairement à l'ordre de la nature et s'ils prouvent l'existence de la providence de Dieu de façon plus claire et plus certaine que les choses connues de nous clairement et distinctement par leurs premières causes ? Mais comme, dans ce qu'enseigne expressément l'Écriture, je n'ai rien trouvé qui ne s'accordât avec l'entendement et qui lui contredît, voyant en outre que les Prophètes n'ont rien enseigné que des choses extrêmement simples pouvant être aisément perçues par tous, et ont seulement usé, pour les exposer, du style et, pour les appuyer, des raisons qui pouvaient le mieux amener la multitude à la dévotion envers Dieu, j'ai acquis l'entière conviction que l'Écriture laisse la raison absolument libre et n'a rien de commun avec la philosophie, mais que l'une et l'autre se maintiennent par une force propre à chacune. Pour donner de ce principe une démonstration rigoureuse et préciser entièrement ce point, je montre suivant quelle méthode l'Écriture doit être interprétée et que toute la connaissance qu'elle peut donner des choses spirituelles, doit être tirée d'elle seule et non de ce que nous savons par la lumière naturelle. Je fais connaître ensuite les préjugés nés de ce que le vulgaire (attaché à la superstition et qui préfère les restes des temps anciens à l'éternité même) adore les livres de l'Écriture plutôt que la parole même de Dieu. Puis je montre que la parole révélée de Dieu, ce n'est pas un certain nombre de livres, mais une idée simple de la pensée divine telle qu'elle s'est fait connaître aux Prophètes par révélation : à savoir qu'il faut obéir à Dieu de toute son âme, en pratiquant la justice et la charité. Et je fais voir que cette doctrine est enseignée dans l'Écriture suivant la compréhension et les opinions de ceux à qui les Prophètes et les Apôtres avaient accoutumé de prêcher la parole de Dieu, précaution nécessaire pour qu'elle fût adoptée par les hommes sans aucune répugnance et de toute leur âme. Ayant ainsi fait connaître les fondements de la foi, je conclus enfin que la connaissance révélée n'a d'autre objet que l'obéissance, et est ainsi entièrement distincte de la connaissance naturelle, tant par son objet que par ses principes et ses moyens, que ces deux connaissances n'ont rien de commun, mais peuvent l'une et l'autre occuper leur domaine propre sans se combattre le moins du monde et sans qu'aucune des deux doive être la servante de l'autre. En outre, puisque les hommes ont des complexions différentes et que l'un se satisfait mieux de telles opinions, l'autre de telles autres, que ce qui est objet de religieux respect pour celui-ci, excite le rire de celui-là, je conclus encore qu'il faut laisser à chacun la liberté de son jugement et le pouvoir d'interpréter selon sa complexion les fondements de la foi, et juger de la foi de chacun selon ses œuvres seulement, se demandant si elles sont conformes ou non à la piété, car de la sorte, tous pourront obéir à Dieu d'un entier et libre consentement et seules la justice et la charité auront pour tous du prix. Après avoir fait connaître cette liberté donnée à tous par la loi divine, je passe à la deuxième partie du sujet : cette liberté peut et même doit être accordée sans danger pour la paix de l'État et le droit du souverain, elle ne peut être enlevée sans grand danger pour la paix et grand dommage pour l'État. Pour le démontrer, je pars du Droit Naturel de l'individu, lequel s'étend aussi loin que son désir et sa puissance, nul suivant le droit de la Nature n'étant tenu de vivre selon la complexion d'autrui, chacun étant le défenseur de sa liberté propre. Je montre de plus qu'en réalité nul ne fait abandon de son droit, sinon celui qui transfère à un autre son pouvoir de se défendre et que, de toute nécessité, le détenteur du droit naturel absolu se trouve être celui à qui tous ont transféré, avec leur pouvoir de se défendre, leur droit de vivre suivant leur complexion propre; et par là j'établis que les détenteurs du souverain commandement dans l'État ont, dans la mesure de leur pouvoir, droit à tout et sont seuls défenseurs du droit et de la liberté, tandis que les autres doivent agir en tout selon leur seul décret. Comme personne cependant ne peut être privé du pouvoir de se défendre au point qu'il cesse d'être un homme, j'en conclus que nul ne peut être entièrement privé de son droit naturel, et que les sujets conservent, comme par un droit de Nature, certaines franchises qui ne peuvent leur être ravies sans grand danger pour l'État et qui, ou bien leur sont accordées tacitement, ou bien sont stipulées avec ceux qui commandent. Après ces considérations, je passe à la République des Hébreux dont je parle assez longuement, montrant en quelles conditions, par quels hommes et quels décrets la Religion a commencé d'avoir force de loi, et indiquant en passant d'autres particularités qui m'ont paru mériter d'être connues. Après cela, j'établis que ceux qui détiennent le souverain commandement ne sont pas seulement les gardiens et les interprètes du droit civil, mais aussi du droit sacré, et que seuls ils ont le droit de décider ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est conforme ou contraire à la piété ; ma conclusion est enfin que pour maintenir ce droit le mieux possible et assurer la sûreté de l'État, il faut laisser chacun libre de penser ce qu'il voudra et de dire ce qu'il pense.
Tel est, Lecteur Philosophe, l'ouvrage que je te donne à examiner avec la conviction qu'en raison de l'importance et de l'utilité de son objet, qu'on le prenne dans sa totalité ou dans chacun de ses chapitres, il ne recevra pas de toi mauvais accueil ; j'aurais là-dessus plusieurs choses à ajouter, mais je ne veux pas que cette préface s'allonge et devienne un volume, je crois d'ailleurs que l'essentiel est connu surabondamment des philosophes. Aux non-philosophes je n'ai cure de recommander ce Traité, n'ayant pas de raison d'espérer qu'il puisse leur convenir en aucune façon. Je sais, en effet, combien sont enracinés dans leur âme les préjugés auxquels sous couleur de piété ils ont donné leur adhésion. Je sais aussi qu'il est également impossible d'extirper de l'âme du vulgaire la superstition et la crainte. Je sais enfin qu'en lui l'insoumission tient lieu de constance et qu'il n'est pas gouverné par la Raison, mais emporté par la Passion à la louange et au blâme. Je n'invite donc pas à lire cet ouvrage le vulgaire et ceux qui sont agités des mêmes passions que lui ; bien plutôt préférerais-je de leur part une entière négligence à une interprétation qui, étant erronée suivant leur coutume invariable, leur donnerait occasion de faire le mal, et, sans profit pour eux-mêmes, de nuire à ceux qui philosopheraient plus librement, n'était qu'ils croient que la Raison doit être la servante de la Théologie ; à ces derniers, en effet, j'ai la conviction que cet ouvrage sera très utile.
Comme d'ailleurs beaucoup n'auront ni le loisir ni le goût de tout lire, je suis obligé de prévenir ici comme à la fin du Traité que je n'ai rien écrit que je ne sois prêt à soumettre à l'examen et au jugement des souverains de ma Patrie ; s'ils jugent, en effet, que j'ai dit quelque chose de contraire aux lois de la patrie ou au salut public, je veux que cela soit comme n'ayant pas été dit. Je sais que je suis homme et que j'ai pu me tromper ; j'ai mis tous mes soins toutefois à ne me pas tromper et en premier lieu à ne rien écrire qui ne s'accordât parfaitement avec les lois de la patrie, la piété et les bonnes mœurs.
(1) : La croyance et la foi diffèrent profondément aux yeux de Spinoza de la crédulité et de la soumission aveugle. Nulle croyance qui n'ait sa vérité, qui ne soit justifiée en un sens (voir Ethique, II, prop. 35 et le scolie), qui ne soit, si l'on préfère, une action de l'âme à quelque degré et n'enveloppe en conséquence quelque liberté ; la soumission aveugle est la déraison même, la passion, l'esclavage, aussi ne peut-elle être justifiée en aucune manière. Sans user du mot, il semble que Spinoza dans ce passage ait proprement en vue le sacré au sens que les historiens de la religion donnent à ce mot quand ils disent qu'une chose tabou est sacrée, c'est-à-dire qu'on a pour elle un certain respect mêlé d'effroi, simplement parce qu'il est défendu d'y toucher et qu'on n'ose pas en approcher. Voir au chapitre v ce qu'il dit des cérémonies de l'utilité desquelles il est impossible de rendre compte par la raison.
(2) : Sur la méthode suivie dans l'interprétation de l'Écriture, voir le chapitre VII; nous ferons simplement observer ici qu'interpréter l'Écriture, c'est, d'abord et avant tout, savoir ce qu'ont voulu dire ceux qui en sont les auteurs, eussent-ils voulu dire les choses les plus absurdes du monde. Pour y arriver, une seule méthode est évidemment possible, celle que les modernes nomment critique; Spinoza en est le véritable inventeur. Il faut lire les textes diligemment, les rapprocher les uns des autres et, pour les mieux entendre, faire usage de tous les renseignements que donnent l'histoire et la philologie. Ainsi toutes les questions qu'énumère Spinoza dans les lignes qui suivent sont d'ordre historique et philologique, nullement d'ordre scientifique et philosophique. Quand par exemple nous saurons ce que c'est qu'un prophète au sens de l'Ecriture, il ne sera nullement prouvé par là même qu'aucun prophète ait jamais existé, ni même qu'un prophète soit possible. La première condition à remplir pour être un bon interprète des Livres sacrés, Spinoza le dit expressément, est de n'y pas chercher la vérité scientifique ou philosophique.



