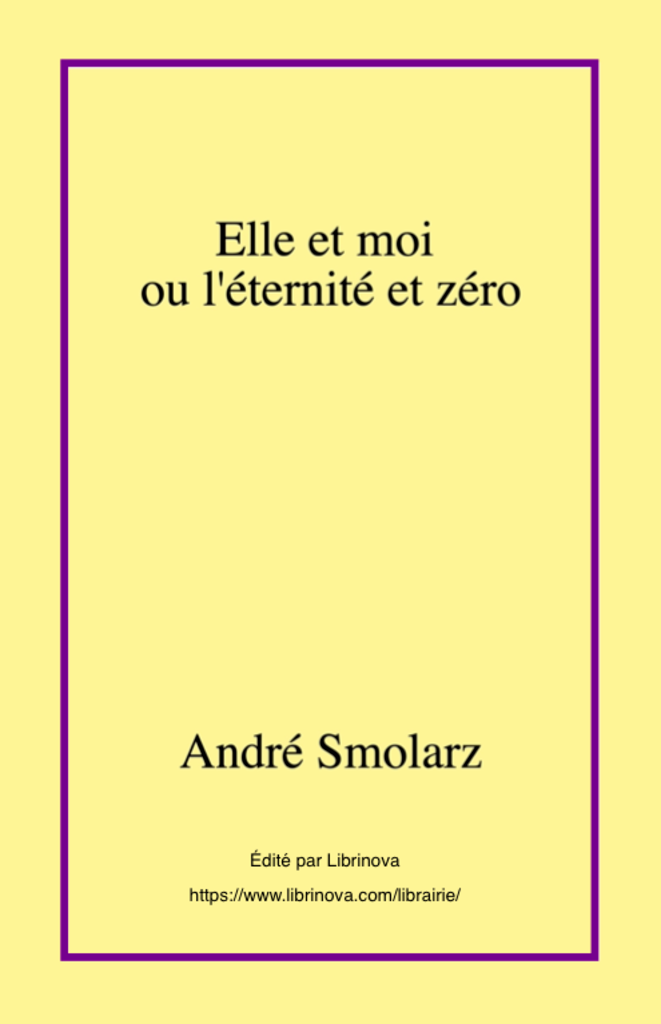Arguant notamment des codes de déontologie qui doivent inspirer leurs pratiques, ces gens-là entendent s’approprier ce que nous avons de plus précieux : notre santé et notre vie.
Le premier obstacle à une fin de vie librement choisie par un patient, tiendrait, selon eux, dans l’incontournable serment d’Hippocrate. Mais celui-ci n’a jamais été gravé dans le marbre ; il a toujours évolué avec les progrès de la médecine. L’avortement en France a été légalisé depuis 50 ans, la chirurgie de la vessie est devenue une opération courante et les professeurs de médecine se font rémunérer pour leur enseignement, contrairement à ce que préconise la déclaration d’origine.
D’abord la phrase « je ne donnerai pas la mort délibérément. » Toute la nuance est dans ce mot : délibérément. Un médecin qui aide un patient à mourir ne « tue pas pour tuer », il « n’assassine pas » de manière délibérée. Donner la mort n’est ni son mobile, ni son intention. Le but est de soulager les souffrances, à la demande du patient. En cela, l’aide active à mourir ne s’oppose pas au Serment d’Hippocrate, au contraire. Elle le rejoint même, un autre article stipulant : « Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. »
Si la loi actuelle évoluait et autorisait l’aide active à mourir, il ne serait donc même pas nécessaire de réécrire une nouvelle fois ce texte. Tout est question d’interprétation. C’est à la fois pour adapter le serment d’Hippocrate aux réalités contemporaines en s’attachant spécifiquement à définir les objectifs humanitaires de la médecine que l’association médicale mondiale a pris la responsabilité d’établir des directives éthiques pour les médecins par le Serment de Genève (1948) :
Je considérerai la santé et le bien-être de mon patient comme la priorité.
Je respecterai l’autonomie et la dignité de mon patient.
La mention du respect de la santé et du bien-être du patient a remplacé la formulation initiale de santé et vie, en lien avec les réflexions sur l’acharnement thérapeutique, avec en 2017, le respect de l’autonomie et de la dignité du patient.
En dépit d’engagements semblables dans son code déontologique, le Président de l’Ordre National des Infirmiers a déclaré, dans les colonnes du Figaro, que « 800 000 soignants étaient résolument opposés à toute forme de suicide assisté ». Bien que l’adhésion à l’ordre ait été déclarée obligatoire dès sa création, il n’y aurait que 52% de cotisants, ce qui traduit bien une certaine réticence vis-à-vis de cette instance professionnelle.[1] Ces déclarations ne peuvent donc n’engager que lui et nous pensons que l’attitude envers la mort, même si un décès sonne pour un soignant comme un échec, relève de la plus stricte intimité, de l’autonomie et de l’autodétermination de la personne concernée.
Il n’y a qu’en France que nos détracteurs opposent systématiquement les soins palliatifs à une mort confortable et choisie ; or les deux attitudes ne sont nullement incompatibles. Ainsi quand la Belgique ouvrait la voie (2002), les autorités de santé ont parallèlement beaucoup investi dans le développement des soins palliatifs, en accroissant les moyens, en encourageant financièrement les proches à l’accompagnement, en développant les soins palliatifs à domicile, et en créant une démarche qualité propre à ce type de services.[2] Le plan décennal en France pourrait encore s’en inspirer. La sédation profonde et continue prévue par la loi Claeys-Léonetti semble exceptionnellement pratiquée en soins palliatifs (56 sédations ayant abouti à la mort pour l’année 2022).[3] Mme Claire Fourcade, présidente de la SFAP et farouche opposante à toute évolution de la loi, affirmant que toutes les velléités de demandes d’euthanasie s’estompaient après quelques heures en service palliatif. On ne peut que s’interroger sur l’autonomie de décision d’un patient épuisé et sous l’emprise d’anxiolytiques et d’antidépresseurs, on pourrait même y voir un abus de faiblesse.
En outre, Mme Claire Fourcade, a laissé entendre que la publication d’une nouvelle loi sonnerait le glas des soins palliatifs en retirant la raison d’être de ces services, et en démobilisant des soignants qui en viendraient à démissionner (Cf. son intervention lors de la troisième session de la Convention Citoyenne : « Si une telle loi passe […] notre travail n’aura plus de sens »). Une telle déclaration ne semble pas inspirée par l’empathie que l’on peut attendre de soignants, mais plutôt par l’aveu du fantasme inavoué de domination sur des personnes horizontalisées, affaiblies et épuisées.
Lors de la présentation de l’avant-projet de loi sur la fin de vie, annoncé comme une solution française, Mme Agnès Firmin Le Bodo a déjà exclu les causes psychiatriques du champ d’application de la future loi, au prétexte que : « Dans ce domaine, l’évolution des protocoles de prise en charge et les avancées thérapeutiques rendraient inappropriée cette solution ! »[4] Implicitement cela laisse bien entendre que pour les pathologies les plus graves, et les cas de décès les plus fréquents : AVC, cancers, la recherche ne ferait aucun progrès. De plus, il est tout à fait légitime de considérer les souffrances psychiques comme les plus réfractaires, même avec des traitements qui obèrent l’autonomie du patient, que la médecine entend protéger.
Qui peut juger des souffrances d’une personne, sinon elle-même ?
Nos détracteurs s’abritent derrière la sémantique ; où commence le soin, où finit le traitement ? Ils se réfugient dans le flou et surtout, s’accrochent aux dogmes du passé et à la religion.
Nous réclamons une loi qui n’oblige personne mais qui propose la liberté de choix, pour le soignant et pour le patient.
Il sera difficile d’instaurer un dialogue serein, constitué d’arguments raisonnables entre les deux parties quand en avançant un dogme, on impose sa volonté à autrui.
Nous craignons fort que la loi à venir soit inefficace et inapplicable, mais nous n'abandonnerons pas pour autant nos convictions ni nos engagements, guidés par un profond attachement à la vie dont l'appréciation de la qualité intime n'appartient qu'à chacune et chacun d'entre nous.
[1] Source https://www.actusoins.com
[2] Source : Fédération Wallonne de soins palliatifs : https://www.soinspalliatifs.be
[3] Source SFAP (Société française d’accompagnement et de soins palliatifs). Chiffre à comparer aux 3.000 euthanasies clandestines estimées par Mme Claire Fourcade pour la France, la même année. Il y aurait aussi des sédations pratiquées dans d’autres services (soins de suite).
[4] Source : Agnès Firmin Le Bodo JDD le 21 mai 2023 (repris par Le Monde)