LES PORTES OUVERTES
Ma mère est née à Alger en 1947. Elle a épousé mon père, né à Farfar, village oasis créé par Yakoub au 14e siècle, berceau des KHIREDDINE et BAARIR, leur familles respectives. Ce village est mitoyen à Tolga, commune plus dense, véritable petite ville des Zibanes, située dans la wilaya de Biskra, où je suis née en 1972.
En 1973 ma mère , mon frère âgé de 7 ans et moi même rejoignons mon père installé à Bezon, dans le val d’Oise, rue de la prudence.
Le monde du travail de l’imprimerie et de la papeterie est alors très dangereux pour les ouvriers y évoluant.
Ouvrier non spécialisé à la papeterie de Nanterre, mon père décédera d’ un accident de travail mortel le 7 mars 1974. Je dis, j' écris, je pense toujours « décède » car embrumée pendant des années par un deuil impossible de trop jeune veuve en terre étrangère, ma mère n’avait pas pu nous parler de cette mort. Les certificats de décès que je consultais en cachette en son absence furent les seuls matériaux à me fournir des mots pour construire notre histoire.
Ces papiers administratifs, comme tous les dossiers médicaux, ne renseignent jamais la mort mais le décès d’une personne.
Ma mère est alors enceinte de ma sœur qui née enfant qualifiée par l’état civil français de « posthume » en juin 1974. Longtemps aussi je restais aussi dans l’ignorance du sens de cet adjectif, fantasmant d’horribles significations (lui manquait-il un organe, un fluide à cette petite sœur ?)
J’ai toujours connu ma mère anxieuse, surtout à la tombée de la nuit, avec une obsession de la porte fermée. Combien de fois ai-je entendu : « as-tu bien fermé la porte, à double tours, s’il te plait », ou encore « tu te rends compte, tu as laissé la porte ouverte toute la nuit ». Au comble de la culpabilité, je questionnais : « comment, vraiment ouverte, entrebâillée ? » « non, non, mais si tu ne tires pas le verrou, elle ne sert à rien cette porte voyons ».
Pendant plus de quarante ans, j’ai mis cette angoisse vespérale sur le compte de l’empreinte laissée par le soir de l’accident fatal de mon père. A cette époque, les familles d’ouvriers n’avaient pas le téléphone. C'est en ouvrant la porte à des employés de la papeterie que ma mère apprit que son mari était à l'hôpital dans un état grave. Le milieu médical étant ce qu’il était alors, voir son mari même inconscient, lui fut refusé de son vivant à lui, elle ne vit quelques jours plus tard que son cadavre.
Elle avait 26 ans, ne parlait pas français, n’avait aucune famille de son côté en France (oui, il y avait nos oncles paternels, avec lesquelles elle n'avait pas à l’époque d’affinités particulières). J’ai souvent pensé à la grande détresse qu’elle avait dû ressentir, à son effroi, à son sentiment de profonde solitude et de catastrophe. Les enfants ne pouvaient apporter l’épaule d’un parent ou d’un proche. Je me suis alors faite l’idée que depuis ce soir-là, la porte de la maison devait pour elle être fermée, fermée aux mauvaises nouvelles, à la douleur et la sidération que fait vivre l’atteinte des corps aimés, à la meurtrissure de nos âmes face à celle des chaires de nos proches.
Mais depuis un an, ma mère âgée de 75 ans raconte son enfance, sa jeunesse presque instinctivement me semble t-il.
J’ai mieux compris l’origine de sa terreur des portes ouvertes. Ma mère avait 15 ans au moment de l’indépendance de l'Algérie. Son enfance et son adolescence ont donc eu lieu sous l’occupation française.
Le village était un véritable ksor avant les pluies diluviennes de 1969. Ses dimensions, matériaux de constructions traditionnels, étaient adaptés depuis des siècles aux fortes chaleurs de la région de Biskra. Le Ksar ou ksor se présente sous la forme d'un groupement d'habitat compact généralement fortifié et entouré d'une vaste palmeraie.
Notre village avant le désastre diluvien qui emporta la majorité des habitations, avait sa fortification, ses deux portes, la porte sur la façade avant du Ksor, Bab El Gabli et la porte sur la façade arrière, Bab El Dhahri.
Ma mère racontait que dans les temps anciens, les portes étaient fermées à clef une fois la nuit tombée. À tour de rôle, la garde était montée par un homme du village. Quand un étranger se présentait à la porte, il était questionné sur la nature de sa visite, et si le village constituait une étape dans un long voyage, l’hospitalité était offerte.

Agrandissement : Illustration 1

Les maisons mitoyennes communiquaient par leur terrasse, El stahe, où on dormait à la belle étoile l’été. La brique d’argile, recouverte de chaux atténuait les chaleurs de l’été, les échanges thermiques avec l’extérieur minimisés par la dimension réduite (hauteur humaine) des intérieurs.
Derrière les portes de bois, l’entrée s’élargissait sur la pièce principale où se trouvait le foyer, souvent dans l’arrière de cette pièce, le lieu de stockage des denrées alimentaires ; des niches murales permettaient le rangement et donnaient tout à la fois du charme et de la profondeur aux pièces. Les couches des couples se trouvaient souvent en mi-hauteur, dans des pièces accessibles par une échelle de bois (une espèce de mezzanine).
Mon père avait décoré la pièce centrale de sa maison d’une magnifique fresque représentant un paon bleu vif, aux ailes vertes.
Les membres d’une même famille s’installaient par essence les uns près des autres, instaurant des quartiers se constituant d’une ruelle ou deux, il y avait haret des Anede, celle des Baarir…
Les revendications des intellectuels et militants autochtones algériens dans les années 50 suscitèrent en premier lieu des tentatives de propagande du gouvernement français auprès de la population générale algérienne.
Ma mère se souvient enfant des prospectus distribués par des avions en plein vol au-dessus des villages, de l’ école source première de propagande, bien qu'aujourd’hui on l’oublie trop cette dimension de "l'éducation nationale". Le premier acte de résistance de mon grand-père fut de refuser que ma mère, la plus jeune de ses filles aille à l’école française. Après tout, qu’avaient appris ses aînées les années précédentes : la couture ? Les villageoises n’avaient pas besoin de l’école française pour se transmettre la couture, l’art de tisser la laine et de tisser des tapis… quoi d’autre ? La chanson de Thierry la Fronde, oui ma tante l’avait apprise et cela avait certainement fini de convaincre mon grand père que la France les méprisait, en faisant scander à sa fille une hymne de résistance d’un peuple qui en opprimer alors un autre :
« Ami le temps n’est plus aux chansons.
Il faut partir, laisser ta maison.
Et tout quitter, jusqu’à son nom (…)
Nous donnerons aux enfants du monde
Des nuits sans crainte et des jours sans honte
Des matins clairs et des chansons »
Pour qui étaient les nuits sans crainte et les matins clairs ?
Les soldats faisaient le tour des maisons, à la recherche d'enfants en âge d’être embrigadés, une école de la liberté encadrée par l’ armée.
On cacha ma mère sous la natte d’Alfa montée sur pied, el SADA. On cacha ma mère dans l’arrière pièce parmi les provisions.
Mais mon grand-père voulait de l’instruction pour ses filles. Il lui apprit à lire et écrire l’arabe, à compter à la maison.
La propagande française ne porta pas ses fruits. Le village comme la région fournit son lot de maquisards à la résistance qui, faute de voir aboutir ses revendications nationales, internationales, s'organisa pour la résistance armée.
Les premiers lycéens autochtones saisirent précocement et douloureusement leur statut d’indigènes sous citoyens, montèrent aux jebeles avec d’autres, vers les Aurès. Toute une génération de jeunes agriculteurs, artisans, quittèrent aussi leurs familles en espérant des jours meilleurs pour leur peuple qui vivait dans la pauvreté extrême, l’absence de droit et de liberté.
Les représailles remplacèrent alors la propagande.
Il y a diverses façons de vouloir convaincre les villageois de ne pas devenir résistants ou de les soutenir d’une quelconque façon mais la terreur fut la réponse du colonisateur.
De jeunes gens furent assassinés. Ils disparaissaient un soir, on retrouvait leur cadavres flottant le long de la rivière… Pauvre rivière, qui portait un si joli nom de fille, Khadijah. Elle les enveloppait bien contre son gré dans ses bras d’eau douce, ces corps sans âmes que les mères épouvantées secouaient comme si elles espéraient les réveiller de leur sommeil aquatique. La majorité des jeunes villageois assassinés n’étant pas des résistants, le sentiment d’injustice nourrit alors encore plus le sentiment de révolte et des pères de famille développèrent tout un réseau d’aide au maquisards : transport d’arme, ravitaillement alimentaire et en eau, fourniture de vêtement civile, dons en monnaie et or (les femmes donnèrent leur bijoux, cette partie de la dot qui a pour particularité d’être une réserve de bien non dévalorisable)… Et au lieu d’entendre, le colonisateur s’acharna. Arrestation, détention arbitraire sans procès, sans avocat, tortures… assassinats. Il n’est pas certain que tout cela fut le quart de ce que le processus de colonisation en lui-même fit endurer aux Algériens (pauvreté, malnutrition, destruction des systèmes ancestraux de transmission des cultures, des savoirs faire, assassinats des chefs de village, de famille, spoliation des terres au siècle précédent).
Mon grand-père fut arrêté, il survécut. Ma mère me raconta qu’il ressemblait à un cadavre vert à sa sortie de détention du “camp”, situé à Tolga. J’imagine aujourd’hui son corps avec le même aspect que décrit Monsieur Chamoiseau dans Texaco, concernant le grand père de la narratrice, enfermé dans une cave des années entières par le propriétaire terrain pendant la période de l’esclavage (existant et inscrit dans la loi de la République alors).
Il fallut une année entière à mon grand-père pour retrouver une force physique lui permettant de marcher seul. Il lui fallut beaucoup plus pour pouvoir raconter à demi mot les conditions de détention qui constituaient en elles même des méthodes de torture. Pendant des mois, il avait été emprisonné dans un sous-sol, creusé de façon à être étanche et où un niveau d’eau était maintenu pour atteindre en permanence les cuisses. Ses pieds ne s’en remirent jamais, et je l’ai toujours connu assis en tailleur sur son lit, se déplaçant avec de l’aide uniquement. Il ne raconta pas le reste à ma mère mais son silence quasi permanent les premiers mois de son retour chez lui, en disait long.
Les prisonniers n’étaient nourris qu’au pain rassis. Ma mère accompagnait ma grand-mère déposer quelques frugales choses à manger, elles étaient si pauvres, vivaient du travail de la laine sur le métier à tisser et mangeaient elles même très peu comme la majorité des autochtones, alors très sous alimentés. Le "camp" de détention était à plusieurs kilomètres et elles s’y rendaient à pied.
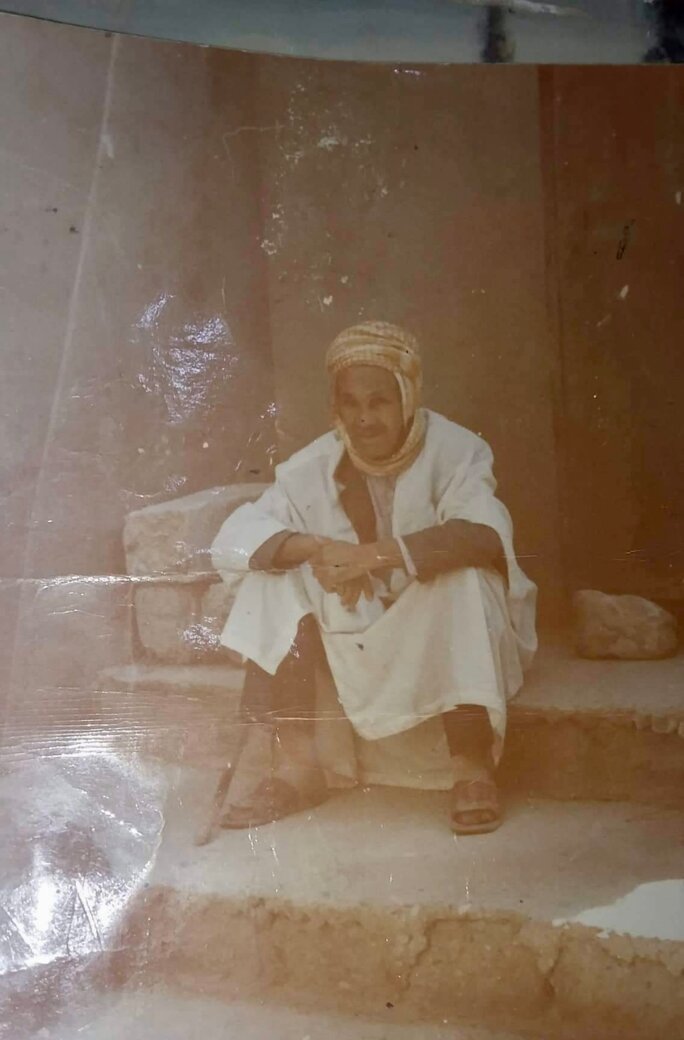
Agrandissement : Illustration 2
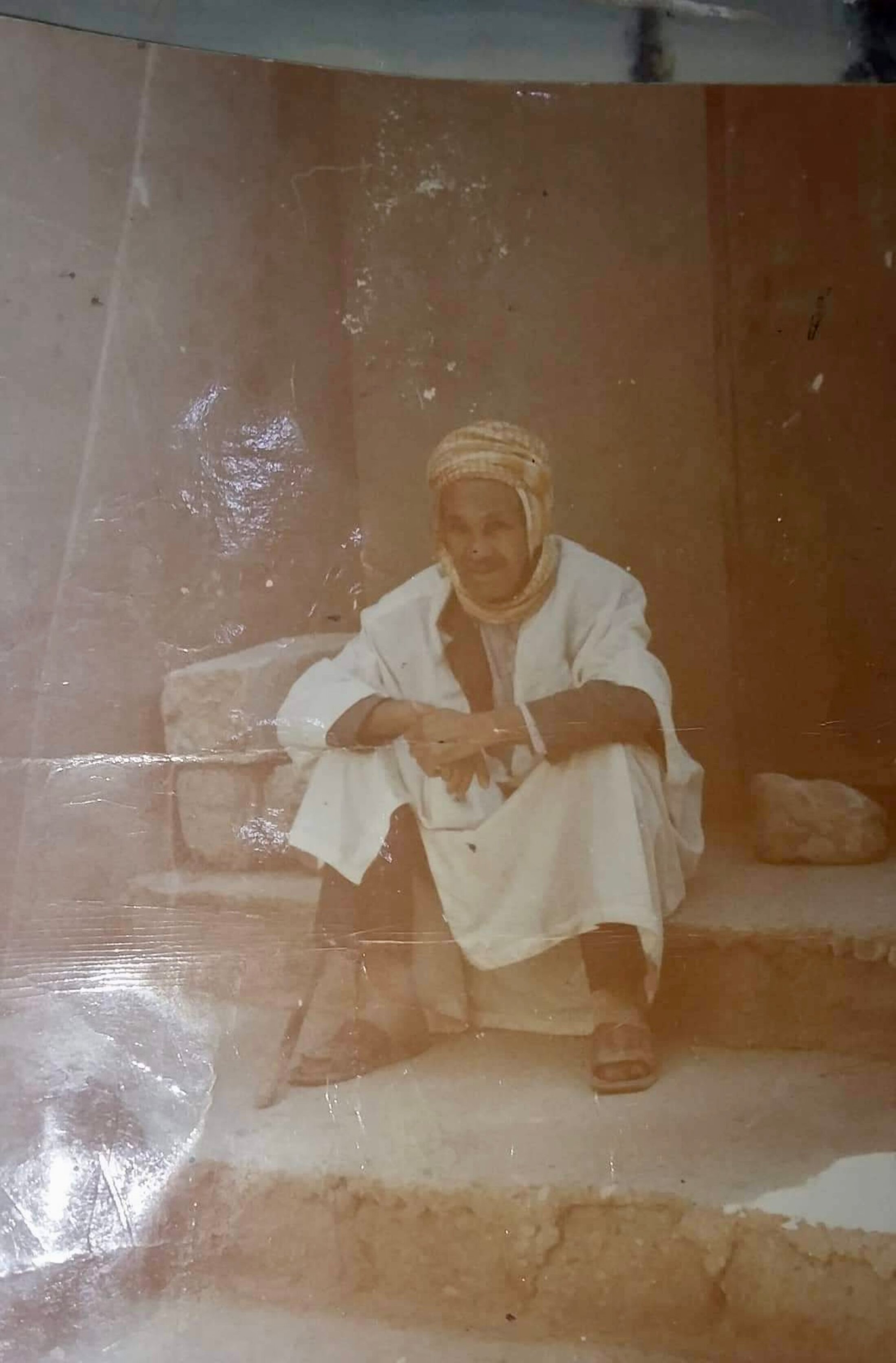
Ma mère se souvient d’avoir reçu à un Aid une robe dont elle garde un souvenir éblouissant, une robe de Katefa (velours, bracart) mauve. Elle se souvient aussi que les heures passées sous le soleil d’été accablant avait fini par avoir raison de la chatoyante couleur qui disparut complètement sur le dos de la robe, lui donnant un étrange aspect bicolore.
La répression se fit forte au village et pour installer la terreur le décret des portes ouvertes fut instauré.
L’idée était d’empêcher toute liberté individuelle ou détruire ne serait-ce que l’idée que cette liberté pouvait subsister quelque part et profiter aux maquisards.
Le jour comme la nuit, il fut décrété par l’armée française l’interdiction à chaque villageois de fermer la porte de son habitation. L’existence même de l’alliance familiale était attaquée. Si on s’en réfère à la vulgarisation occidentale de la philosophie grecque (Aristote), il est supposé un passage de la famille à la tribu et de la tribu à la cité, et la cité n’était-elle pas considérée toujours dans le fil de cette vulgarisation, à l’origine de la civilisation ?
La population autochtone était alors désignée comme dépourvue de toute civilisation, puisque le droit à l’intimité familiale lui était refusé. Où peut-on pénétrer sans respecter le sommeil, la confidentialité des rapports, le droit à la vie privée : les enclos à bestiaux.
Cette désignation intégrée par des générations d’autochtone fut à l’origine d’une auto désignation qui perdura jusqu’à ce que j’atteigne l’âge adulte : « elle s’habille cifilisée (il n’ y’a pas de v en arabe) elle » en parlant d’une femme habillée en mode occidentale, européenne. La femme en robe ample ou saroual, foulardée (je préfère la dénomination de foulard qui se porte de 1000 façons différentes plutôt celle de voile), dévoilerait donc un type d’habillement relevant du domaine du « non civilisé ».
Les militaires pouvaient entrer, aller et venir dans les maisons à n’importe quelle heure, sans justification aucune.
Ce fut ce qui terrorisa le plus ma mère, pendant l’absence de son père, elle vivaient entre femmes, elle, sa mère, ses trois sœurs, et une proche qui vivant seule dans une maison, préférait se joindre à elle plutôt que de vivre isolée sans possibilité de fermer sa porte.
Ma mère se souvient encore des tremblements qui secouaient son corps lorsqu'elle entendait le moindre bruit dans la nuit, des insomnies liées à la peur, et du sentiment d’injustice profonde et de haine que créait en elle cette interdiction de refermer la porte de la maison sur la vie familiale.
Les soldats torturaient, tuaient mais lorsqu’ils ne le faisaient pas, ils pouvaient voler, plusieurs familles en témoignèrent. Les familles avaient donc décidé de creuser dans le sol dans une partie reculée de la maison, une espèce de coffre de fortune, qui ne contenait aucune réelle fortune : un trou au fond duquel on avait déposé des papiers d’état civils, quelques sous, quelques bijoux, du tissu de qualité.
Et on s’angoissait encore plus à l’idée que si les soldats découvraient le trou, ils voleraient tout d’un seul coup alors.
Aujourd'hui encore, ma mère est obsédée par la fermeture à double tours de la porte et plus encore.
Depuis ma plus tendre enfance, je lui connais en effet un rituel de « coffre de fortune ». Bien sûr les voisines plus jeunes des cités hlm avaient aussi leurs cachettes, au fond du placard sous l'évier, sous le matelas, dans le congélateur : le double sac en plastique contenant les quelques bijoux et économie trouvait sa place. Les rituels de ma mère étaient plus élaborés : elle pouvait confectionner un repose-pieds en tissu en forme de tortue qui trônaient en toute innocence au milieu, et sous les chaussons et claquettes de plastiques algériennes. Un autre été, avant de partir en vacances en Bretagne ou en Loire Atlantique, elle pouvait coudre un double jupon dans une robe n’en nécessitant pas, et à l’intérieur du double jupon une appendice de tissu supplémentaire gardait ses trésors. Cette robe restait suspendue dans le placard entre deux manteaux achetés au rabais au marché des 4 chemins à Colombes et un long gilet de laine tricoté à la main, et attendait sagement notre retour.
Maman ne pouvait envisager autrement l’existence et la survie de sa famille : pouvoir fermer sa porte et mettre hors de portée ses quelques biens. Pour le reste elle n’avait pas d’inquiétude. Elle s’étonnait souvent de l’incompréhensible peur que pouvaient avoir les plus jeunes de n’avoir pas de quoi « vivre demain ».
A chaque jour sa peine et à chaque jour ses moyens. Elle n’achetait jamais aucun électroménager à crédit ou même en le payant plusieurs fois sans frais. Pour elle à chaque jour sa peine, à chaque jour ses moyens et si aujourd’hui tu ne peux pas te payer une cathodique, tu écouteras la radio tsf jusqu’à ce que tu es mis assez d’argent de côté, en usant tes chaussures jusqu’à ce que la semelle se perce (au moins tu en as des chaussures, disait elle, son enfance pauvre l’en priva des années), en ne jetant jamais le pain rassis qui se recycle en chapelure, en économisant l’eau de rinçage de la machine à laver qui ne sera pas déversée dans l’égout mais réutilisée pour maintes autres tâches ménagères…
Ma mère me raconte aussi actuellement d’autres horreurs survenues à la même époque, de nature différente. On ne va pas se mentir, comme dans toute lutte, les horreurs fratricides existèrent, même au village, même au sein des familles. Que dire?Un siècle et demi d’oppression, d’assassinat physique, de destruction structurelle sociétale, de destruction culturelle, d’humiliation, de privation avait dépossédé ses jeunes maquisards de leurs ainés, d’une culture anéantie, de conseils, de recommandations, les avait aigris bien avant l’âge. Rien n'excuse les horreurs de ces jeunes gens, mais tout condamnent doublement autant la responsabilité des décisions destructrices prises pendant ce siècle et demi par les gouvernements successifs de l’époque de notre état dit de droit, héritier du siècle des lumières.



