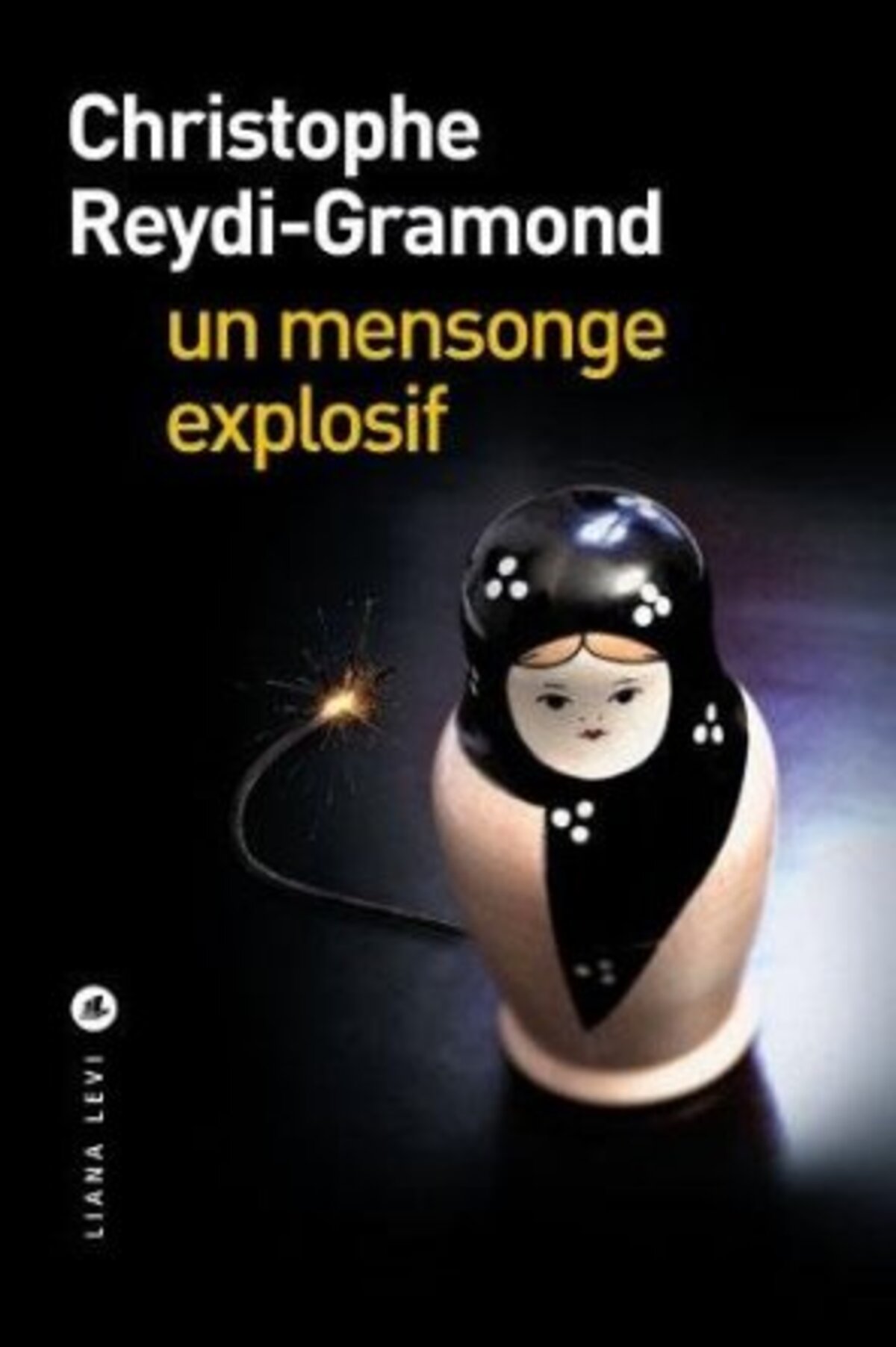
Le roman de Christophe Reydi-Gramond fait partie de ces livres qui s’emparent d’un fait divers pour en tirer une fiction : un exercice difficile et exigeant, qui peut aboutir à de grandes réussites comme à des échecs retentissants. Ici, l’auteur a choisi un sujet très controversé et hyper médiatisé, puisqu’il s’agit de la gigantesque explosion d’un stock de nitrate d’ammonium entreposé à l’usine AZF de Toulouse, une explosion qui a provoqué, le 21 septembre 2001, 31 morts et 2 500 blessés.
Pour un écrivain désireux d’utiliser un fait divers pour en tirer une fiction, on peut dire que cet évènement dramatique est un sujet en or. En effet, malgré deux décisions de justice, aucune explication satisfaisante n’a été apportée sur les causes de ce qui est judiciairement considéré comme un accident, alors même que l’hypothèse de l’attentat a toujours de nombreux partisans. De nombreuses zones d’ombres subsistent, ce qui donne la part belle à un possible roman. Comme vous pouvez vous en douter, l’auteur n’a pas privilégié la thèse de l’accident ! Normal : après tout, un attentat est, sur le plan romanesque, bien plus porteur d’intrigues que la simple négligence professionnelle. Mais, préférant la position de romancier à celle d’enquêteur, il précise avec humour dans ses remerciements :
« Conscient de ce que ce livre leur doit, la gratitude de l’auteur va en premier lieu à ceux – policiers, magistrats, journalistes... – qui ont suffisamment mal fait leur travail dans l’affaire AZF pour abandonner au romancier une vaste friche où laisser galoper son imagination, qui n’en demandait pas tant ».
Dix jours après le choc provoqué par la destruction des deux tours du World Trade Center, la relative proximité de l’élection présidentielle française de mai 2002 ainsi que l’implication de la société TOTAL, dont AZF était une filiale, pouvaient laisser espérer des potentialités fictionnelles prometteuses, et en effet, l’auteur ne s’en est pas privé ! Peu de romans marient avec autant d’habileté réalité et fiction. La documentation utilisée pour donner de la crédibilité au récit est sans faille, et s’appuie largement sur les différentes sources d’enquêtes, aussi bien internes que judiciaires ou privées.
Mais la réussite du livre est due à la façon dont il parvient à lier l’enquête policière avec des considérations de géopolitiques liées à l’énergie (celle-ci est au cœur de l’histoire), ainsi qu’avec des trajectoires de vie exceptionnelles. S’y rajoute une description savoureuse des rapports de force entre des sociétés multinationales qui considèrent que tous les coups sont permis pour développer leur influence, même les coups les plus tordus. Ces multinationales, ainsi que les états les plus puissants, obéissent à un même impératif, nous montre Christophe Reydi-Gramond : parvenir à leur fin, quoi qu’il en coûte et quel que soit le prix humain à payer, à partir du moment où leurs intérêts financiers ou l’intérêt supérieur (mais hypothétique) de l’État sont en jeu.
L’auteur arrive à rendre vraisemblable cet impératif qui gouverne notre monde, en utilisant à la perfection les dialogues et en peaufinant ses personnages, dont certains sortent de l’ordinaire. Le personnage le plus fascinant du roman est sans aucun doute celui de Jean-François Orcine, un grand physicien français disparu dans les années 70, dont les recherches portaient sur une nouvelle source d’énergie susceptible de bouleverser le destin de l’humanité. Pour des raisons idéologiques, le scientifique s’était enfui en URSS ou il avait poursuivi ses recherches dans un centre militaire. Quel est donc le lien entre ces recherches sur l’énergie, qu’il mène depuis trente ans, et l’explosion de Toulouse ? C’est ce que nous allons découvrir et comprendre au fil de l’intrigue, qui est suffisamment complexe pour accrocher tous les lecteurs de polars et dans laquelle le suspense est toujours présent.
Le sérieux des considérations géopolitiques et stratégiques est tempéré par des développements sur les Ummites (ces extra-terrestres supposés qui auraient envoyé des messages à caractères scientifiques et philosophiques à certains terriens) ainsi que sur le mouvement cosmiste russe, qui n’empêchent pas le récit de conserver toute sa cohérence. L’écriture est sobre, efficace, avec des phrases courtes et souvent percutantes, l’auteur va droit au but qu’il s’est fixé, sans fioritures et sans chichi. Sa description de l’explosion, vue à travers les yeux d’un enfant de onze ans passionné d’ornithologie, est révélatrice de son style :
« Soudain, une détonation, aérienne, comme le bang d’un avion, suivie d’un sifflement formidable, le fit bondir sur ses pieds. L’œil vissé au reflex, il essaya de comprendre d’où ça venait. Le sifflement s’arrêta net, et un grand éclair rectiligne jaillit du pied de la colline, parallèle à la surface de la Garonne. Le trait de lumière traversa l’étendue du pôle chimique en une fraction de seconde, jusqu’à toucher une ligne à haute tension. Au moment où tous les câbles de celles-ci se rompaient en serpentant dans un tourbillon d’étincelles, Hugo sentit un grondement : la colline tremblait. Il vit alors la cheminée de l’usine d’engrais décoller, lentement, comme les fusées à la télévision, en même temps qu’un hangar se volatilisait.
Alors l’horizon tout entier s’enflamma en un magma aveuglant. Vint le bruit. Vint le souffle. Vinrent la poussière et l’odeur. Enfin, le silence retomba ».
Ce roman est une vraie réussite : intelligence des situations et des personnages, intrigue complexe et bien menée, écriture s’adaptant parfaitement à son sujet... que demander de plus ? Le lecteur est baladé de chapitre en chapitre et assiste, séduit et médusé, à la transformation d’un accident industriel en histoire planétaire où la géopolitique frôle parfois la métaphysique, sans jamais se prendre trop au sérieux. Un beau travail de romancier !
Cette chronique a également été publiée sur mon blog, lectures et chroniques
Un mensonge explosif
Christophe Reydi-Gramond
Éditions Liana Levi (27 mai 2014)
Collection : Policiers 360 pages ; 19 €
________________________________________________________________
Entretien avec Christophe Reydi-Gramond

Il vient de sortir son premier roman, Un mensonge explosif, qui devrait faire du bruit et l'imposer dans le Landernau littéraire comme un auteur à suivre. Pour les lecteurs de Médiapart, Christophe Reydi-Gramon a accepté de répondre à quelques questions.
_____________________________________
J. Pourriez-vous nous donner un aperçu de votre parcours d’écrivain ? Comment êtes-vous arrivé à l’écriture ?
Christophe Reydi-Gramond. J'ai l'impression de n'être jamais "arrivé" à l'écriture parce que j'ai le sentiment d'être né dans les bouquins et de n'en être jamais sorti. Ma mère prof de lettres écrivait, plus tard mon père marin aussi, tous nos appartements ont toujours été tapissés de livres jusqu'au plafond, j'ai lu toute mon enfance y compris des livres qui n'étaient pas "de mon âge", parce qu'on n'avait pas la télévision et que lire me paraissait aussi évident qu'à un politicien de mentir. Et puis un jour, j'ai fait comme le héros de "Le meilleur des mondes" : j'ai réalisé que s'il y avait des livres, c'est qu'il y avait quelque part des gens pour les écrire. Alors je me suis dit que ce quelque part était ma place, de toute évidence.
J. Comment vous est venue l’idée d’écrire un roman centré sur l’affaire AZF ?
C. R-G. Je cherchais une bonne histoire à raconter. Je pense que quand on tient une bonne histoire, on a fait 80% du boulot. Après, le style, la narration, les personnages, tout ça c'est très bien mais si on n'a pas LA bonne histoire au départ, c'est un peu comme de la mousse sans bière, juste un faux-col. Or les bonnes histoires, la réalité en est une pourvoyeuse fidèle, généreuse et illimitée. L'affaire AZF m'avait, comme à beaucoup de gens je pense, laissé un arrière-goût d'enfumage, l'impression qu'on avait pris les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Je me suis dit que de la traiter comme une fiction serait en quelque sorte lui rendre la monnaie de sa pièce. Cela m'a trotté dans la tête pendant sept ans, et puis je m'y suis mis et ça m'a pris 4 ans pour l'écrire (je suis assez lent). Mais pour être exact, mon roman n'est pas centré sur l'affaire AZF. C'est le prétexte, le fil conducteur, mais ce n'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre c'est celui de la fin et des moyens, une très vieille question.
J. Avez-vous élaboré un plan détaillé de cette histoire (plutôt complexe) avant de commencer l’écriture? L’avez-vous suivi ?
C. R-G. Non, je ne fais pas de plan avant d'écrire. Je promets d'essayer d'en faire un la prochaine fois, parce que ça fait sérieux et, maintenant que je suis un auteur publié, il faut que je fasse gaffe à mon standing. Mais en vrai, les plans me dépriment. J'ai déjà suffisamment d'agendas dans ma vie. Et puis, j'ai horreur des polars où l'on comprend comment ça va se terminer dès la page 30. Alors je me dis que si moi-même je ne sais pas comment mon bouquin va tourner au chapitre suivant, il n'y a aucune chance que le lecteur le devine ! Ceci dit, c'est exténuant. Surtout sur une longue période. Un plan, après tout, représenterait un certain confort, quitte à ne pas le suivre. Je vais y réfléchir.
J. L’intrigue et les thèmes que vous développez dans Un mensonge explosif vont au-delà de ceux d’un polar classique puisque vous abordez des problèmes de géopolitique liés à l’énergie du futur. L’idée de partir d’AZF pour arriver à ces questions, vous l’avez eue d’emblée, ou au contraire s’est-elle imposée pendant l’écriture du roman ?
C. R-G. C'est venu peu à peu (comme toute l'histoire), à force de tirer des fils qui tiraient des fils qui tiraient des fils... Au bout du compte, il a bien fallu que je trouve une explication d'ensemble à une série de faits dont la concomitance est (toujours) inexplicable. Pour ça, il m'a fallu monter très haut ("Tout converge en s'élevant" comme disait le vieux Teilhard !). Ceci dit, je suis bien content d'avoir trouvé, sinon je n'aurais jamais pu finir.
J. Treize ans après l’explosion, malgré les jugements de justice qui ont conclu à la thèse de l’accident chimique, la controverse et les doutes sur la cause réelle de l’explosion ne sont pas terminés. Quelle est votre intime conviction sur le sujet : accident industriel ou attentat ? Pensez-vous que cette affaire est un bon exemple de la fascination que le public peut éprouver pour les théories du complot ?
C. R-G. Mon intime conviction est double : 1) la version officielle n'est probablement pas vraie, 2) fort peu de gens savent ce qui s'est réellement passé ce jour-là et je n'en fait pas partie. Il est même possible que ce ne soit ni un accident, ni un attentat. Mais je ne suis pas policier, ni magistrat, ni même journaliste. Mon propos c'est de raconter une histoire, bonne si possible, pas de révéler une quelconque vérité. En cela mon roman n'a rien de "complotiste", car je ne prétends à rien d'autre qu'à faire passer un bon moment à mon lecteur. Mon livre est plutôt bien documenté, mais si quelqu'un espère y trouver des révélations, il sera déçu. Tout ce que j'ai fait, c'est donner une forme à un tas de briques qui sont autant de morceaux de réalité. Les briques sont des briques, mais selon la façon dont vous les ordonnez, vous pouvez en faire un abris-bus ou un bassin à carpes. Avec le même tas de briques-réalité, un autre aurait écrit un livre complètement différent, et même 10 autres livres ! Mon œuvre de fiction est là : dans le trait qui relie les points, pas dans les points eux-mêmes. Ceci étant dit, je trouve un peu snob le mépris qu'il est de bon ton aujourd'hui d'afficher vis-à-vis des théories de complot dans la littérature ou le cinéma. Il existe bien des romans érotiques, historiques, pourquoi pas complotistes ? Après tout, depuis Voltaire et son Homme au masque de fer ou Dumas et le Comte de Monte-Cristo, c'est un genre qui a, aussi, ses lettres de noblesse. Et au cinéma, Les trois jours du condor reste un chef d'œuvre.
J. J’ai eu le sentiment qu’en intégrant à votre récit, de façon savoureuse, les thèmes Ummites et Cosmistes, vous avez totalement lâché la bride à votre imagination. C’est quelque chose qui pour vous fait partie du plaisir de l’écriture ?
C. R-G. L'affaire Ummo et le Cosmisme n'ont rien d'imaginaire, malheureusement, mais c'est vrai que ça été du pur bonheur de manipuler ce matériau incroyable ! Oui, le plaisir d'écrire est important, il est même premier en ce qui me concerne. J'écris régulièrement depuis 25 ans sans avoir quasiment rien publié (2 ouvrages jeunesse il y a 15 ans), alors si ce n'était pas pour le bonheur que cela me procure, je ferais des albums de timbres. Et puis, j'aime bien que la frontière entre réalité et fantastique soit poreuse, sans qu'on sache très bien lequel déteint sur l'autre.
J. Vous avez imaginé toute une série de personnages très forts, très denses, qui cohabitent avec certains personnages bien réels (le premier ministre de l’époque, par exemple). Le plus fascinant, pour moi, est celui de Jean-François Orcine, physicien génial qui s’expatrie en URSS dans les années 1970 pour des raisons idéologiques et qui va se trouver trente ans plus tard au cœur d’un conflit planétaire qui le dépasse. Comment vous est venue l’idée de ce personnage ?
C. R-G. Il est venu assez tôt dans la construction. J'avais besoin d'un Pontifex, un pont entre deux rives, capable de relier non seulement le passé au présent mais aussi l'idéologie au business, le bien au mal et les personnages entre eux. Orcine est pour moi un personnage très incarné bien que composite, cela ne m'étonne pas qu'il vous ait plu. D'abord, j'ai utilisé les initiales de quelqu'un que je côtoie tous les jours, cela m'a aidé à penser à lui comme à une vraie personne. Ensuite, j'ai calqué sa bio sur celle d'un scientifique réel, le Pr Jean-Pierre Petit, dont je trouve le côté Ufologue touche-à-tout sympathique (même si je ne le connais pas). Après, je me suis appuyé pour le faire parler sur des textes de quelqu'un qui fut longtemps la personnalité préférée des Français : le commandant Cousteau, plus connu pour ses films sous-marins que pour ses positions écologistes ultra-radicales. Orcine est un personnage entier, d'un bloc, intègre donc intégriste, un personnage de tragédie grecque. C'est ce qui le rend attachant. C'est aussi un fou, bien sûr, mais comme dit Armand Béranger : "La vérité pour la vérité n'intéresse plus personne, à part les saints et les fous". Béranger est un homme raisonnable. Orcine est un homme qu'on peut aimer. D'ailleurs, sa femme n'a jamais cessé.
J. Ce roman est publié par Liana Levi dans la collection « policiers », même s’il déborde le cadre d’un polar traditionnel. Comment considérez-vous la littérature policière ? Quels sont vos auteurs préférés, dans ce domaine ?
C. R-G. Ne le répétez pas (ce ne serait pas bon pour mon nouveau standing) mais je ne lis pas beaucoup de polars modernes. A part peut-être Fred Vargas, à petite dose, et Ellis Peters, mais sinon j'en suis resté à John Le Carré, James Hadley Chase, Raymond Chandler... Pire - car il est fort peu en vogue -, ma préférence dans ce domaine va à Vladimir Volkoff. C'est vous dire... Quand à ce que mon roman déborde du cadre, je veux bien vous croire, mais je mets un penny sur la tête de celui qui me dira ce qu'est le cadre d'un polar.
En dehors du polar, quelles sont vos influences littéraires ? Votre rapport avec la littérature ?
C. R-G. Bizarrement, mon truc à moi en littérature, c'est surtout la nouvelle. J'adore ça et je ne comprends pas le désamour du public français pour ce genre riche entre tous. Champion toutes catégories à mes yeux : Dino Buzzati. Et, parmi les modernes, il y en a un que j'apprécie beaucoup, c'est Sylvain Tesson. Sinon, les grands bouquins qui m'ont marqués : 1984, La ferme des animaux, Le zéro et l'infini... Je lis moins qu'autrefois, par manque de temps, ce qui explique que mes références datent un peu. Et puis, j'ai hérité d'une culture un peu classique, Dostoïevski, Balzac, Chateaubriant, Walter Scott... Mais aussi Gaston Leroux, La Varende, H.P. Lovecraft, Vialatte, Alphonse Allais, Ray Bradbury ! Récemment cependant, j'ai découvert en arrivant chez Liana Levi, Milena Agus. Liana m'en en offert un, j'en ai lu 3 autres dans la foulée. Cela m'a bluffé. Je ne savais pas qu'on avait le droit d'écrire comme ça. Je rate sûrement des tas de choses.
J. Quels sont vos projets immédiats ? Un autre livre en cours d'écriture ?
C. R-G. Mon projet le plus immédiat est d'accompagner autant que possible la sortie de 'Un mensonge explosif'. C'est mon premier roman publié, cette expérience-là est donc unique par nature et je ne veux pas rater ça. Ensuite, j'en ai un autre qui mijote à petits feux (en cours de ré-ré-réécriture) et je suis à la recherche d'une bonne histoire à raconter pour le 3e (si vous avez un tuyau, je suis preneur). Entre temps, j'écris parfois une nouvelle sur un coin de table, histoire de me détendre.



