Paris 1900 : la ville spectacle. C’est l’invitation à laquelle le Petit Palais nous convie du 2 avril au 17 aout. Ce sont plus de 600 œuvres, réparties en espaces thématiques, qui sont mises à disposition du visiteur.
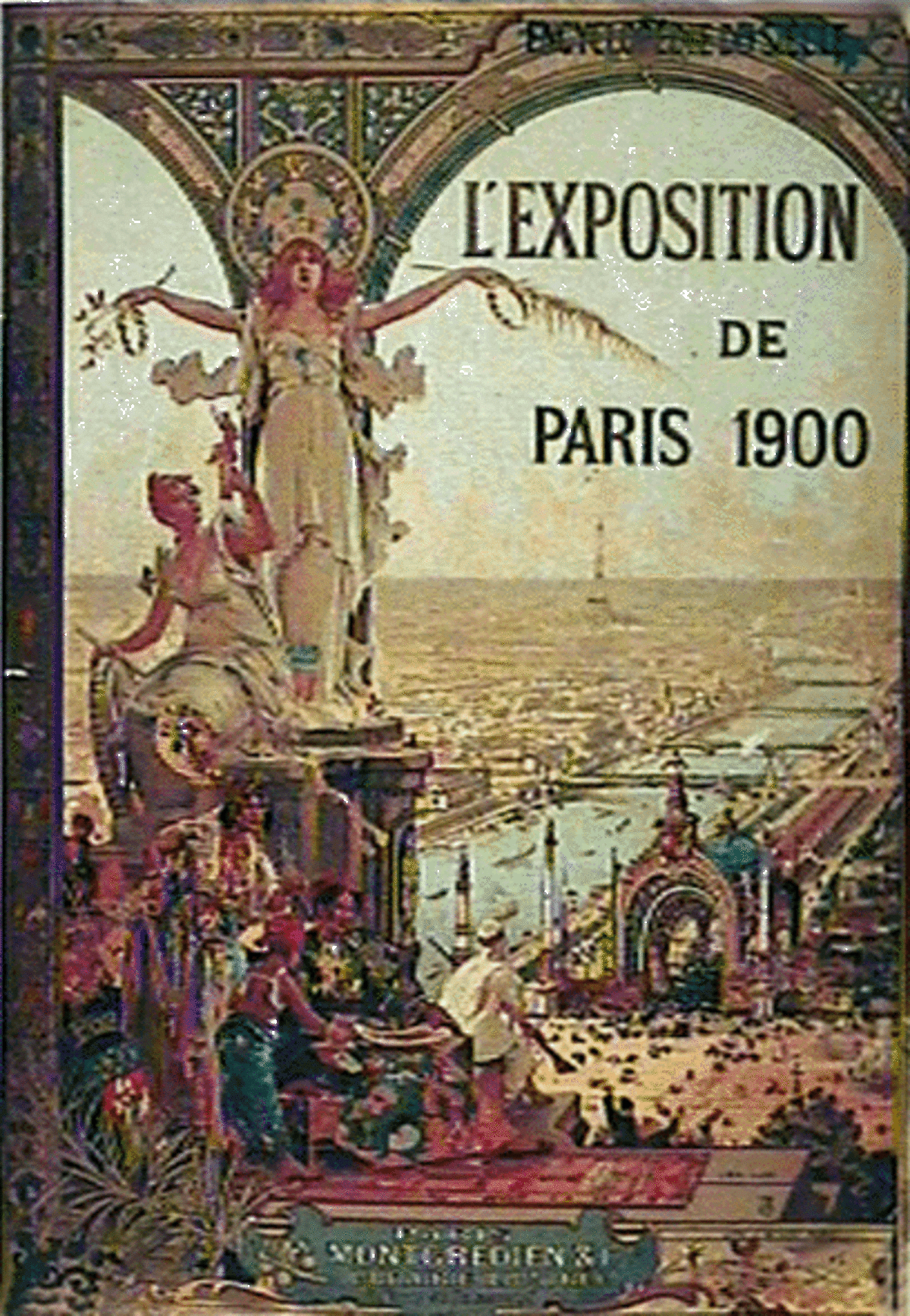
Affiches, photographies, peintures, costumes, meubles, bijoux, films... une profusion d’objets et de représentations nous permettent d’apprécier la diversité du Paris de la Belle Epoque. La capitale était alors placée sous le signe des arts et du renouveau, qui aussi politique et économique. Cet essor, qui suivait celui du pays, attire à lui le monde entier. Lieu de tentation et d’effervescence, on y court ses spectacles, ses fêtes et ses nuits fiévreuses.
L'exposition s'ouvre sur la manifestation la plus importante jamais organisée dans la capitale : le 14 avril 1900, l'Exposition Universelle place Paris au centre de toutes les attentions. Pendant plusieurs mois, la ville rayonne de plus belle et s'organise pour l'occasion : la gare des Invalides et la gare d'Orsay sont implantées au coeur de Paris. Le pont Alexandre III relie les Invalides au bas des Champs-Élysées où est édifié Le Grand et le Petit Palais, destinés à abriter une immense rétrospective de l'art français. Avec pour thème 'Le bilan du siècle', l'Exposition est un espace d'innovations qui célèbre les nouveaux usages, dont celui de l’électricité, et l'inauguration du Métropolitain. Cet événement sans égal, qui verra affluer 51 millions de visiteurs, est à la fois un lieu de divertissement, foisonnant d’attractions, et l’ illustration vivante (ou la mise en scène) du bouillonnement culturel qui règne alors dans la capitale.
Le second pavillon met lui en lumière les inventeurs de l'Art Nouveau tels que Majorelle, Lalique, Mucha... Ce mouvement, qui connaît à cette période son apogée, imprime une nouvelle esthétique qui rompt avec la tradition académique. Il affirme notamment comme principe l'unité de l'art. Les nouvelles stations du métro, imaginées par l'architecte Hector Guimard, en sont l'une des plus célèbres représentations parisiennes. De nombreux bijoux sont également exposés, ils s'inspirent de la nature et utilisent des matériaux jusqu'alors délaissés à l’image de la corne ou de l'émail. La troisième salle, dévolue aux Beaux-Arts, prolonge le voyage et la découverte artistique de Paris en exposant les œuvres d'incontournables comme Cézanne, Renoir, Monet ou encore Gauguin, dont l'influence se mesure dans la capitale à la montée de leur cote et l'organisation de rétrospectives. On y trouve également des photographies d'ateliers ou l'artiste se met en scène parmi une sélection de ses œuvres.
Dans la salle suivante, ces artistes célèbrent le mythe de la Parisienne. Costumes, peintures et
photographies consacrent cette citadine idéalisée qui, par son élégance et sa sobriété, se distingue et affirme la suprématie des modistes de la ville lumière sur le reste du monde.
Ambassadrices de l'élégance le jour, les parisiennes renvoient une autre image dès que pointe la nuit : elle deviennent alors tentatrices et corruptrices. Cet érotisme diffus, contribue au mythe de la Belle Époque qui se rêve comme une fête perpétuelle. Les Boulevards accueillent tous les soirs ballets, concerts et pièces de théâtre. Le visiteur découvre un Paris décadent où l'on fréquente les maisons closes, grisé par la morphine ou l'éther.
Les deux derniers pavillons offriront une plongé dans le Paris des divertissements. L'Opéra Garnier symbolise la 'haute culture' alors que les Folies-Bergère ou le Moulin-Rouge rivalisent de music-halls : numéros de cirque et de magie, ballets et opérettes se succèdent. La visite s’achève sur les premiers pas du cinéma, forme reine de la nouvelle culture au succès foudroyant.
L'exposition rappelle ainsi la force de ce foisonnement culturel qui, malgré son interruption brutale lorsque l'Europe plonge dans l'horreur de la Première Guerre Mondiale, perdure encore aujourd'hui.



