
Agrandissement : Illustration 1

Les massacres du 9 septembre 1792 à Lyon, le consensus « françafricain » et la "cas" ivorien, la résistance communiste en France, la segrégation scolaire, l'hôpital en réanimation... retrouvez nos critiques du mois coordonnées par Marine Roussillon.
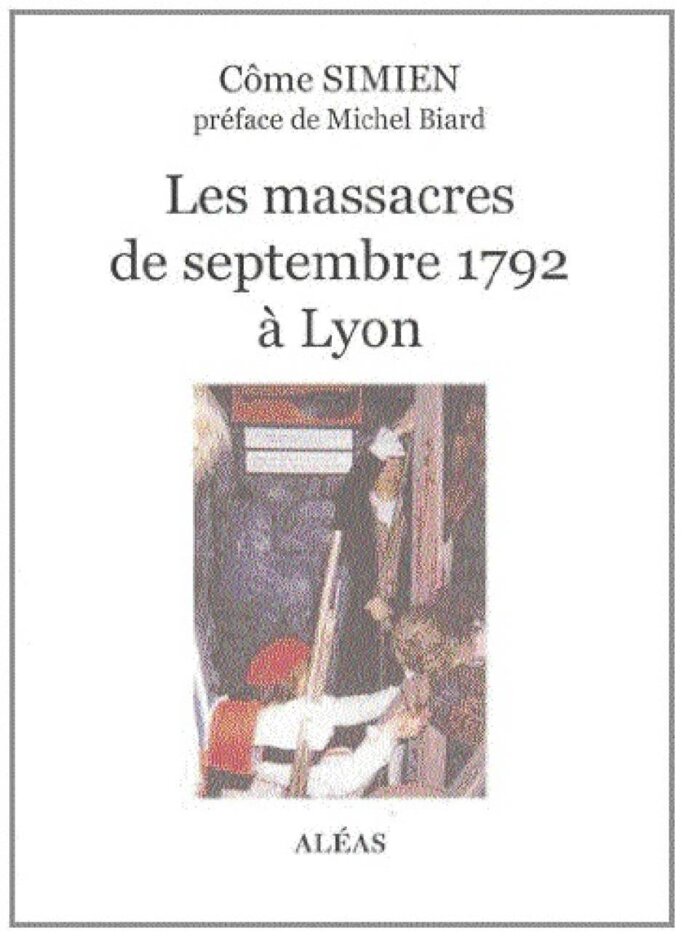
Agrandissement : Illustration 2

Dans cet ouvrage consacré aux massacres du 9 septembre 1792 à Lyon, Côme Simien, jeune historien, apporte un éclairage nouveau sur ces violences révolutionnaires, jusqu'à présent en partie délaissées par l'historiographie de la Révolution française ou instrumentalisées au service d'une écriture partisane de cette période. Après avoir reconstitué le plus précisément possible le déroulement de cette journée de violences révolutionnaires et l'identité des victimes, Côme Simien se lance dans une analyse rigoureuse et nuancée de la genèse de ces massacres. Il montre à quel point, à la veille de cette journée, une partie du peuple lyonnais est saisie d'une peur du complot contre-révolutionnaire, d'un sentiment de présence angoissante de l'ennemi de la Révolution, qui agirait tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville. À cette peur collective éminemment politique s'ajoute une mémoire de la violence légitime qui est au cœur de l'imaginaire du peuple lyonnais et contribue elle aussi à expliquer le passage à l'acte. L'avant-dernier chapitre de l'ouvrage est consacré en grande partie aux motivations de la foule massacrante. Elles sont elles aussi fondamentalement politiques. Ainsi, il s'agit, pour les acteurs du massacre, de se substituer à des autorités jugées défaillantes, incapables de protéger le peuple des ennemis de la Révolution. Dès lors, la violence est perçue comme légitime par ceux qui l'exercent et prend la forme d'une souveraineté populaire en acte. Pour finir, Côme Simien analyse précisément la manière dont cet événement devient le lieu d'une lutte mémorielle entre acteurs politiques, depuis ses lendemains immédiats jusqu'à la fin du XIXe siècle.
Jean-Baptiste Le Cam

Agrandissement : Illustration 3
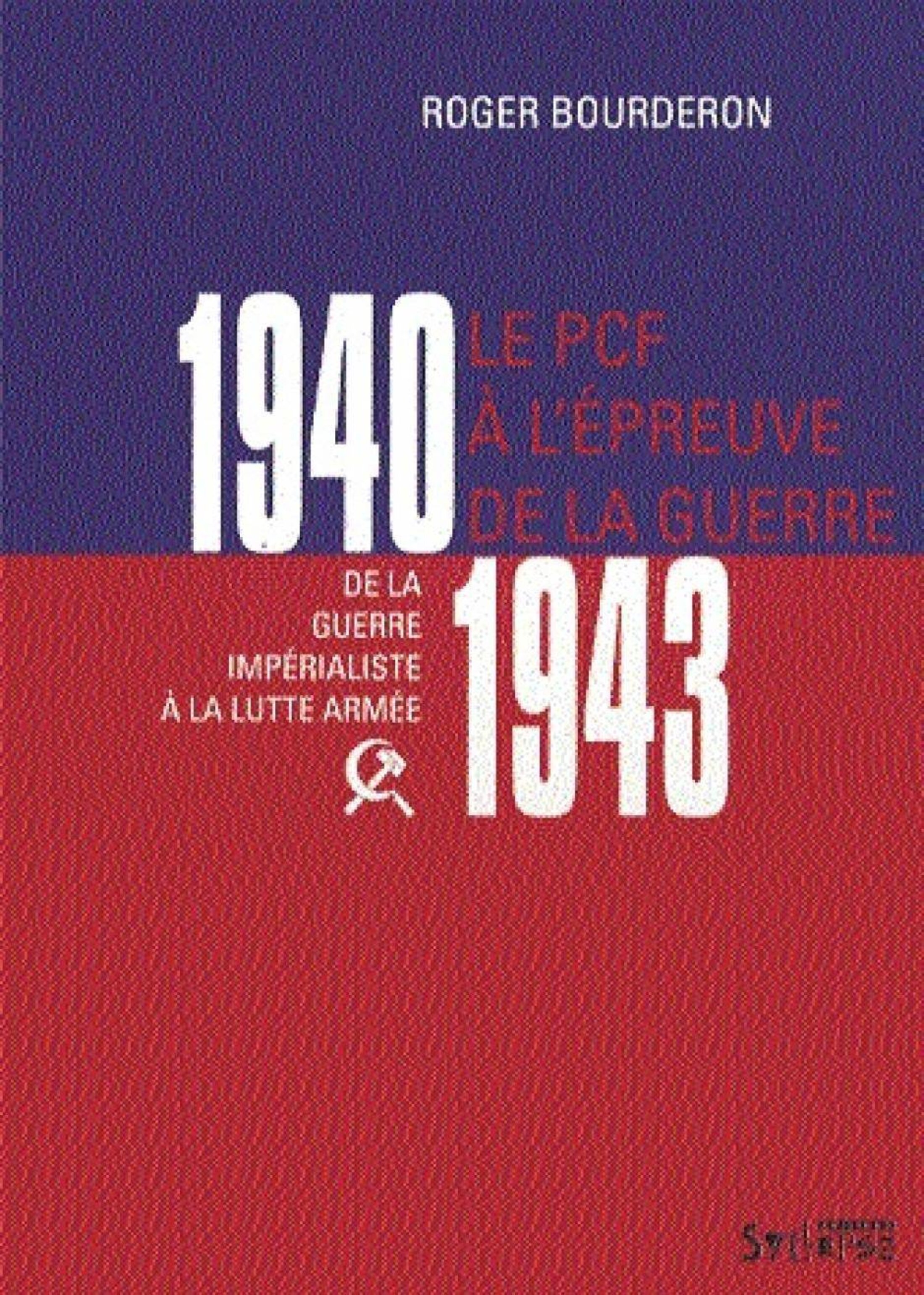
Cet ouvrage fait suite à plusieurs parutions : Les Télégrammes du Komintern dont les archives sont ouvertes, et un ouvrage de 2009 de Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre, L’affaire Guy Môquet. Enquête sur une mystification officielle, qui n’est qu’un condensé de négation de l’action des communistes en France dans la Résistance.
L’auteur s’emploie quant à lui, sources abondantes à l’appui, à étudier l’évolution des positions politiques de la direction du PCF entre la défaite de 1940 et 1943, année qui marque l’essor de l’action résistante avec la création du CNR (conseil national de la résistance).
Quatre thèmes sont abordés : l’attitude du PCF vis-à-vis de De Gaulle ; l’étude des appels du PCF de l’été 1940 (celui de Tillon, puis celui de Thorez-Duclos) ; l’évolution des positions politiques du PCF à travers ses publications (tract et l’Humanité notamment) ; enfin l’étude de l’organisation de la direction du mouvement FTP entre 1941 et 1943. Roger Bourderon expose le double mouvement que connaissent les deux grands thèmes du PCF dans les premières années de la guerre : la volonté d’indépendance nationale et l’analyse de guerre impérialiste entre les capitalistes allemands et britanniques dans laquelle les communistes n’ont pas à prendre parti. On constate donc la montée en puissance de la première idée au fil des années avec la création très tôt des comités populaires (dès 1940) pour lutter contre les conséquences de l’occupation, pour organiser la solidarité. Et dans le même temps, l’analyse de la guerre impérialiste perd de l’importance car elle mène à une impasse stratégique. Ce travail historique solide est une réelle avancée dans l’analyse de l’action du Parti communiste dans les premières années de la guerre et doit permettre de mettre fin au discours de l’idéologie dominante qui voudrait que les communistes ne soient entrés en résistance qu’à l’été 1941 avec l’invasion de l’URSS.
Éloi Simon
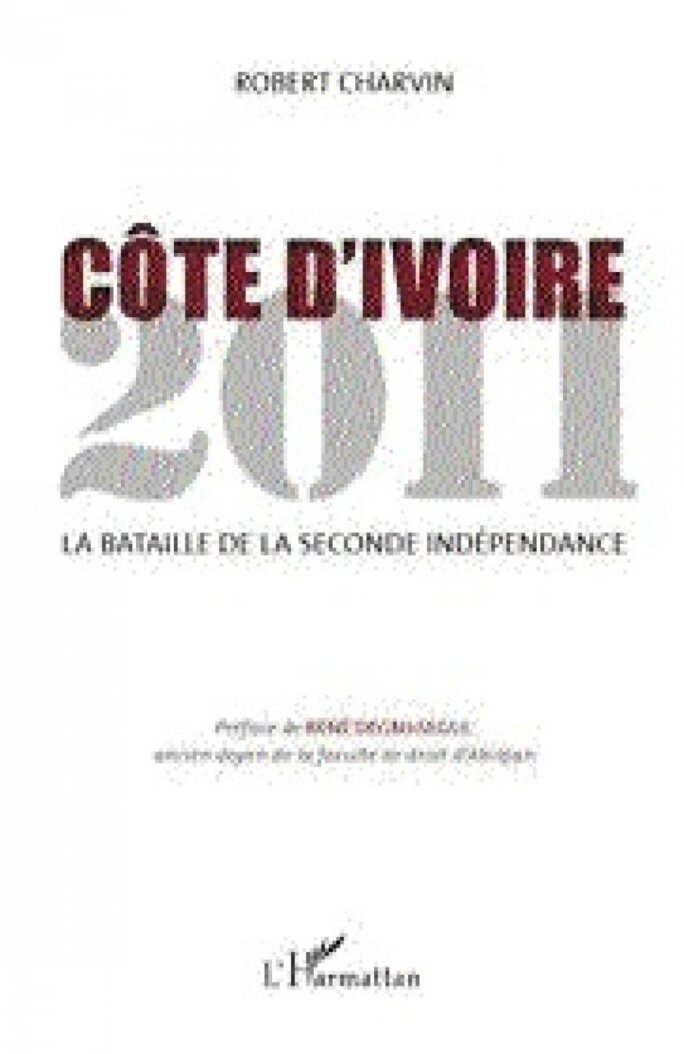
Agrandissement : Illustration 4
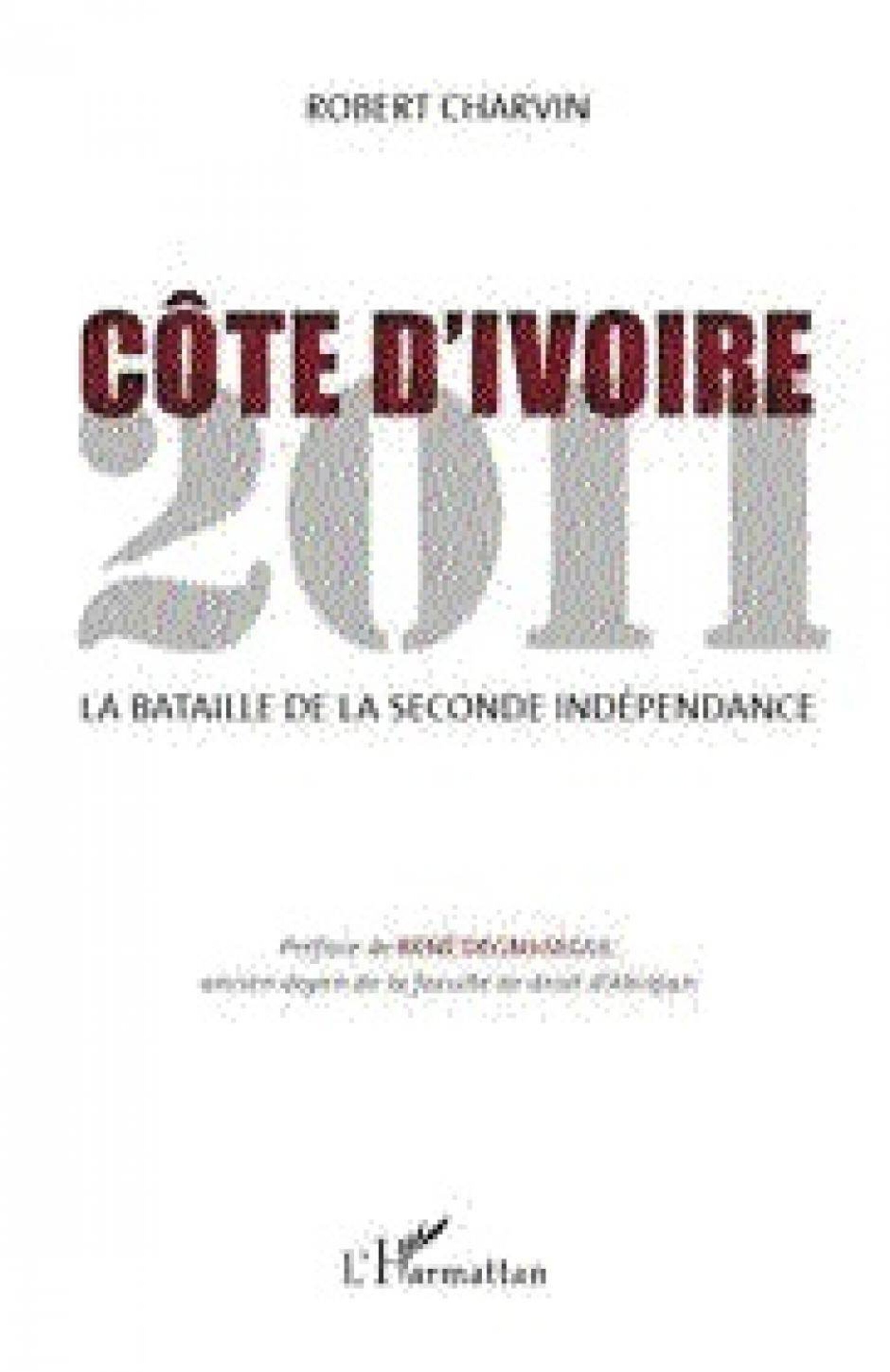
En général, on discute peu de la situation des pays africains. Et quand une crise surgit, il est bien difficile de déceler les faibles voix qui s’élèvent contre le consensus « françafricain ». Rien que pour cela, le livre de ce professeur de droit progressiste est salutaire.
Il analyse la crise ivoirienne et le processus qui a conduit de la tentative de coup d’État à la crise électorale de 2011 et finalement à l’éviction de Laurent Gbagbo de la présidence le 11 avril 2011. Il montre que les forces occidentales en général, la France en particulier, ont usé de toutes les armes – médiatiques, économiques, politiques et militaires – pour imposer leur candidat, Alasane Ouatarra. Les exactions commises par les forces rebelles dans le nord du pays ont toujours été tues alors que les violences du camp présidentiel ont été mises en exergue pour faire du président la figure même du dictateur sanguinaire. Les média français ont participé à l’opération en mettant sur le même plan les plus vagues rumeurs et les informations vérifiées, les victimes civiles et les pertes des groupes armées et en taisant le rôle qu’ont pu jouer directement les soldats français dans la répression des manifestations populaires à Abidjan.
L’auteur discute tout particulièrement la proclamation des résultats des élections de décembre 2010. S’appuyant sur la Constitution ivoirienne et sur les accords qui liaient les différentes parties en présence, il démontre que cette élection a été illégale. Ainsi, l’implication directe de l’armée française pour asseoir Ouattara sur le siège présidentiel est bien un coup d’État, même si il est légitimé par le conseil de sécurité. Cette analyse est l’occasion d’une réflexion sur la démocratie dans les pays de la sphère de domination capitaliste. L’auteur montre comment, alors que les droits les plus basiques sont refusés aux populations africaines, l’élection du président au suffrage universel direct est présentée comme l’aboutissement le plus complet de la démocratie… à condition que les résultats des scrutins ne remettent pas en question les intérêts particuliers du capitalisme.
Très convaincant dans le domaine du droit international et des relations internationales, l’auteur l’est un peu moins quand il traite, rapidement, des racines de la crise ivoirienne. Le traitement de l’épineuse question de la nationalité ivoirienne dans un pays qui s’est construit sur l’immigration massive en provenance des pays voisins semble simpliste. Ne reprend-il pas trop à son compte la propagande de Gbagbo sur la question des « étrangers » ?
Augustin Pallière
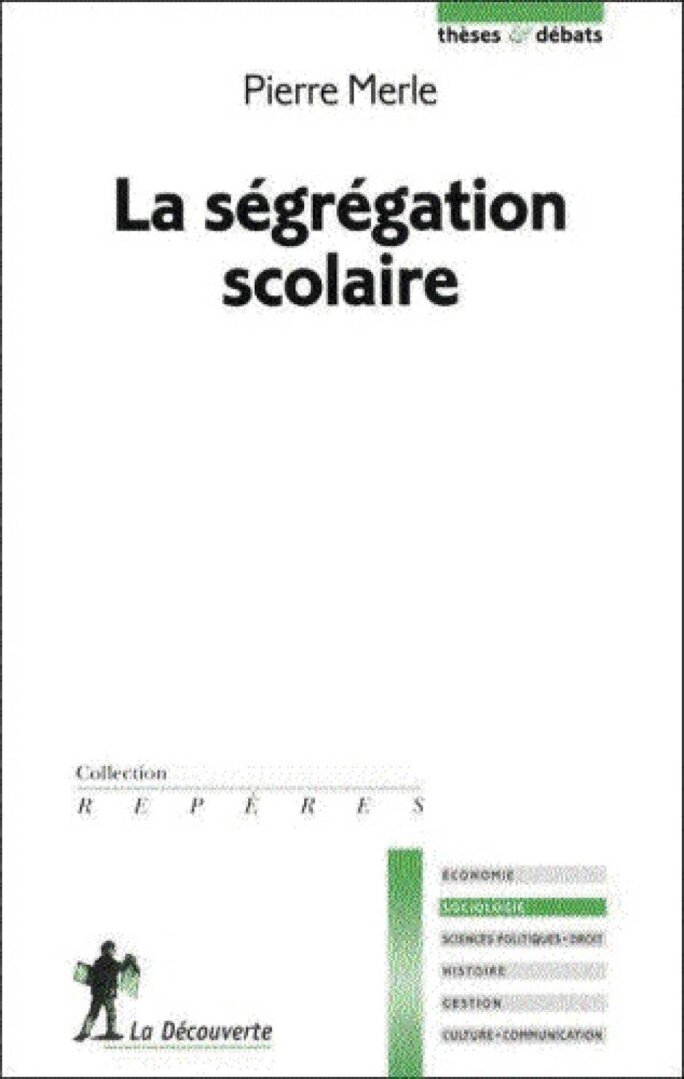
Agrandissement : Illustration 5
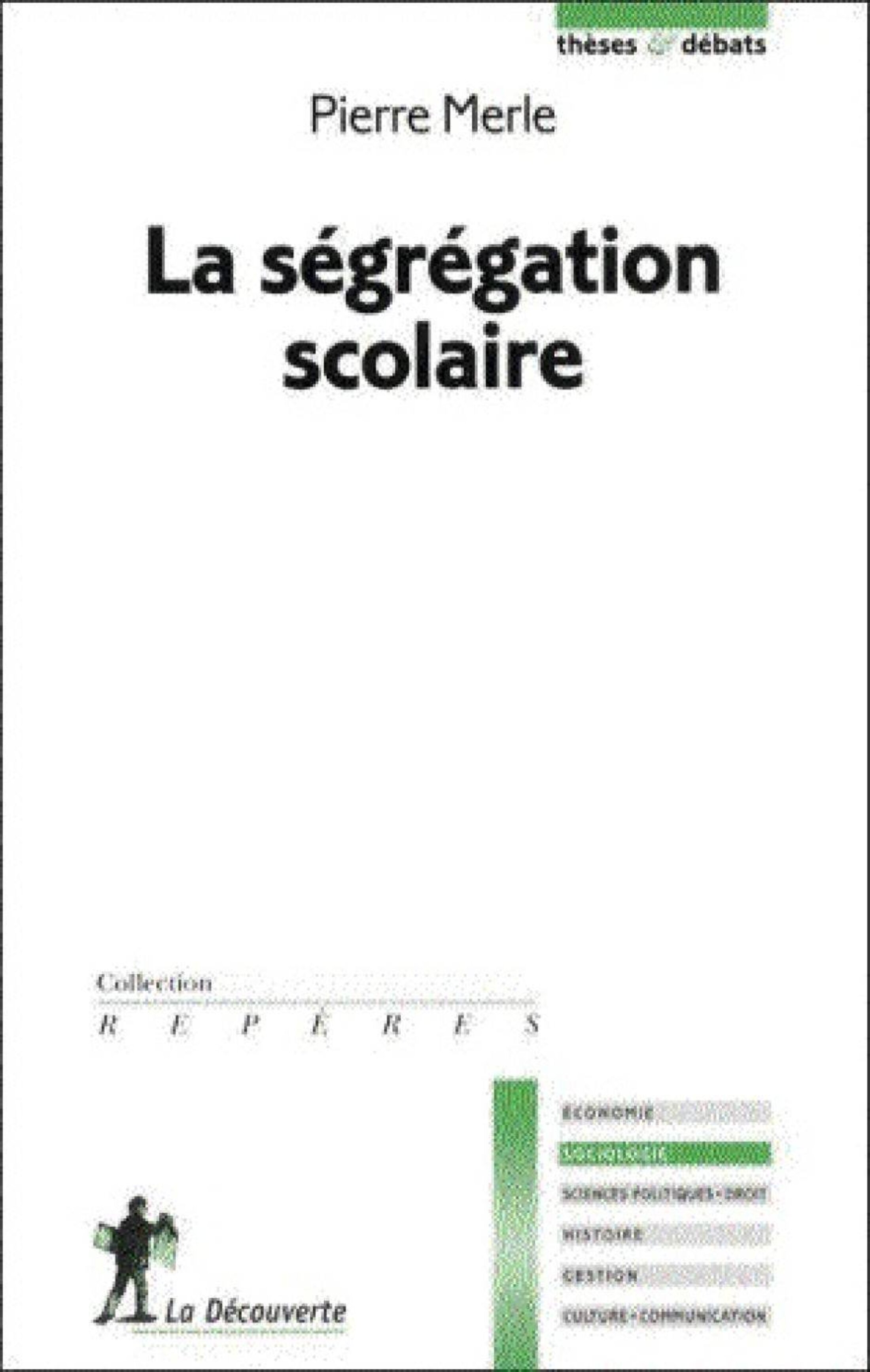
Dès avant son élection, le nouveau président de la République avait annoncé son intention de faire de l’éducation l’une de ses priorités. Une manière de répondre au constat partagé de la « crise » de l’école dans notre pays. Mais le consensus s’arrête là, car chacun y va ensuite de son explication. De tous les facteurs avancés, il en est pourtant un que l’on entend peu souvent invoqué : la forte ségrégation qui caractérise le système scolaire hexagonal. Et pourtant, celle-ci exerce bel et bien un effet négatif non seulement sur les inégalités d’apprentissage, mais aussi sur les résultats de l’ensemble des élèves, comme le montre cet ouvrage, en s’appuyant notamment sur les fameuses enquêtes PISA de l’OCDE – le « club des pays riches », peu soupçonnables de complaisances avec la gauche. Comme dans d’autres domaines, les séparations entre élèves d’origines sociales ou de genres différentes se sont ainsi largement maintenues malgré la perte de leur caractère officiel, et jouent à plusieurs niveaux : filières ou échelles géographiques, jusqu’au sein même des établissements.
Pierre Merle pointe aussi le rôle majeur des établissements privés dont le caractère de « refuge » d’enfants des classes favorisées va en s’amplifiant, tout en s’employant à démonter la fausse solution de la « discrimination positive » initiée par les conventions ZEP il y a déjà 30 ans. Car non seulement elle contribue surtout à stigmatiser les établissements concernés, mais quand on prend en compte l’ensemble des moyens alloués à ces derniers, on constate qu’ils restent en réalité bien inférieurs à ceux des centres-villes, dotés d’enseignants plus anciens et qualifiés, et donc mieux rémunérés. Enfin, menées au nom du « libre choix », les politiques d’assouplissement de la carte scolaire initiées par le socialiste Alain Savary, faute d’avoir pu unifier le service public, ont elles aussi un effet ségrégatif problématique.
Un petit ouvrage de synthèse à verser d’urgence au débat sur l’école pour permettre d’en faire évoluer les lignes, car à côté de la question des moyens, celle de leur répartition – et de celle des élèves – est tout aussi cruciale.
Igor Martinache
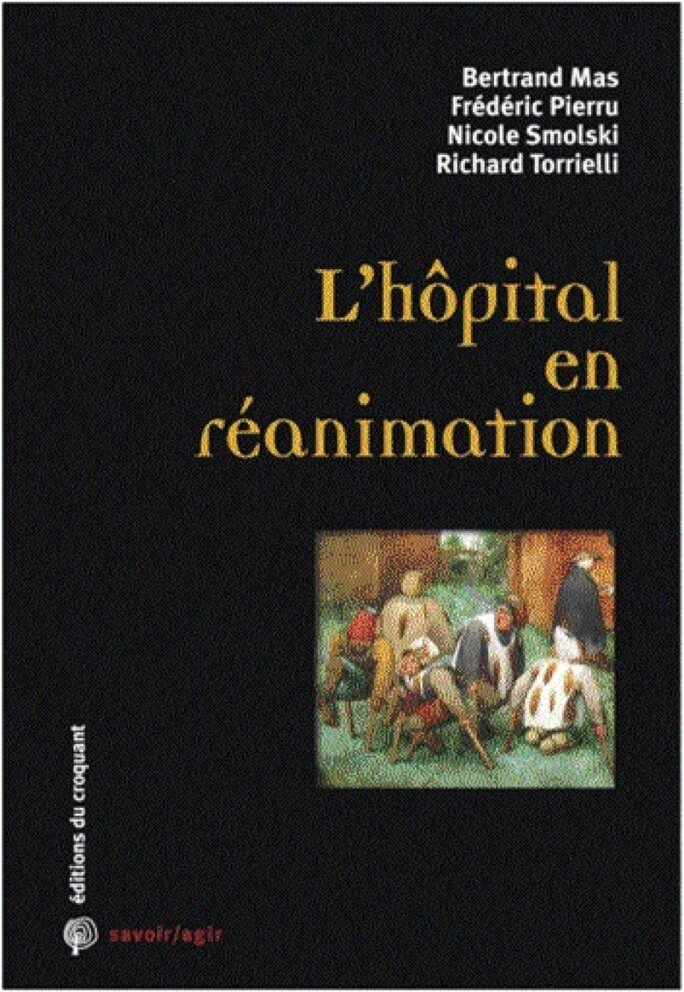
Agrandissement : Illustration 6
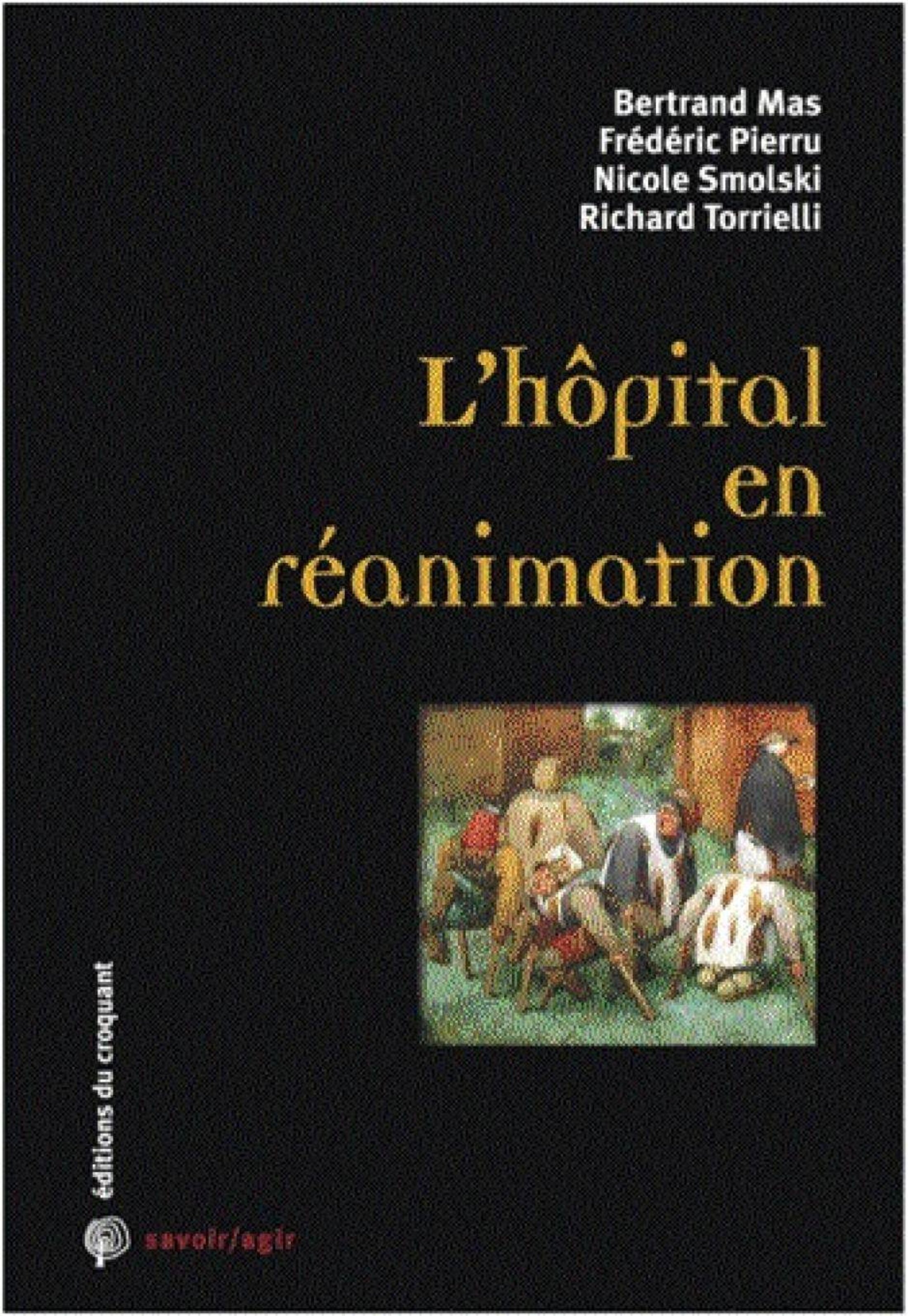
Ce n’est pas le moindre des paradoxes de notre époque : le système de santé, et notamment l’hôpital public, est malade et sa situation ne semble guère s’arranger. On en connaît les symptômes – franchises médicales, déremboursements, pénurie de soignants, etc. –, qui compromettent toujours davantage l’accès aux soins pour tous, mais le diagnostic s’arrête trop souvent à ce stade. D’où l’intérêt d’un ouvrage comme celui-ci, issu d’un colloque organisé par le Syndicat national des praticiens hospitalier anesthésistes-réanimateurs élargi (SNPHAR-E).
Les 27 contributions qui le composent émanent de médecins, mais aussi de sociologues, économistes et politistes, qui décortiquent le virus qui ronge aujourd’hui l’organisation de la santé publique. Celui-ci a un nom, la marchandisation rampante, et a été inoculé par une nébuleuse d’agents bien identifiables – patrons d’assurance et de cliniques privées, hauts fonctionnaires et décideurs politiques – qui sont parvenus à réduire les enjeux de santé à une simple question d’efficacité comptable, dont la définition est elle-même largement biaisée. Les auteurs mettent ainsi à jour les soubassements des dernières « réformes » qui ont affecté l’organisation hospitalière, du plan « Hôpital 2007 » à la récente loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » (HPST), dissimulés sous une novlangue qui prolifère là aussi avec vigueur, qu’il s’agisse des Agences régionales de santé, de la tarification à l’activité ou des groupes homogènes de maladie. Un démontage clair et sans détours qui n’en reste pas moins rigoureux.
L’ouvrage vaut aussi au-delà du sujet dont il traite pour sa trop rare capacité à réunir acteurs et chercheurs, qui plus est de différentes disciplines, ainsi que pour la présentation à la fois fine et pédagogique qu’il fait des principes du New Public Management, c’est-à-dire cette pénétration croissante des logiques gestionnaires du privé lucratif dans l’ensemble des administrations et services publics, sous couvert de la fausse neutralité d’instruments qui seraient purement « techniques ». Bref, qui dénient la dimension politique de choix qui se présentent sous le masque de la nécessité.
Igor Martinache
La Revue du projet, n° 18, juin 2012
Critiques coordonnées par Marine Rousillon.



