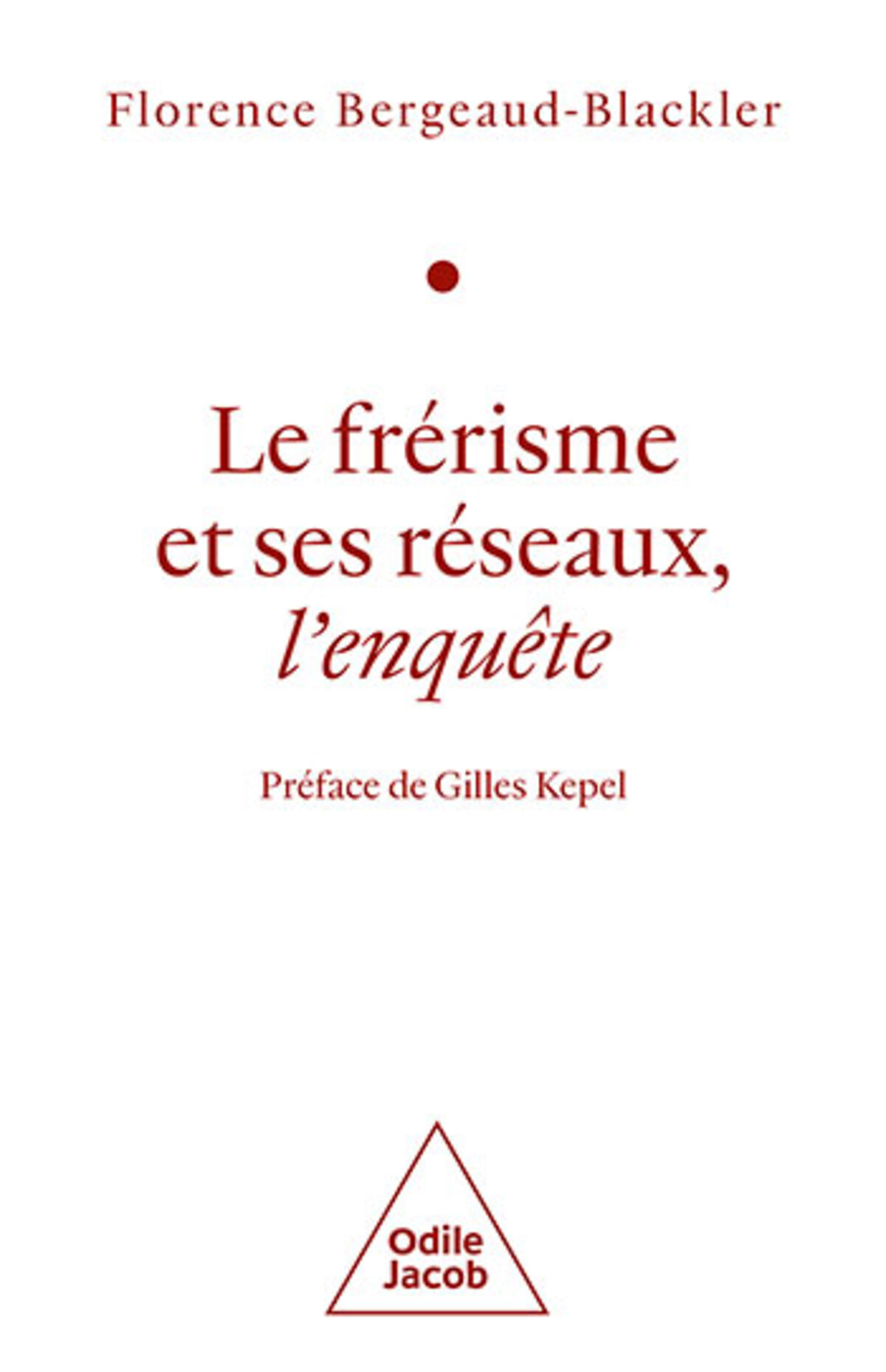
« Le frérisme et ses réseaux, l’enquête » doit être lu pour deux raisons. D’abord en guise de protestation et de soutien face aux menaces de mort subies par l’auteure, Florence Bergeaud-Blackler. La condamnation de ces menaces ne peut être que totale. Le recours à une protection policière indique combien elles doivent être prises au sérieux. L’assassinat de Samuel Paty par un islamiste le 16 octobre 2020, et de centaines d’autres personnes, est dans toutes les mémoires. On imagine ce que doit être la vie quotidienne d’une personne dans cette situation. Salman Rushdie a relaté la sienne dans son livre « Joseph Anton » (Folio). Au-delà de l’affirmation catégorique de la nécessité de protéger l’intégrité physique et morale des personnes, ce sont la recherche académique comme le débat public qui sont remis en cause.
« Le frérisme et ses réseaux, l’enquête » doit également être lu pour son contenu. Florence Bergeaud-Blackler est anthropologue. Elle est chargée de recherche au CNRS (HDR) au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités de l'EPHE. https://www.gsrl-cnrs.fr/ Elle est notamment spécialiste du halal. Sur ce sujet elle a dirigé « Les sens du halal, une norme dans un marché mondial » (Editions CNRS 2015) et écrit « Le marché halal ou l’invention d’une tradition » (Le Seuil 2017). Elle a démontré comment le rituel d’abattage s’est mué en marché mondial intégrant aussi bien l’alimentation que la mode ou le tourisme : la « rencontre improbable entre le fondamentalisme islamique et le néolibéralisme ». Florence Bergeaud-Blackler s’inscrit dans une école d’islamologie qui s’est développée autour des travaux de Gilles Kepel et qui illustrée aujourd’hui par Bernard Rougier et Hugo Micheron.
« Le frérisme et ses réseaux, l’enquête » se présente comme un vaste panorama de l’évolution des Frères musulmans, allant de leur création en Egypte en 1928 par Hassan el-Banna à leur déploiement international actuel. Le principal intérêt de cette enquête réside dans l’ampleur des faits, événements, acteurs, écrits… inventoriés. On pointera ici la capacité d’adaptation stratégique de la confrérie, le rôle déterminant de Yûsuf al-Qarâdâwi, les structures de « l’euro-islam », les théorisations concoctées notamment par Tariq Ramadan, les tentatives de victimisation et de réduction des critiques de la religion à une « islamophobie » (terme qui fait débat), la présence notable dans les institutions européennes, l’intervention des Etats-Unis dans les banlieues, les relations complexes avec le mouvement décolonial, le rôle des femmes… L’auteur décrit un système qui se caractériserait par une vision, une identité et même un plan.
Si les menaces de mort reçues par Florence Bergeaud-Blackler ont suscité, à juste titre, beaucoup de commentaires, il n’y a encore que peu de retours sur le fond de son ouvrage. Un entretien étoffé est paru dans la revue « Conflits ». L’avocat et essayiste Rafik Chekkat écrit « Au fil de la lecture de Le frérisme et ses réseaux, la référence au pamphlet antisémite d’Édouard Drumont, La France juive (1885), dont sont extraites ces lignes, s’imposent de manière troublante » dans un article lui-même complotiste. Ce texte médiocre est incongru dans un site comme celui de OrientXXI où on trouve beaucoup d’informations inédites. En revanche le témoignage critique de Omero Marongiu-Perria, souvent cité par Florence Bergeaud-Blackler, est à lire, même s’il est publié dans l’édition du très contesté François Burgat.
On notera au passage la mention de la Ligue de l’enseignement et de la Commission islam et laïcité (page 215), qui est correcte, même si nombre d’actions et de prises de positions ultérieures auraient mérités d’être évoqués. Par ailleurs le lecteur sera étonné par une affirmation : « Si à la lecture de ces lignes votre réflexion est de chercher d’autres exemples comparables en dehors de l’islam (chez les juifs, les chrétiens, du Moyen-Age ou de Syrie, etc.) pour vous rassurer que ces caractéristiques existent ailleurs et que ce n’est pas si grave, il se peut que vous partagiez vos aussi un peu de cet espace mental frériste… ». Or toutes les religions, ou plutôt les complexes politico-ethnico-religieux, sont à analyser de la même façon. Et cela même s’il serait faux de mettre un signe d’équivalence entre ces divers groupes humains dont l’histoire, la composition, l’évolution, les méthodes et les stratégies, l’impact politique et culturel sont différents.
Le travail de Florence Bergeaud-Blackler ne peut pas être ignoré. Il ne s’agit pas de se laisser entraîner dans un jugement préconçu. Deux questions se posent. La première question concerne en particulier les spécialistes. Quelle est l’ampleur effective de l’activisme des Frères musulmans en Europe ? Florence Bergeaud-Blackler évoque leurs difficultés à transmettre leur doctrine et à enrégimenter directement les jeunes musulmans. L’Union des organisations islamiques en France (UOIF) (devenu Musulmans de France) est solide mais ne rassemblerait qu’un millier de membres en 2010. D’autres organisations musulmanes les concurrencent…
La deuxième question est à la fois théorique et politique. Que faut-il penser de la notion de « frérisme d’atmosphère » ? Elle est présentée dans la préface de Gilles Kepel et reprise dans l’ouvrage. Ce frérisme se caractériserai moins par une adhésion directe à la confrérie que par la reprise informelle de sa vision, de son identité voire de son plan d’action. Cette influence existe certainement, comme celle générée par tout groupe idéologique. Une notion aussi floue est pourtant susceptible d’être politiquement instrumentalisée, notamment en usant de certaines dispositions de la loi de 2021 confortant le respect des principes de la République. Leur application à des groupes ou à des personnes suspectées d’être contaminée par le « frérisme d’atmosphère » n’est pas inimaginable…



