
Dans un domaine devenu crucial pour notre avenir collectif, où se côtoient l’engagement aux côtés des plus faibles et les risques d’instrumentalisation politique, la sincérité et les affirmations péremptoires, les nouveaux regards et les tentatives de culpabilisation, un décryptage rationaliste est plus que jamais nécessaire. Tel est l'objectif de Alain Policar dans son dernier livre "L’universalisme en procès".
Le premier des trois chapitres de ce nouveau livre s’intitule « L’universalisme dévoyé ». Le même titre qu’un article marquant publié par Alain Policar dans un numéro de « Raison présente » consacré aux « Questions de société en débat » (N° 211, septembre 2019). Le contenu est différent, mais le thème est le même : la confrontation entre les thèses décolonialistes et les thèses nationales-républicaines. Comment refuser de se retrouver piégé dans cette confrontation ? La notion d’intégration est particulièrement scrutée. S’agit-il d’une injonction oblique à une assimilation peu soucieuse de la richesse culturelle présente dans notre pays ?
Le deuxième chapitre, « L’universalisme contesté », approfondit la notion de « Race ». Celle-ci a resurgi dans la confrontation évoquée ci-dessus. Elle est certes reprise des travaux de Colette Guillaumin, « L’idéologie raciste », qui y voyait une perception sociale et non une réalité biologique. Mais son usage incontrôlable s’avère dangereux. Alain Policar pose clairement le problème. Evoquant le célèbre article écrit en 1998 par Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant « Sur les ruses de la raison impérialiste », il écrit : « La crainte alors exprimée reste présente ; ne risque-t-on pas de biologiser le social en introduisant une catégorie aux contours fortement incertains ? Mais, à l’opposé, faut-il être aveugle à la dimension racialisée des inégalités sociales ? ».
Alain Policar commente longuement les thèses décoloniales. Avec son honnêteté intellectuelle de chercheur, bien sûr, mais peut-être aussi avec une plus grande empathie que dans ses ouvrages antérieurs. Un aspect de ces thèses est diffusé assez largement. Constatant les discriminations ethno-raciales persistant aux USA, l’universitaire Peggy MacIntosh crée en 1988 la notion de « privilège blanc ». Elle est présentée comme une vérité première, notamment sur Wikipedia. Mais peut-on qualifier de « privilège » le fait que les droits des personnes cataloguées comme blanches soient respectés ? N’y a-t-il pas là, en filigrane, l’idée d’une culpabilité collective et héréditaire des « Blancs », source de ce « privilège » ? Cette pseudo culpabilité étant largement affirmée sur les réseaux sociaux. Alain Policar est catégorique : « La culpabilité collective des Blancs n’est pas une thèse acceptable ». Mais il tolère la notion de « responsabilité » qui peut pourtant être interprétée comme un simple euphémisme. Un point de discussion intéressant.

Agrandissement : Illustration 2

Le troisième chapitre est intitulé « L’universalisme reconsidéré ». Et il porte bien son titre. C’est en effet à un examen de fond de cette notion qu’Alain Policar nous invite et nous accompagne. Pour penser un monde commun, il nous propose de réhabiliter la notion de cosmopolitisme. Souvent considéré comme daté, voire affligé d’une connotation péjorative, le cosmopolitisme est rarement convoqué aujourd’hui pour construire un destin commun. Alain Policar se réfère pour sa part à une acception renouvelée par des essayistes aussi différents que l’allemand Ulrich Beck et le ghanéen Kwame Anthony Appiah. Il s’agit du « cosmopolitisme enraciné ». Autrement dit, précise Alain Policar « une identité cosmopolite consciente de ses préférences locales ». Mariant ainsi ouverture au monde et affirmation de soi, cette expression semble convaincante.
Cet ouvrage prend sa place dans une réflexion inscrite dans la durée. Il faut au moins mentionner deux ouvrages antérieurs de l’auteur « Comment peut-on être cosmopolite ? » et « L’inquiétante familiarité de la race », tous deux également publiés aux Editions Le Bord de l’eau en 2018 et en 2020. Ces trois ouvrages constituent une indispensable ressource intellectuelle, riche en auteurs mentionnés, rigoureuse dans ses analyses, pour quiconque souhaite réfléchir à ces questions. Alain Policar a notamment consacré une tribune sur l’instrumentalisation, par le pouvoir politique et le ministre de l’ éducation nationale en particulier, des débats universitaires. Et deux textes sur AOC, sur la laïcité « travestie » et sur l’islamo-gauchisme Il faut enfin rappeler les contributions nombreuses et étoffées d’Alain Policar au « Dictionnaire historique et critique du racisme » (PUF ? 2013). Du grain à moudre…
L’universalisme en procès, de Alain Policar Editions Le Bord de l’eau 2022 168 pages 16 €
Une autre édition de la Ligue de l'enseignement sur Médiapart:
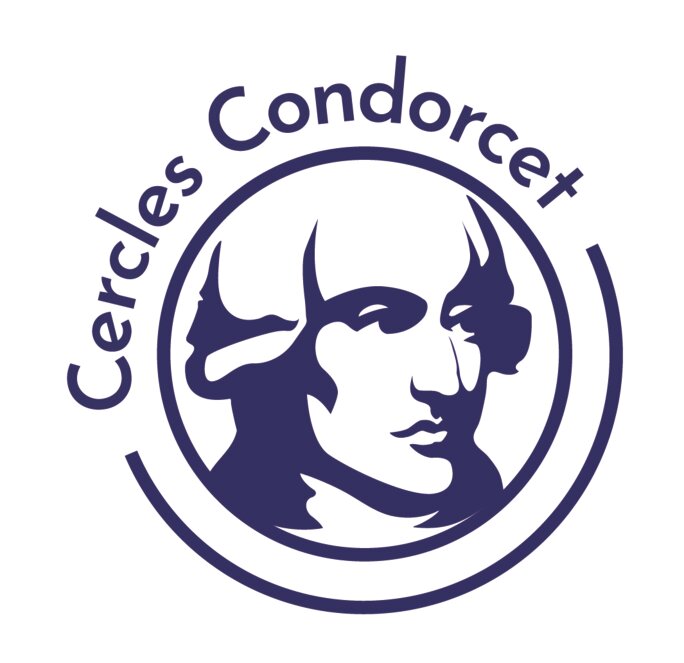
Agrandissement : Illustration 3
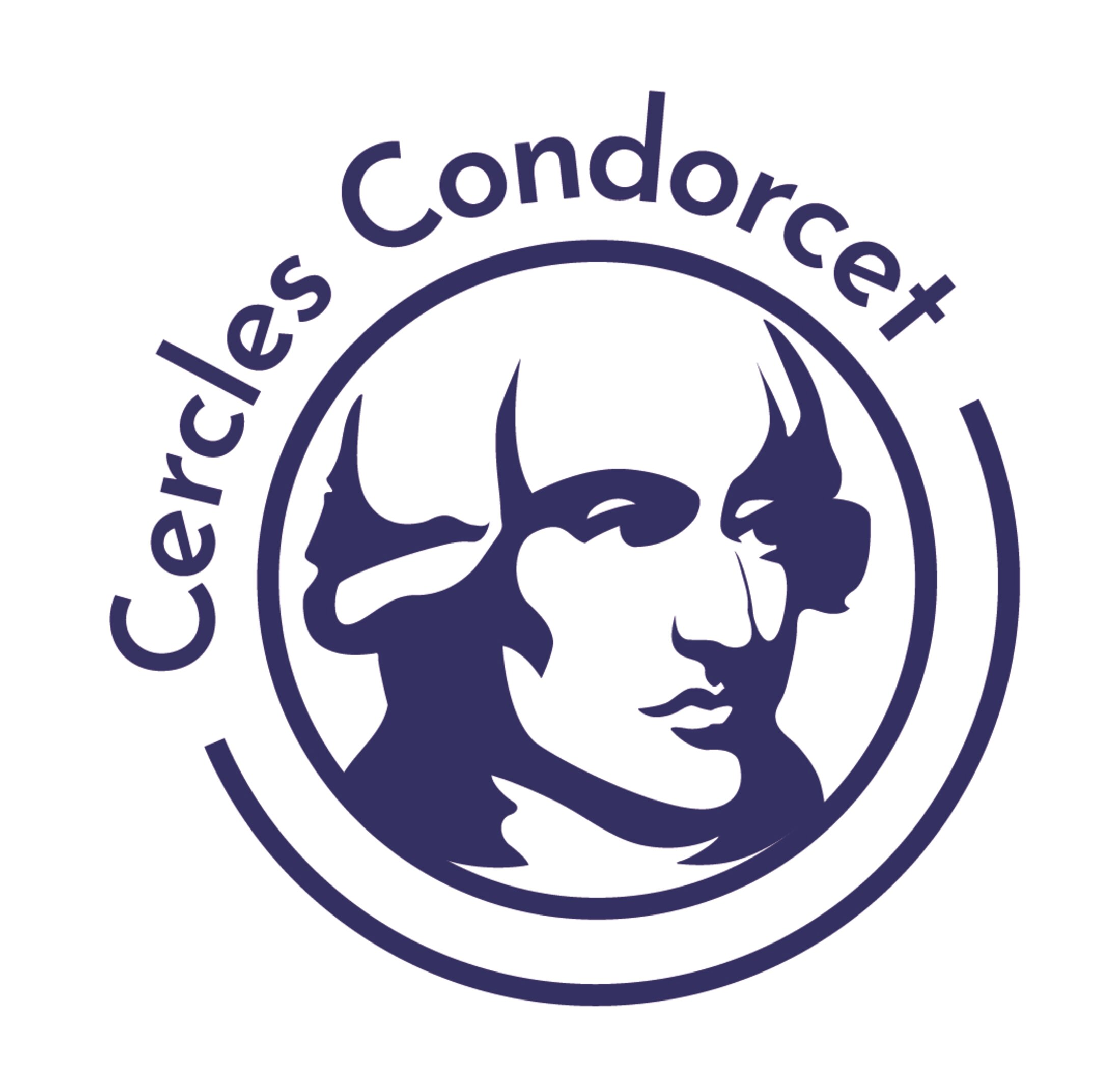
Les Cercles Condorcet accompagnent la vie intellectuelle et militante des fédérations départementales de la Ligue de l'enseignement, grand mouvement d'éducation populaire laïque. Une cinquante de Cercles rassemblent environ 2.000 personnes.
Ils animent une édition sur Médiapart Ne manquez pas de la consulter !



