Tout au long de son histoire la Ligue de l'enseignement, mouvement d'éducation populaire laïque, s'est investie, sous de nombreuses formes, dans la diversité culturelle. Nous l'avons rappellé dans un billet "La Ligue de l'enseignement, la laïcité et la diversité". En 2015, la Ligue , qui va fêter son 150° anniversaire l'année suivante, revient sur son investissement dans les cultures populaires. Elle y consacre deux journées, les 6 et 7 juillet sous le titre "
La Ligue de l'enseignement et la pluralité culturelle. Du folklore à la diversité". La thématique était ainsi présentée: depuis ses origines, porteuse de la culture républicaine, la Ligue est attentive aux cultures populaires. Sous le Front populaire cet intérêt s’est formalisé avec la création d’une Commission Folklore, devenue ensuite commission des Arts et traditions populaires. Présidée par Paul Delarue, puis par Pierre-Jakez Hélias, elle a nourri les travaux ultérieurs du secteur culture. Son objet s’est recentré dans les années 70-80, avec Guy Gauthier, sur les langues régionales et minoritaires. Ce travail a contribué à enrichir une réflexion plus large sur la laïcité et la citoyenneté. Il a servi de passerelle vers la prise en compte des cultures immigrées et de l’islam dans la société du XXe siècle. De multiples initiatives, associations, publications et festivals font aujourd’hui vivre cette pluralité culturelle au sein et autour de la Ligue. Comment pouvons-nous les valoriser et les faire connaître ?
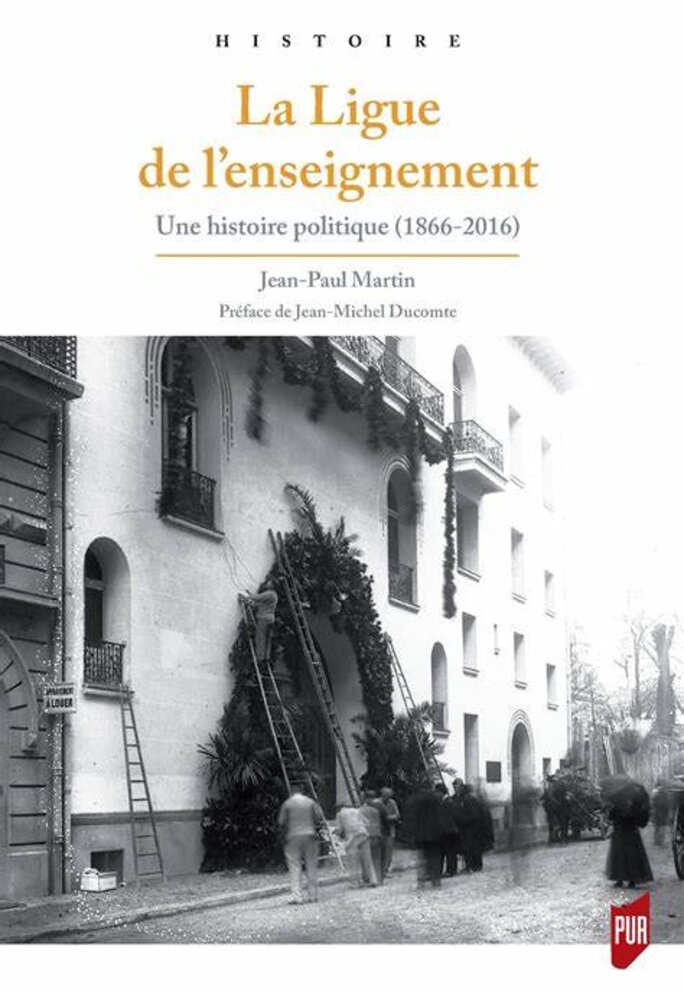
Agrandissement : Illustration 2
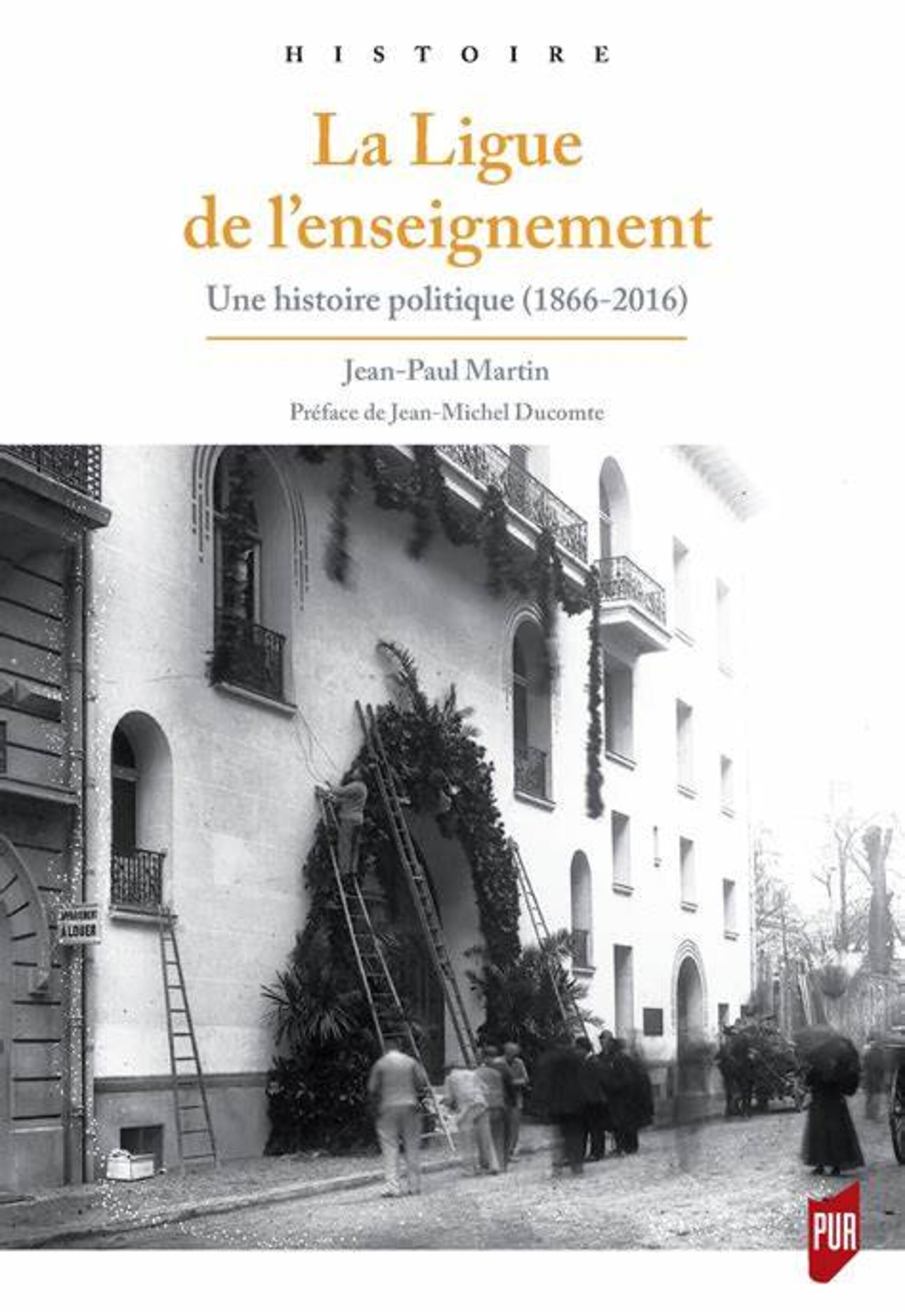
Jean-Paul Martin, auteur de "La Ligue de l'enseignement. Une histoire politique 1866-2015", introduit ces deux journées d'échanges et de réflexions avec une étude approfondie intitulée "La Ligue de l'enseignement et la diversité culturelle: une mise en perspective historique". La voici dans intégralité.
Cette présentation procédera à grands traits. Il sera surtout question d’une histoire récente, voire d’une histoire immédiate. Cependant, en histoire, la question du point de départ n’est jamais simple. Ainsi, lors d’un congrès de la Ligue à Toulouse, en novembre 1899, un militant occitan, A. Sourreil, demandait que l’on procède « pour l’enseignement du français comme on procède généralement en matière d’enseignement des langues étrangères, c’est à dire en utilisant comme intermédiaire, la langue ordinaire de l’élève, en l’occurrence la langue d’oc ». Les vœux qui suivaient cette prise de position portaient sur
«- l’admission des chants languedociens parmi ceux que l’on fait exécuter dans les écoles primaires ;
- l’admission des ouvrages écrits en langue d’Oc parmi ceux des bibliothèques des écoles ou des sections de la Ligue ;
- l’extension de l’enseignement de l’histoire locale ou régionale afin de réagir contre cette malheureuse tendance qui consiste à réduire les faits glorieux de l’histoire de notre pays à ceux concernant l’Ile-de-France, ou les princes de la maison de France » (1).
On peut considérer qu’il s’agit là d’une première rencontre de la Ligue avec la pluralité culturelle. A moins que ce ne soit pas la première d’ailleurs… si l’on songe que dès sa naissance des cercles ont été fondés en Algérie, et que Jean Macé se montrait particulièrement soucieux d’y faire une place aux Arabes, une intention qui ne fut guère reprise après 1870..
Mais sans remonter aussi haut, je distinguerai pour des périodes plus récentes, et à partir d’une relecture en diagonale de la presse du mouvement, quatre moments successifs où, me semble-t-il, la Ligue de l’enseignement a « rencontré » le thème de la diversité culturelle. Il y a naturellement des chevauchements entre ces moments, et aussi une prise en compte de plus en plus large. Ce sont : le moment du folklore (des années 1930 aux années 1960), le moment des langues et des cultures régionales (des années 1960 au milieu des années 1980), le moment d’une ouverture à toutes les formes de pluri-culturalisme (des années 1980 à la fin du siècle) ; un quatrième moment dans lequel nous sommes encore, plus difficile à cerner car nous manquons de recul, est fait à la fois de la poursuite des initiatives antérieures, de recentrages divers et d’un certain affinement doctrinal.
Après les avoir présentés, je tenterai justement de cerner ce que ce thème de la pluralité apporte présentement à la Ligue, notamment dans son approche de la laïcité.
LE MOMENT DU FOLKLORE (des années 1930 aux années 1960)
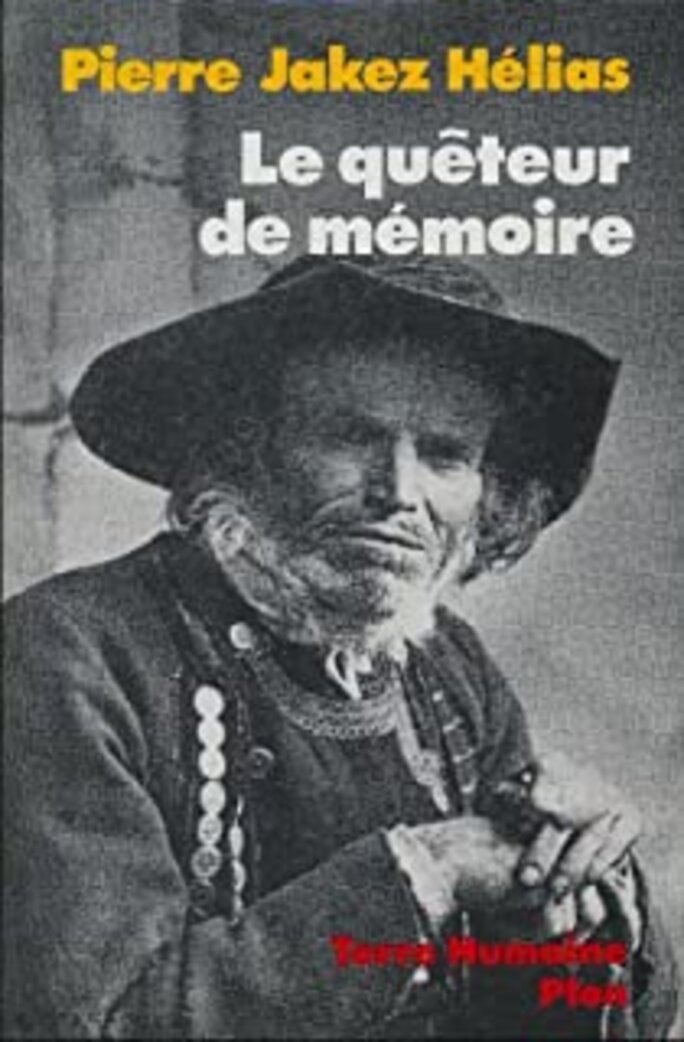
L’intérêt pour le folklore doit se comprendre comme une perspective d’entrée dans les cultures populaires, de façon complémentaire à une conception de la culture centrée sur la diffusion des œuvres. La Commission Folklore de l’UFOLEA joue un rôle important à cet égard : créé dans les années 30 sous l’impulsion de Paul Delarue, un militant originaire de la Nièvre qui vient alors à Paris pour prendre cette responsabilité nationale, elle sera reconstituée dans les années 1950, toujours par Delarue puis à partir de 1954 sous la houlette de Pierre Hélias. Elle se prolonge dans les années 1970 par une Commission des Arts et Traditions populaires, à laquelle participe Robert Lafont.
Je serai très bref sur ce point. L’objectif était de pratiquer un folklore sans folklorisme, selon le mot de Lafont, c’est à dire en rupture avec la superficialité de certaines démarches, comme la réduction du folklore à des danses traditionnelles en costumes de terroir alors qu’il s’agissait de s’intéresser à la « totalité de la civilisation populaire en ce qu’elle a de spécifique » selon une expression attribuée à Pierre-Jakez Hélias. Le folklore-club, en particulier, visait à constituer des éléments de connaissance scientifique sur les traditions populaires, en groupant les personnes intéressées. La perspective d’échanges interculturels était également présente, soit entre les diverses régions françaises, soit en pratiquant des ouvertures sur les apports culturels venus d’autres pays ou continents, dont P-J Hélias donne un aperçu dans son ouvrage Le Quêteur de mémoire (2).
Cette tradition s’est poursuivie à partir des années 1970 par la création du CIOFF (Conseil international des organisations de folklore et d’arts traditionnels) : le festival de Montignac est un excellent exemple de ce que peut donner le meilleur de cet héritage. Le folklore a été un élément essentiel pour repenser la culture populaire et la culture en général dans une perspective ethnologique. Il devait conduire tout naturellement à la prise en compte des langues régionales.
MOMENT DES LANGUES ET DES CULTURES RÉGIONALES (années 60 au milieu des années 80)
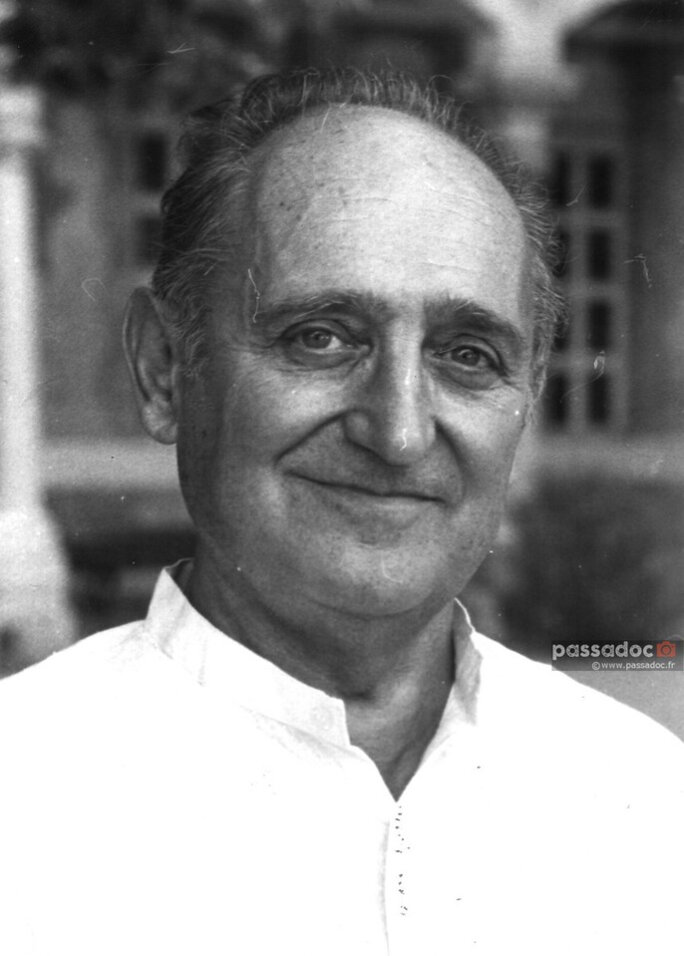
Agrandissement : Illustration 4

Dans l’Action Laïque, ce moment est inauguré par un article de Robert Lafont, publié en 1960 (3). L’auteur intervient alors au titre de président du Mouvement Laïque des Cultures Régionales, récemment créé. Ajoutons qu’il est aussi l’ancien Secrétaire général de l’Institut d’Etudes Occitanes, qu’il a contribué à orienter vers l’enseignement des langues régionales. Et il est également présent à la Ligue de l’enseignement et restera proche d’elle ultérieurement. Cet article, sur lequel je m’arrêterai un peu, est intéressant d’abord par sa date : il coincide avec la lutte contre la loi Debré, Lafont ne veut d’ailleurs pas remettre en cause celle-ci, mais montrer qu’il y aussi un autre enjeu scolaire, que la querelle laïque a fait oublier : c’est celui de la justice à rendre aux langues régionales, maintenant que l’hégémonie du français a été obtenue grâce à l’Ecole. La tonalité est modérée : « Il fut un temps où la conscience nationale naissante exigeait l’apprentissage par tous les Français d’une langue qui n’était pas seulement un moyen officiel de communiquer entre provinces, mais le signe m de la citoyenneté. Que cet apprentissage se soit fait avec quelque brutalité, nous le regrettons, mais nous ne condamnons pas pour autant le mouvement qui a réussi. Pourtant nous pensons que ce temps est révolu. Un autre commence ». La réussite de la « francisation » par l’école conduit à s’interroger sur ce qui s’est passé : aurait il été possible de procéder autrement avec les langues régionales ?
« Etait-il légitime de les faire disparaître ? Au nom d’un principe pédagogique bien connu qui veut que l’apprentissage d’une langue ne demande pas la destruction d’une autre langue, n’aurait il pas été plus sûr d’utiliser les ressources des parlers locaux pour amener l’élève à la connaissance difficile de la langue nationale ? Les expériences nombreuses de comparaisons linguistiques à l’école prouvent bien à ceux qui les ont tentées qu’une belle occasion pédagogique a été perdue. Mais d’autre part croit-on (…) que les méthodes punitives employées pour interdire le « patois » aient été sans laisser des traumatismes ? Le mépris de la condition populaire , les snobismes ravageurs, le repliement du « cul-terreux » sur lui-même en un pays où le mot paysan est une insulte, ne sont-ce pas des cicatrices laissées par le déracinement ? ». L’optique de Lafont est donc réparatrice : rendre justice à des langues et des cultures « qui ont su toucher la conscience populaire », et qui ne sont pas de simples dialectes puisqu’elles ont accédé à la dignité de langues littéraires (et il développe assez longuement l’exemple de l’occitan). Il plaide contre l’assimilation souvent faite de la promotion de ces langues à celle de la réaction politique et cléricale, et présente plutôt la question comme un territoire oublié du combat pour l’Ecole laïque , en rappelant l’existence d’une tradition progressiste, socialiste en particulier qui, depuis Jaurès, a pris fait et cause pour ces langues, jusqu'à la loi Deixonne de 1951, la première à accorder un début de légitimité à certaines d’entre elles.
Il me semble que ce texte est de nature à fonder un positionnement sur lequel la Ligue d’aujourd’hui pourrait tout à fait se reconnaître encore. Mais l’optique du combat régionaliste se radicalise après Mai 68, au cours des années 1970. Robert Lafont reste un personnage pivot de cette évolution. C’est l’ époque où il écrit ses principaux ouvrages, dont le très documenté La revendication occitane (1974) – où il donne libre cours à sa critique du « colonialisme intérieur » qui appelle à ses yeux une « révolution régionaliste » (titre d’un précédent livre, de 1967) ; d’autres titres sont significatifs des préoccupations du moment : Décoloniser en France, 1971 , L’Autonomie, de la Région à l'Autogestion, 1976.
Ces thèmes pénètrent la Ligue avec quelques années de décalage (au moins s’agissant de sa presse). Elle ouvre un débat sur le régionalisme à la veille de son AG de Brest en 1979, débat qui se trouve combiné avec une discussion sur la régionalisation du mouvement. Elle adopte peu à peu le vocable de l’aliénation régionale, en le reliant aux luttes du Midi qui ont une connotation anticapitaliste (combats des viticulteurs et, bien entendu, lutte contre l’extension du camp militaire du Larzac) et élargit son intérêt pour les langues à la dimension plus large des cultures régionales : la région est perçue comme « le dernier lieu de la culture populaire », un élément de résistance à l’uniformisation culturelle, que ce soit celle du capitalisme ou de la centralisation (4).
Certains responsables embrayent dans une tonalité nettement politique, qui soulève d’ailleurs des discussions. Ainsi un article de Pierre Tournemire de 1979 est une profession de foi résolument régionaliste, associant étroitement régionalisme (illustré par la revendication ‘Vivre, travailler et décider au pays’ ), anticapitalisme, dénonciation du centralisme administratif, et critique d’une vision linéaire du progrès (rejoignant celle des écologistes). Il affirme que « l’articulation trouvée entre la revendication régionaliste nationalitaire et la lutte des classes donne au culturel une combativité nouvelle ». Il conclut en inscrivant le combat régionaliste dans la quête d’un « humanisme concret », qui doit être celui de la Ligue : «Le citoyen veut être désormais un citoyen concret et non plus un simple votant. C’est en un mot l’ aspiration à une liberté qui a cessé d’être abstraite (5)». On remarquera que le thème de la République est en grande partie absent de tous ces propos. C’est « le droit à la différence » qui encadre cette réflexion jusque dans les années 1980.
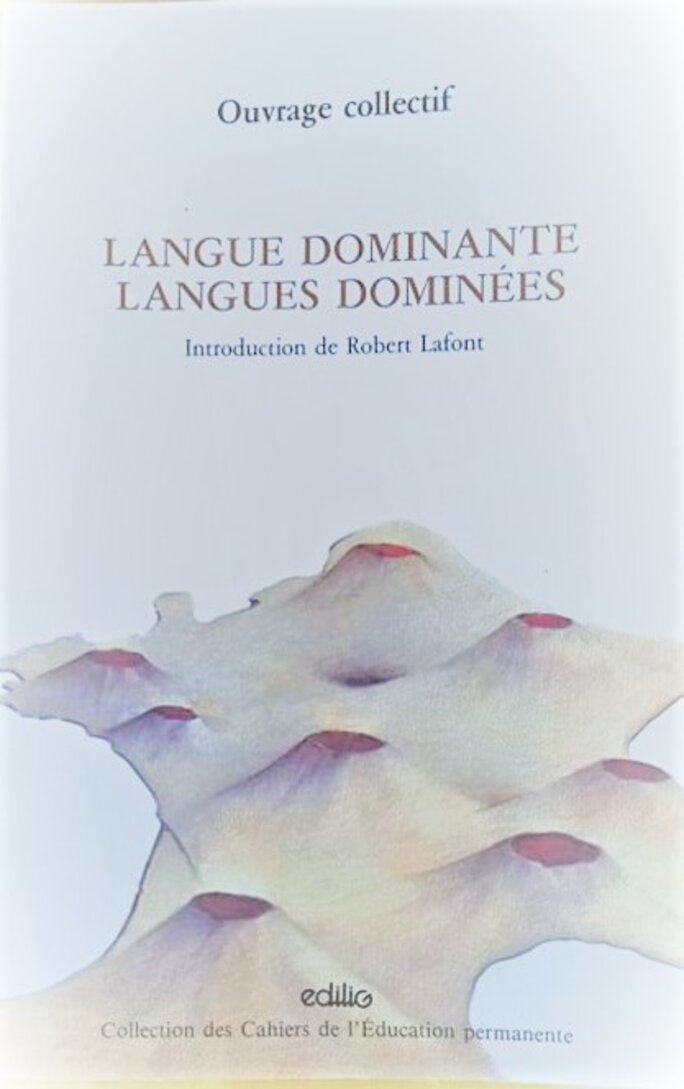
Agrandissement : Illustration 5
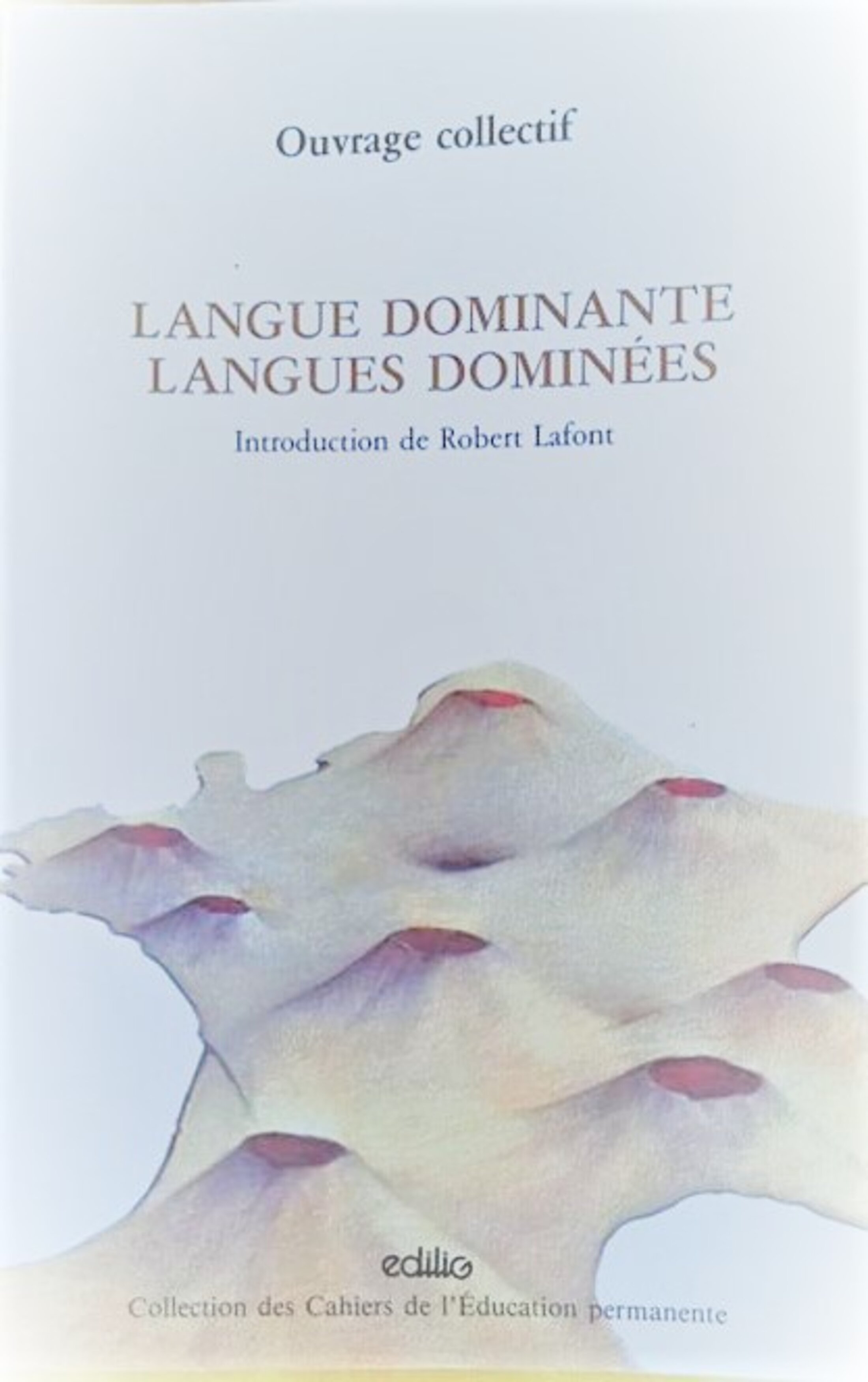
La préoccupation régionaliste se traduit d’abord dans l’activité de la Ligue, par une grosse production intellectuelle qui culmine dans les années 1979-81 avec la publication dans Pourquoi ? d’une série d’articles très documentés sur « les langues de l’hexagone ». Guy Gauthier, devenu responsable du secteur Culture et Communication, en est le maître d’œuvre. Il écrit lui-même de substantiels articles à la suite d’enquêtes où il rencontre les acteurs régionalistes sur le terrain (Corse, Lorraine) et se fait le relais de leurs propos tout en s’appuyant aussi sur une documentation sérieuse. Les journalistes Michel Tricot et Nicole Gauthier, l’écrivain occitan Yves Rouquette, les universitaires Pierre Bonaud et Jean Richard complètent cette série, qui sera publié peu après l’arrivée de la Gauche au pouvoir dans l’ ouvrage collectif intitulé Langues dominantes, langues dominées, avec un long chapitre introductif de Robert Lafont (« La privation d’avenir ou le crime contre les cultures ») (6). On est en 1982, l’attente est très forte, qui sera assez vite déçue, malgré les quelques mesures prises par Alain Savary.
La volonté d’animer la scène du régionalisme est ensuite prolongée de deux manières . D’abord par les rencontres de Montpellier entre 1982 et 1984 : en fait trois rencontres sur les identités culturelles, en terre occitane, mais dans une perspective d’ouverture sur les cultures méditerranéennes (Catalogne, cultures insulaires notamment : Corse, Sicile, Sardaigne). Avec des militants des causes régionalistes (Lafont y est présent), des représentants des Ministères de la Culture, de l’Education Nationale , des enseignants et des artistes. Ensuite, la Ligue prend position officiellement en faveur d’une véritable politique linguistique cohérente et ambitieuse, dont l’essentiel est résumé dans un numéro spécial de Pourquoi ? sur le bilinguisme (7) .
Le document le plus important qui synthétise la politique linguistique de la Ligue est celui adopté par le Conseil d’administration de janvier 1985. Il n’identifie pas la défense des langues régionales à un réflexe patrimonial, mais à un souci de rendre les cultures productives dans un monde ouvert (8). Il s’engage pour un bilinguisme précoce, comme facilitateur d’apprentissage d’une autre langue, et élément de résistance à l’impérialisme anglo-saxon : « La langue française est menacée de l’extérieur – en particulier par les formes dégradées de l’anglais et de la culture de masse des Etats-Unis – non de l’intérieur. Il est avéré que les locuteurs ayant la maîtrise, en plus de la langue française, d’une langue minoritaire, de territoire ou d’émigration, opposent une plus forte résistance à la pénétration abusive de la culture dominante d’origine nord-américaine. « (…) La résistance face à l’anglais n’est pas crédible si elle s’accompagne d’une répression plus ou moins avouée des langues qui cohabitent en France ». « Les locuteurs dans les langues minoritaires sont en raison de leurs origines ou de leur situation périphérique en position de communication internationale (quelques unes de ces langues délimitent des espaces qui sont des lieux de passage privilégiés dans la perspective de la construction d’une Europe des cultures et partant dans l’élaboration d’une politique culturelle européenne) ». « La reconnaissance de plein droit des langues régionales et minoritaires n’est donc qu’une étape dans la prise en compte de la pluralité des langues en Europe et dans le monde. Le XIXè siècle pensait parvenir à l’universalité par la réduction des différences ; sans renier son héritage, la LFEEP revendique l’universalité par le développement harmonieux de la diversité culturelle. Il lui paraît urgent pour commencer de sauver ce qui peut être sauvé (9)»
Toutes ces initiatives ont de nombreux échos à l’intérieur de la Ligue notamment dans les fédérations concernées par les langues : surtout les fédérations occitanes (la rencontre de Montpellier dont la FOL de l’Hérault est le support en est un signe), ou bretonnes autour d’ une personnalité comme Armand Keravel (10). La série sur les langues de l’hexagone suscite un abondant courrier des lecteurs : spécialistes de haut vol, ou militants. Mais une partie du mouvement s’en désintéresse ou manifeste son hostilité, parfois argumentée idéologiquement au nom de la défense de la tradition laïque (11). Il faut d’ailleurs remarquer que jusqu’ici il n’y a pas de pont entre ces revendications en faveur de la diversité linguistique et la thématique de la laïcité. Mais cela est en train de changer car les années 1980 sont aussi celles du grand basculement, avec d’une part une réorientation majeure du débat sur la laïcité après la défaite du projet d’unification laïque de 1984, et d’autre part, un élargissement du thème de la diversité aux cultures de l’immigration ; et ceci, bien que la Ligue ait déploré rétrospectivement avoir été absente de la Marche pour l’égalité (des Beurs) en 1983.
MOMENT D’UNE LAÏCITÉ PLURI ou INTER-CULTURELLE (des années 1980 au tournant du siècle)
Cette période est pour la Ligue, celle de la prise de conscience de l’avènement d’un multiculturalisme de fait de la société française et plus largement de l’Europe au sein d’un monde mondialisé : en attestent les rencontres de Montpellier, le colloque de 1986 sur le thème Laïcité 2000, ainsi que la première prise en compte de l’islam, comme une question à traiter, à la fois parce qu’il y a sur elle un déficit de connaissances et parce qu’elle entre en résonance avec des représentations passionnelles, héritées du passé colonial, et même d’un passé plus ancien : l’année 1992 marque à cet égard un moment fort avec la célébration un peu décalée du 500è anniversaire de la découverte du Nouveau Monde, en mettant l’accent sur « l’autre 1492 », celui de la Reconquista et de la Chute du Royaume de Grenade. L’événement est perçu comme ayant mis fin à la possibilité d’une « autre histoire de l’Europe » dont l’islam aurait été une composante.
La prise en compte du multiculturalisme se traduit au premier plan des analyses idéologiques produites par le mouvement. On peut citer trois repères qui encadrent la période à cet égard. En amont : le rapport Morineau précédant le congrès de Lille en 1986 :« La laïcité doit penser une voie nouvelle dont une des hypothèses est l’interculturalité –c’est à dire l’organisation du brassage, la communication, la porosité des cultures ». En aval : les deux documents de travail produits en 1998 : « Penser une France une et diverse », « Laïcité et islam dans une France une et diverse ». Au milieu : l’épisode controversé de la « laïcité plurielle » en 1990-91, une expression bientôt abandonnée et sur laquelle la Ligue fera son autocritique, mais sans renoncer à la perspective de fond qu’elle impliquait : une laïcité capable de faire sa part à la pluralité culturelle. Pour le dire autrement, c’est alors qu’émerge une pensée critique sur le moment républicain actuel, notamment par comparaison entre ce qui se passe en France et dans d’autres pays européens, considérés comme plus avancés dans leur reconnaissance des « identités culturelles collectives qui ne coïncident pas avec l’identité nationale » et dans « l’harmonisation entre doits civiques individuels et droits collectifs culturels » (12).
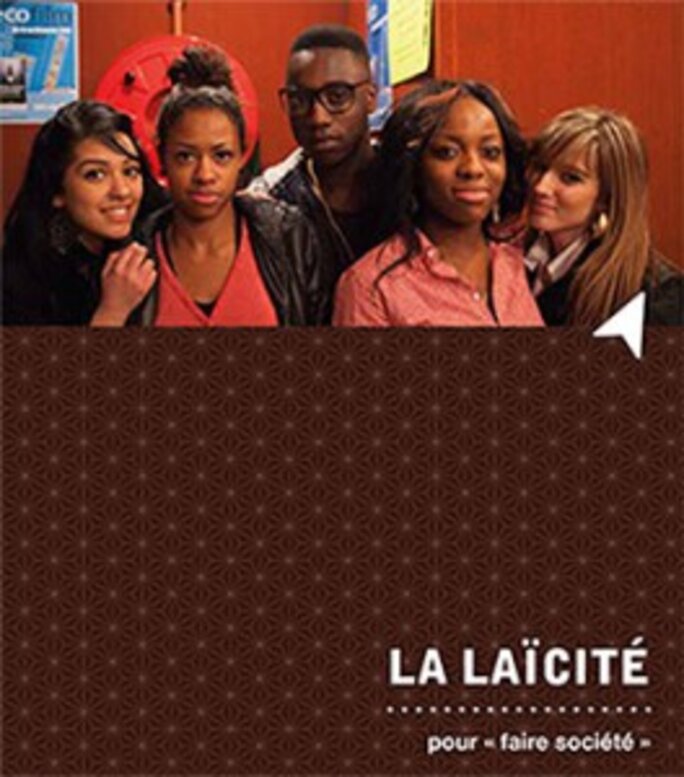
Je ferai cependant l’hypothèse, à la lecture attentive des textes de cette période, qu’un déplacement s’opère dans les références qui encadrent cette réflexion - très riche et qu’on ne peut pas résumer en quelques mots. On passerait peu à peu d’une vision centrée sur le droit à la différence – une expression qui s’est avérée très vite ambiguë en grande partie à cause de la critique polémique qu’on lui a fait subir (« le droit à la différence, c’est la différence des droits ») - à une vision centrée sur le droit à l’identité et sur les discriminations. Un aspect essentiel de la légitimation des identités culturelles revient en effet à dire qu’elles sont des réponses apportées à des situations discriminées par ceux là mêmes qui les vivent– le problème étant alors de ne pas s’enfermer dans une vision de la société qui serait simplement la « co-existence » ou la juxtaposition de ces identités susceptibles de devenir des « forteresses culturelles ».
Cet impératif marque les initiatives et prises de position dès les années 1988-92 à travers, notamment :
-la rencontre avec des jeunes issus de l’immigration, programme « Cités en mouvement » dans le but avoué de faire reculer les exclusions, de construire des solidarités en redynamisant le tissu associatif , et aussi d’affirmer sa présence auprès des jeunes de banlieues ;
-la tolérance à l’égard du port du voile islamique par les jeunes filles à l’école publique en 1989, qui est argumentée comme une « volonté d’identification » (Jean-Louis Rollot), en réponse à des discriminations : « le tryptique maghrébin–musulman-exclu est au cœur de l’affaire » (communiqué de la Ligue du 17 octobre 1989) ;
-la création en 1997 de la Commission Laïcité et Islam et l’ouverture d’un dialogue avec toutes les sensibilités musulmanes, notamment celle de Tariq Ramadan et des jeunes proches de lui, que l’on reconnaît donc ici comme interlocuteurs avant tout parce qu’ils ont des choses à dire sur cette situation discriminée de l’islam.
Simplement, le basculement intervient là aussi très vite. Il coïncide, en gros, avec les années Jospin (1998-2001). La Ligue va estimer en 2000 que la Commission Laïcité et Islam a rempli son contrat (faire l’inventaire des compatibilités entre l’ islam et la laïcité juridique, en montrant qu’ils sont compatibles) et décide de mettre fin à sa participation – une position fort mal comprise de la plupart des membres (musulmans ou non) de la commission. On sait aussi que cette posture de dialogue a rencontré l’indifférence voire l’hostilité d’une partie de la Ligue et que les interrogations et les perplexités vont s’amplifier à propos de Tariq Ramadan, relayant le discours des médias.
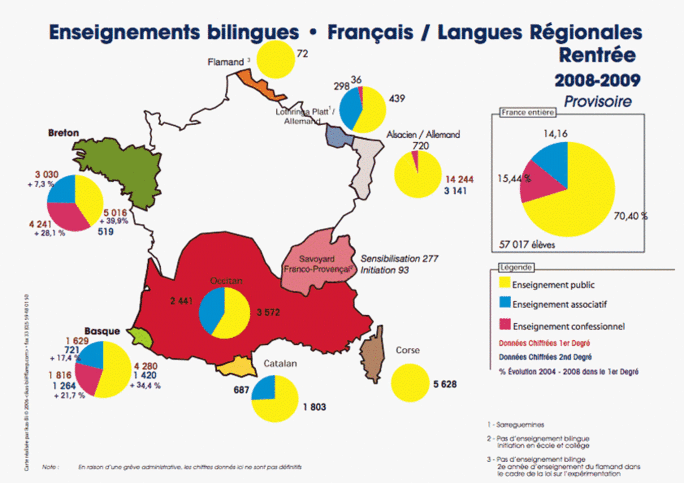
Agrandissement : Illustration 7
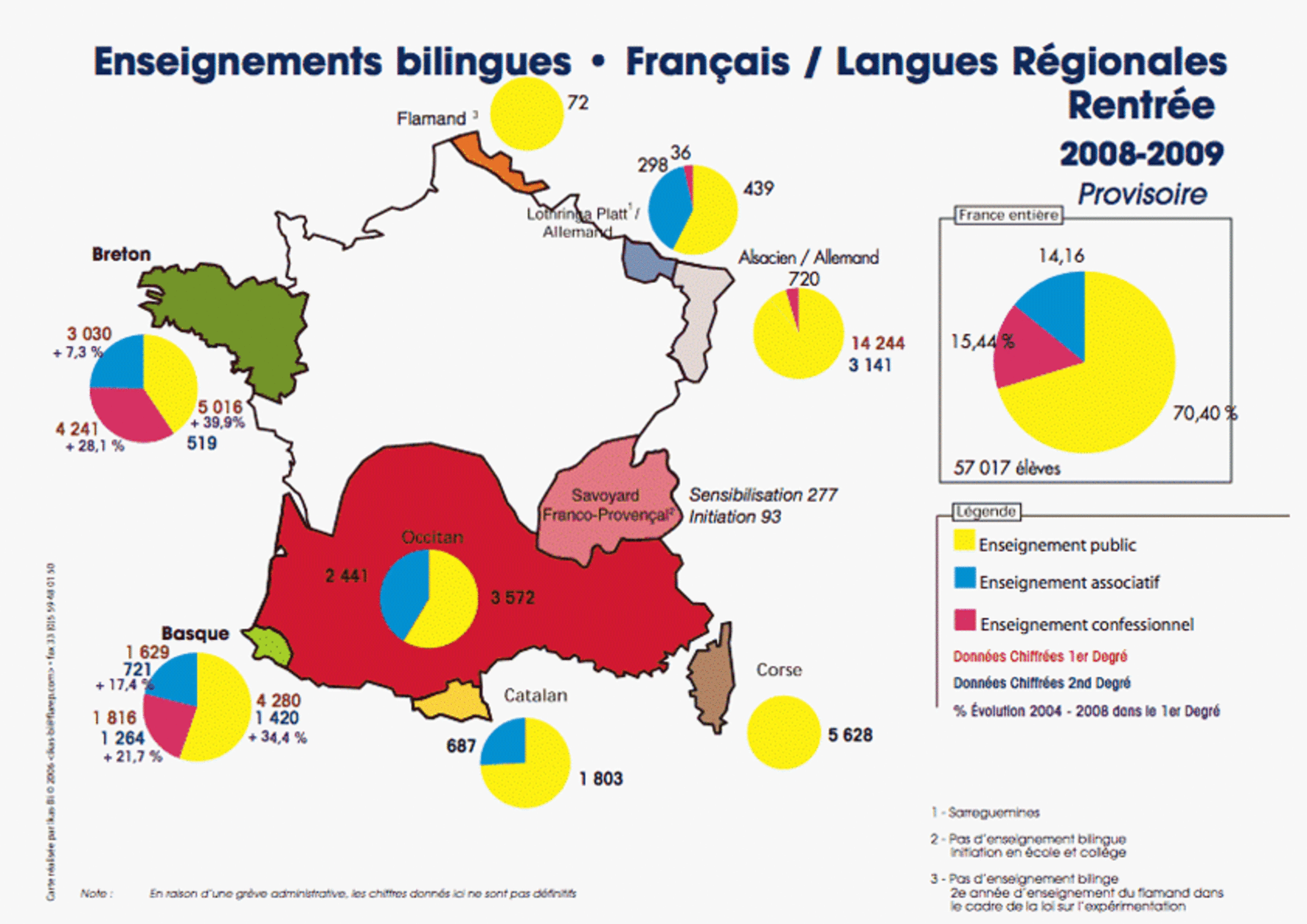
On assiste aussi à une reprise du débat sur les langues régionales, mais dans des conditions différentes des années 1970. Aussi timides soient-elles, les mesures prises par la gauche (circulaire Savary de 1982, CAPES de breton et autres entre 1985 et 1991, classes bilingues) inaugurent une phase plus opérationnelle de la présence de ces langues à l’Ecole, qui soulève de nouvelles questions : enseignement en immersion, obligation ou non de suivre ces cours dans certaines régions. Parallèlement une certaine délégitimation de la cause des langues régionales s’opère dans l’opinion. Celle-ci sans doute n’est pas nouvelle, mais elle trouve de nouveaux arguments : ces langues font-elles vraiment partie de la culture populaire, l’intérêt qu’elles suscitent n’est-il pas artificiel ou limité aux classes moyennes ? Est ce à l’Ecole de compenser le faible nombre de locuteurs de ces langues dans les diverses régions françaises ? (13).
Trois polémiques plus ou moins emboîtées vont embarrasser et diviser la Ligue :
-la ratification de la charte européenne des langues régionales et minoritaires : elle assiste impuissante à l’impasse sur ce point, et à la naissance du « serpent de mer » de la ratification sans cesse promise puis différée ;
-l’ introduction de la langue corse dans les programmes, qui fait partie de la tentative de Lionel Jospin de s’attaquer à un nouveau statut pour la Corse : « un enseignement systématique-facultatif » qui rappelle fâcheusement le statut de l’enseignement religieux en Alsace-Moselle ;
-l’ intégration des écoles bretonnes Diwan dans le service public, souhaitée par le ministre de l’EN Jack Lang : l’enseignement du breton en immersion ne porte-t-il pas atteinte à l’intégrité du service public ?
On peut dire qu’ici la question de la laïcité sous sa forme traditionnelle de la défense du service public s’invite dans le débat, et introduit un élément de tension avec certains aspects de la promotion de la pluralité culturelle. C’est ce qu’exprime avec force Jean-Michel Ducomte :« Oui à l’enseignement des langues régionales, mais non à une mauvaise manière faite au service public » : car le protocole d’intégration fait des écoles Diwan des établissements publics « bien singuliers » qui « conservent leur caractère propre » ; l’enseignement confessionnel pourrait donc s’engouffrer dans la brèche (« rien ne distingue l’immersion linguistique de l’immersion religieuse ») et on serait « aux antipodes du service public unifié (14)».
Sur toutes ces questions, apparaissent aussi des décalages entre les initiatives que prend la direction de la Ligue et les réactions de la base ou des partenaires laïques : les fédérations bretonnes qui avaient été en pointe dans la promotion du breton sont désormais très partagées sur les écoles Diwan, d’autant que se développent parallèlement des classes bilingues dans l’enseignement public. En définitive, la Ligue a été rattrapée par le débat d’opinion, au moins sur l’islam - mais peut-être plus largement. Une parenthèse semble se refermer, tout se passe comme si la France était rattrapée par son tropisme historique centralisateur et uniformisateur, sous couvert de défense des valeurs républicaines et de la défense de « l’idéologie nationale » qui commencent alors à être portées au pinacle. Une bonne partie de la gauche se rallie à cette façon de voir, pour éviter que la thématique nationale ne soit pas monopolisée par la droite (15).
ENTRE CONTINUITÉ, RECENTRAGES et … OUVERTURES

Agrandissement : Illustration 8

Depuis le début des années 2000, la Ligue est entrée dans une nouvelle phase, plus complexe à caractériser, dans l’approche de ces problèmes. Elle est plus attentive au vocabulaire, et veille en particulier à s’inscrire dans les réquisits sémantiques du républicanisme qui fait l’objet de rappels constants dans les discours politiques, après le 11 septembre 2001 : d’où la poursuite d’un travail d’aggiornamento (commencé dès le milieu des années 1980), qui vise désormais à situer la réflexion sur la pluralité dans le cadre d’une tradition républicaine et laïque revisitée, sans pour autant renoncer sur le fond aux orientations prises antérieurement. Cette perspective imprègne, en particulier, tous les grands textes doctrinaux produits sur la laïcité, que l’on s’abstiendra de présenter ici. Un recentrage est également à l’œuvre sur un travail plus concret en direction de la base militante : il s’agit de promouvoir « une laïcité d’engagement au quotidien » (16). D’où l’importance de certaines initiatives « pédagogiques » comme le site « Laïcité à l’usage des éducateurs » , ou plus récemment la prise en compte des implications de la diversité dans le fonctionnement des Centres de Vacances et de Loisirs.
Sur l’appréhension de l’islam , la nouvelle conjoncture a des effets paradoxaux. On peut dire qu’après l’expérience de la Commission islam et laïcité, le souhait de la Ligue était que cette question ne monopolise plus la problématique de la pluralité, car le pluralisme ne se réduit pas à la présence musulmane. Néanmoins, compte tenu de l’amplification des débats et polémiques d’opinion, le sujet continue nécessairement d’être au premier plan des préoccupations. La Ligue joue donc parfois serré pour faire prévaloir un discours qui a peu varié dans ses grandes lignes, mais qui s’est affiné en mettant l’accent sur la complexité des enjeux, et sur la nécessité de ne pas les dramatiser. Au demeurant le discours de la Ligue aujourd’hui semble moins intéresser les médias que dans les années 1980, où les orientations en matière de laïcité faisaient parfois la une des quotidiens nationaux. C’est sans doute que ce discours plus complexe ne correspond pas à la préférence des médias, mais aussi peut-être le signe que la valorisation de la diversité ne va pas « dans le sens du vent dominant ». Y compris dans ses propres rangs, où la diffusion de la revue Diasporiques, qui se veut depuis 2008 un carrefour pour en débattre, reste faible.
J’en arrive ici à la seconde partie de cette introduction historique. Quelle a été la portée intellectuelle et politique de la rencontre avec la pluralité culturelle pour la conception de la citoyenneté et de la laïcité que développe aujourd’hui la Ligue? Deux questions préalables me semblent devoir être posées : a-t-elle rompu avec le jacobinisme ? s’est-elle ralliée au multiculturalisme ?
1)Peut-on parler de rupture avec le jacobinisme ?
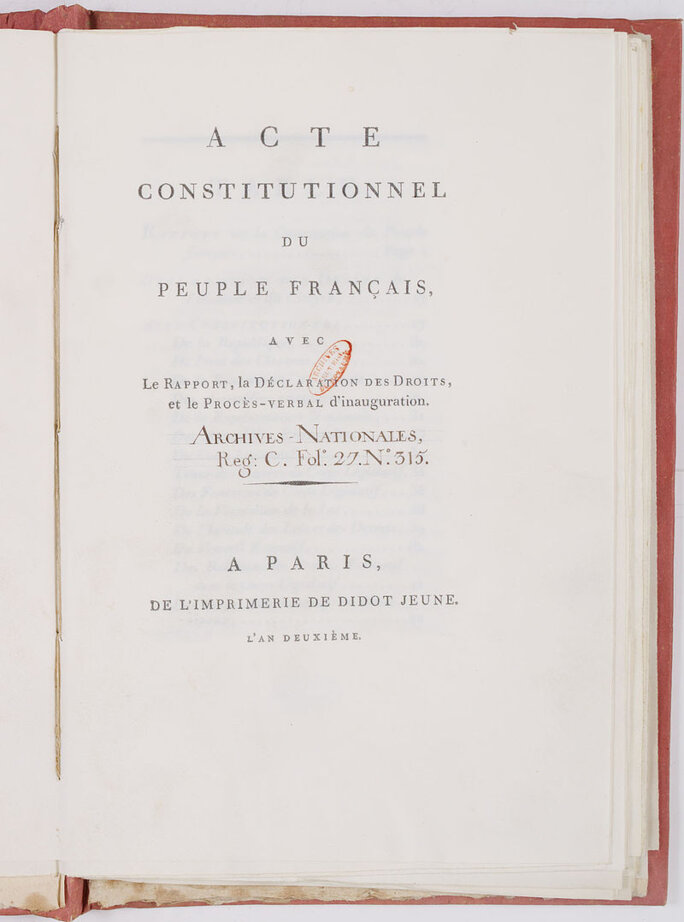
Agrandissement : Illustration 9
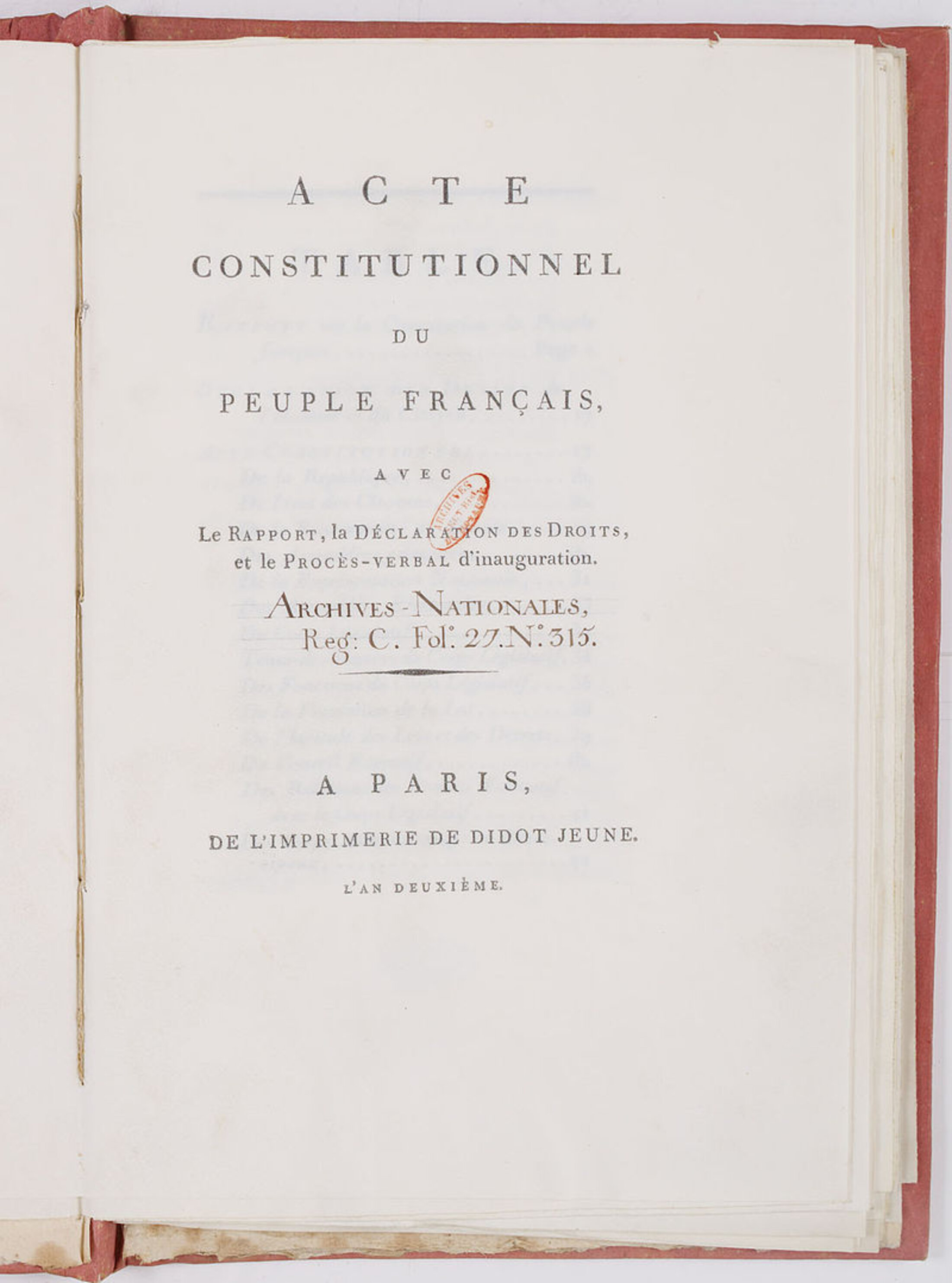
Cela dépend du sens que l’on accorde au mot. On a souvent opposé Girondins et Jacobins et vu dans les premiers les ancêtres des mouvements régionalistes d’aujourd’hui. C’est là un héritage qu’aurait récusé Robert Lafont pour qui les Girondins n’étaient nullement l’embryon d’une « bourgeoisie nationale occitane », ni des démocrates fédéralistes, « eux qui incarnaient l’idéologie de ces bourgeoisies provinciales nourries de nationalisme français, qui mettent en avant la doctrine des frontières naturelles et poussent à la guerre impérialiste contre l’avis de Robespierre » (17) ; et en ce qui concerne les langues « ils étaient rigoureusement centralisateurs universalistes français » (18). Alors que pour Lafont, le « contrat national » jacobin tel que le définissait le ‘jacobinisme pur’ n’interdisait pas la décentralisation la plus large ni même le recours aux usages des langues locales, qui auraient d’ailleurs été en vigueur dans les actes administratifs jusqu’en 1793. Peut-on alors aller jusqu’à dire que la Constitution de l’an I était la plus la plus démocratique et la plus décentralisatrice de toutes ? Le problème, c’est qu’ elle n’a jamais été appliquée : « Toutes les constitutions appliquées sont bonapartistes » (19). La faute des révolutionnaires est d’avoir sacralisé la Nation, d’en avoir fait un mythe unitariste, substituable au Souverain d’Ancien Régime (20). C’est la Terreur qui, pour ainsi dire, serait venue à bout de ce jacobinisme pur…
Toute autre est l’approche d’une historienne comme Mona Ozouf. La perspective ici s’inverse : le jacobinisme est co-extensif à la Terreur ; l’essence du jacobinisme se décline comme l’incarnation de la centralisation politique et administrative, du règne de la manipulation des élus, de la suspension de la réalité : une sorte de préfiguration du bolchevisme et du totalitarisme. L’une de ses caractéristiques majeures est « l’impossibilité de concevoir une volonté populaire divisée » (21). Mais quel que soit le statut accordé au Jacobinisme, tout le monde à la Ligue serait d’accord pour parler de rupture nécessaire avec le centralisme, avec le « verrou unitariste » ( Lafont, 1967) et avec une conception uniformisatrice de la culture.
2)La Ligue s’est elle ralliée au « multiculturalisme » ?
En fait, elle fait la différence entre multiculturalisme de droit et multiculturalisme de fait, en forçant peut-être parfois leur opposition - qui ne semble très fondée que par rapport à des versions extrêmes du multiculturalisme. Quoi qu’il en soit, le but n’est pas d’instituer les différences ou les identités collectives dans le droit (la fameuse « différence des droits » qui pétrifie les discriminations), mais de leur accorder une place dans la réalité sociale et au sein de l’espace public alors qu’à l’origine dans la conception révolutionnaire elles n’en avaient aucune. Je rappelle que cette conception ne reconnaissait aucun corps intermédiaire entre l’individu et l’Etat, même pas les partis politiques qui n’étaient considérées que comme des « factions » ruineuses pour l’unité nationale, sans parler des associations ou de tout ce qui était synonyme d’intérêts communs organisés. Le Chapelier, père d’une loi célèbre, s’exprimait ainsi : « Il ne doit pas être permis aux citoyens de s’assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Il n’y a plus de corporations dans l’Etat. Il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire».
Mais le problème est de savoir ce que l’on valide quand on parle de multiculturalisme de fait. A cela une première réponse peut consister à dire non seulement qu’il existe dans la société des identités diverses, mais que les individus sont porteurs d’identités multiples, et que ces identités multiples ne peuvent plus être confinées dans l’espace privé (au sens de l’entre soi familial et intime) comme elles l’étaient autrefois. Pour le dire autrement, on est aujourd’hui en présence d’une dissociation entre un certain nombre d’éléments qui étaient souvent confondus dans le modèle républicain classique, et y faisaient bloc sans aucune marge de jeu.
Exemples :
-la citoyenneté et la nationalité : la dissociation entre les deux est le grand apport des années 1980, en relation avec la question qui surgit alors dans le débat public du droit de vote des immigrés aux élections locales, ainsi qu’avec la construction européenne, qui accorde ce même droit aux ressortissants de l’UE. Cela revenait à introduire la possibilité d’une citoyenneté à plusieurs vitesses, l’identité française n’excluant pas des dimensions moins vastes (le local) ou plus vastes (l’Europe, le monde : véritable échelle de traitement de certains problèmes). Il y avait là un élément de relativisation de l’identité nationale, qui bien entendu pouvait susciter le débat, et n’a pas manqué de le faire d’ailleurs.
-l’unité politique et l’unité culturelle. Autrement dit la première n’exige plus nécessairement la seconde, alors qu’elle l’exigeait implicitement dans la tradition républicaine (les institutions – au premier chef l’Ecole - étaient programmées en ce sens). C’est l’idée qu’on ne doit pas nécessairement être moins breton – ou moins musulman – pour être davantage français ; pour exister, l’identité nationale ne doit pas nécessairement écraser les identités partielles.
Toutefois la Ligue a eu bien conscience que la multiplication des identités partielles n’était pas en elle-même la solution. Cela peut aboutir à juxtaposer les cultures particulières les unes à côté des autres - ce qui pourraient en faire des lieux d’enfermement, au détriment de l’idéal d’une société d’individus ayant des identités multiples (on peut être musulman, breton, homosexuel et citoyen français). D’où la nécessité de développer des valeurs communes partagées, non dans le but chimérique de recréer une homogénéité morale perdue, mais pour améliorer la qualité de la vie sociale et citoyenne - ce qui s’est traduit dans le vocabulaire de la Ligue par le choix de l’expression ‘Faire société’. La perspective tracée revient à dire qu’il vaut mieux être plus attentif aux similitudes qu’aux différences.
Le récent livre de Patrick Weil, intitulé Le sens de la République, consonne assez bien avec cela. La même idée a également été travaillée, dans une optique différente, par Mona Ozouf dans Composition française (22). Il est du reste caractéristique que ces deux auteurs se retrouvent , sans apparemment s’être concertés, pour adopter ce terme de « composition », dans le double sens où l’identité nationale serait la résultante d’une construction plurielle et d’un arbitrage. P. Weil parle de « composition entre assimilation et reconnaissance de la diversité » pour qualifier la démarche des immigrés et de leurs enfants dans la relation à la France: dans certains cas, ils veulent être assimilés et qu’on ne les assigne pas à leurs particularités –être traités semblablement par les autorités, la police, l’école, les hôpitaux,… dans d’autres cas ils souhaitent, à l’occasion d’une fête religieuse par exemple, être reconnus dans leur particularité (op. cit., p. 77-79). Il conclut: « La république doit montrer d’abord ce que nous avons en commun – la majorité des choses- avant de montrer les différences » (p. 123).

Pour Mona Ozouf, il est légitime que les individus aient plusieurs appartenances en même temps, mais elles ne peuvent pas toujours être égales; s’appuyant sur Louis Dumont, elle indique qu’ il y a des circonstances qui exigent qu’on arbitre entre plusieurs identités et qu’on hiérarchise au profit de l’une d’elles: « il nous faut distinguer les différents niveaux de nos vies, déterminer ceux où domine le point de vue du collectif, et ceux où la particularité retrouve ses droits.. dans telle circonstance donnée, telle fidélité peut parler plus fort que les autres »(op. cit., p. 246-247). Dans une perspective voisine, quoique peut-être pas tout à fait aussi précise, la Ligue, me semble t-il, a avancé au moins trois pistes pour prendre en compte cette « composition » entre le commun et la diversité.
La première est la dialectique du particulier et de l’universel, comme substitution à l’affrontement binaire du particulier et de l’universel. Ce thème a fait l’objet d réflexions diverses et de colloques. Cela aboutit à reconnaître la part d’universel présente dans chaque culture particulière. Cette même attitude peut conduire aussi à relativiser les prétentions auto-proclamées à l’universalité du modèle républicain lui-même (le « communautarisme national-républicain ») qui découlent du paradoxe français : la France a reçu l’universel comme une expression de sa particularité, mais cela ne l’exonère pas d’avoir à répondre d’un usage abusif de l’universel, quand cet usage recouvre des comportements de domination.
La seconde consiste à privilégier le recours à la dimension délibérative de la laïcité pour régler les conflits culturels et plus largement les problèmes de coexistence entre cultures au sein de la société française. Autrement dit pour créer du commun, le recours au dialogue est préférable aux lois d’interdiction, à la répression des comportements minoritaires. Or cette dimension délibérative était largement absente de la laïcité traditionnelle. Celle-ci avait recours principalement à deux attitudes : tantôt , au niveau de l’école, elle faisait taire les conflits au nom de la neutralité (ne pas parler de ce qui fâche) et donc mettait les appartenances, notamment religieuses, entre parenthèses- quitte à ce que cette neutralité dissimule un processus de domination idéologique (23)- ; tantôt elle spéculait sur une « philosophie laïque » inspirée par le rationalisme, la science ou le progrès humain – c’est à dire un certain rapport à la Vérité plus ou moins en opposition à une conception religieuse (en fait catholique) du monde. Sans s’interdire de se référer dans les conditions d’aujourd’hui à un « humanisme laïque », la laïcité actuelle exige de soumettre celui-ci aux mêmes conditions de délibération collective que n’importe identité particulière, afin de parvenir sinon à une « Vérité » commune, du moins à des compromis ou des consensus. Dans le même temps, il faut rester conscient que les conditions idéales de la délibération – au sens où par exemple en parle un philosophe comme Habermas – se trouvent rarement réunies dans les faits, car certains individus ne sont pas en situation d’égalité pour débattre. Cette inégalité peut fausser les conditions d’une discussion réussie, c’est à dire susceptible de faire avancer ce que nous avons en commun. Elle appelle pour être dépassée la mise en œuvre de processus de « reconnaissance » mutuels..
Enfin cette logique délibérative suppose – et c’est la troisième piste – qu’on reconnaisse une consistance propre de la société civile comme composante de l’espace public, et espace intermédiaire entre privé et public. Cette reconnaissance de la société civile n’appartient pas, encore une fois, à la tradition révolutionnaire, mais il faut être plus nauncé s’agissant de la tradition républicaine, entendons celle qui commence avec la IIIè République. Celle-ci a en fait remonté la pente de l’histoire française depuis la Révolution en organisant les libertés collectives à l’intérieur de cette société, notamment par le vote des lois de 1884 sur le droit syndical, de 1901 sur le droit d’association et de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat et le statut des cultes, qu’on peut aujourd’hui considérer comme la trilogie des lois laïques ayant assuré les libertés collectives, à côté de la liberté individuelle. Mais pour citer encore Mona Ozouf, « la République n’a jamais tout à fait intériorisé les lois libérales qu’elle a elle-même fait voter. Elle n’a pu se défaire de son surmoi jacobin (24)».
Or, ce que dit en substance la Ligue aujourd’hui, me semble-til, est la chose suivante : la société civile est devenue le lieu où peuvent se loger sur un pied d’égalité à la fois les religions, les systèmes de convictions, les cultures, les syndicats, les associations, toutes ces composantes de la société civile étant en quelque sorte mises sur le même plan avec une double fonction : être les expressions de la particularité, et des contributeurs possibles à l’intérêt commun. Tous ces acteurs sont logés à la même enseigne, alors que sous la IIIè République, la société civile se définissait encore par son opposition à la société religieuse.
S’agit-il d’un nouveau modèle républicain ? ou d’un simple aménagement de l’ancien ? Il ne m’appartient pas de trancher. En tout cas, la mutation est considérable.
Jean-Paul MARTIN
(1) Cité par Hervé Terral, La Langue d’Oc devant l’Ecole (1789-1951), Puylaurens, Institut d’Etudes Occitanes, 2005, p. 51 et p. 147-149.
(2) P-J Hélias, Le Quêteur de mémoire, Plon, coll. « Terre humaine », notamment p. 343-344.
(3) R. Lafont, « Langues régionales et laïcité », Action Laïque, mai 1960 , p. 12-14.
(4) C’est le thème d’un article de Guy Gauthier« Région et culture », Pourquoi ?, septembre-octobre 1979.
(5) P. Tournemire, « Curieusement le régionalisme », Pourquoi ?, février 1979, p. 38-40.
(6) Langues dominantes, langues dominées, Edilig, Collection des Cahiers de l’Education permanente, janvier 1982.
(7) « Demain le bilinguisme », Pourquoi ?, n° 216, juin-juillet 1986.
(8) « Ce qui nous intéresse c’est la vitalité et la productivité des cultures », écrivait Guy Gauthier en introduction à l’article, déjà cité, « Région et culture » de 1979.
(9) Déclaration du CA de la Ligue du 31 janvier 1985.
(10) Sur son action, notamment à la Ligue, voir : Yvon Le Ven, Armand Keravel (1910-1999). L’apostolat laïque d’un homme au service de la langue et de la culture bretonne, TER, Brest, Université de Bretagne occidentale, 2004
(11) Voir l’article très critique d’un ancien professeur d’histoire, Louis Tregaro, « Les dialectes à l’école ? », Cahiers Laïques n° 157, 1977, p. 2-32.
(12) Guy Gauthier, « Citoyenneté et identité culturelle », Pourquoi ? avril 1988, p. 10-12.
(13) Sur ces aspects, voir notamment deux réflexions de spécialistes dans le journal Le Monde : Bernard Cerquiglini, « Le commerce des langues est l’avenir de la francophonie » (22 février 2000) ; Alain Bentolilla, « L’école et les langues régionales : maldonne » (15 mai 2001).
(14) J-M Ducomte, Les Idées en mouvement, décembre 2001, p. 3.
(15) Comme l’a bien vu Philippe Martel s’agissant du débat sur les langues : « Trente ans de politique linguistique en France », in : Pierre Klein (dir.), Les langues de France et la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Strasbourg, ICA (Initiative citoyenne alsacienne ), 2013, p. 24-41 (surtout p. 34 et 37-38).
(16) Selon la formule de Pierre Tournemire, Diasporiques, n° 5, p. 23.
(17) R. Lafont, Sur la France, NRF-Gallimard, 1968, p. 190.
(18) R. Lafont, intervention au colloque de Montpellier en 1982 (CR dactylographié, Archives Ligue)
(19) Ibid.
(20) Sur la France, NRF-Gallimard, 1968, p. 192.
(21) Mona Ozouf, « Jacobin, fortune et infortunes d’un mot », Le Débat, n° 13, juin 1981, repris dans L’Ecole de la France. Essais sur la Révolution, l’utopie et l’enseignement, NRF-Gallimard, 1984, p. 74-90.
(22) P. Weil, Le sens de la République,Grasset, 2015 ; M. Ozouf, Composition française, NRF-Gallimard, 2009.
(23) On a pu reprocher à la neutralité de type ferryste de dissimuler une morale bourgeoise ou colonialiste.
(24) M. Ozouf, Composition française, p. 228.



