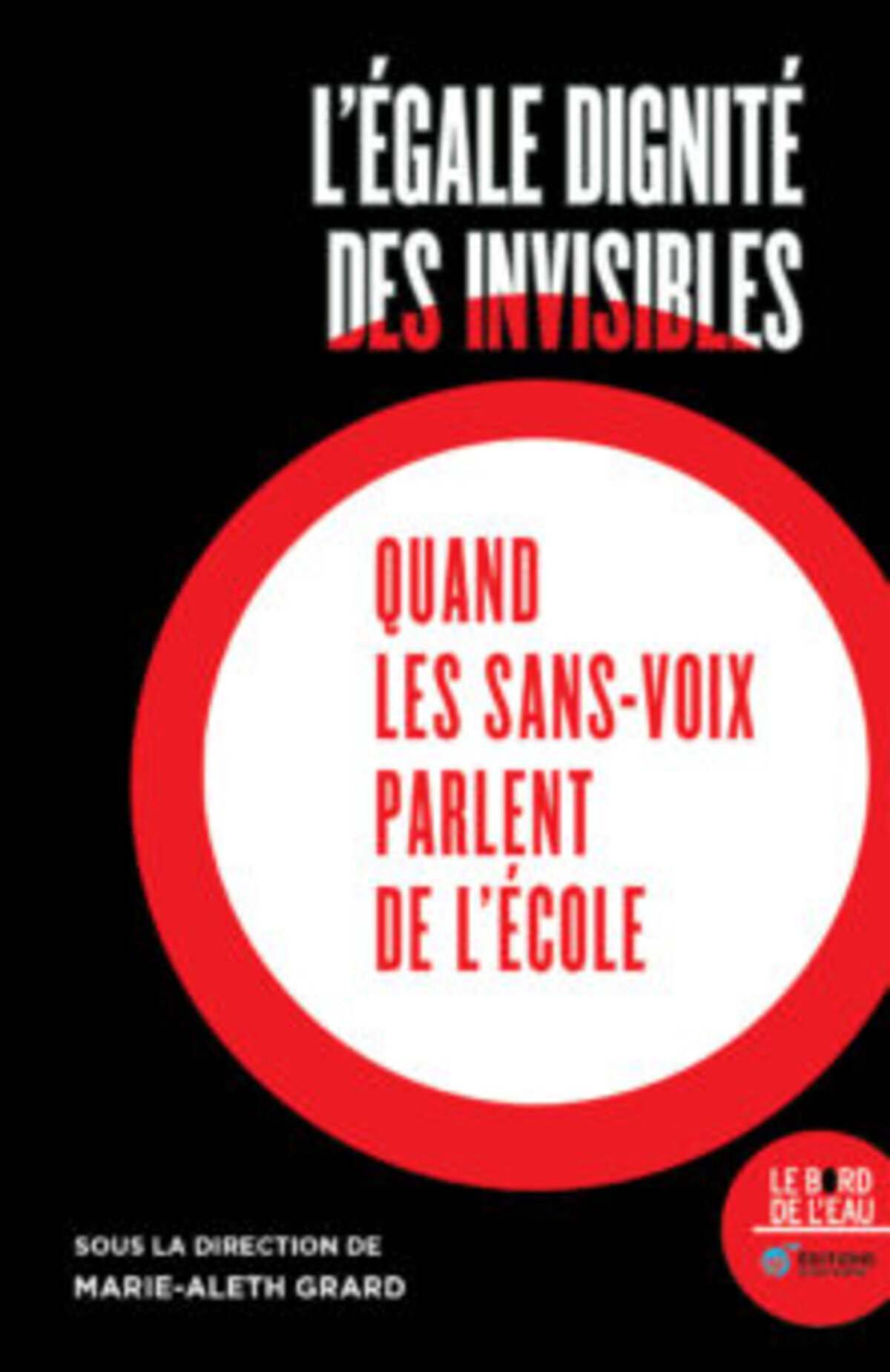
Donner la parole aux pauvres pour leur donner le pouvoir d’agir
Ce livre dirigé par Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart Monde et militante engagée pour la réussite de tous les élèves donne la parole à ceux qui ne l’ont pas, les pauvres, qui parlent sans détour au fil des pages de leur scolarité et de celle de leurs enfants.
Il faut lire ce livre car c’est un livre de combat contre les injustices, contre des scolarités trop liées dans notre pays à l’origine sociale. Et cette suite de témoignages sur ce que fait la pauvreté à l’école et sur ce que l’école fait de la pauvreté ne va pas faire plaisir à tout le monde tant notre système éducatif continue à être injuste avec les enfants des milieux populaires.
Le livre donne par exemple la parole à Franck qui nous dit sans fard que l’école ne l’aimait pas, lui dont les enfants « auraient voulu faire des études plus longues que celles qu’ils ont faites » car ils ont été scolarisés dans des classes « qui ne sont pas des classes pour apprendre mais des classes pour faire patienter ». Terrible formule.
Écoutons Céline qui nous dit que ses enfants scolarisés de classe spécialisée en classe spécialisée n’ont pas eu les mêmes chances que les autres et qui réclame des enseignants mieux formés pour que ça change. Vincent, dont « les parents n’ont pas été longtemps à l’école », nous raconte ses déboires avec l’orientation : « Quand j’étais en troisième et que j’ai entendu le conseiller d’orientation m’envoyer en STI, j’ai eu l’impression que j’allais travailler à la NASA. En fait, je me suis retrouvé sur une tourneuse fraiseuse ». Et Vincent a raison quand il nous dit qu’il « trouve que les devoirs sont les choses les plus injustes à l’école parce que les enfants ne sont pas à égalité devant l’aide que les parents peuvent leur apporter ».
Valérie, dont la fille Clarisse « n’a pas pu suivre les cours par internet faute d’ordinateur » pendant le confinement, demande si « on ne pourrait pas, quand on a comme nous de gros problèmes, travailler main dans la main avec l’école, sans que l’on se sente jugé et mal jugé » ?
Que répondre à Jacqueline qui nous raconte sa scolarité dans un collège « où ils connaissaient déjà les membres de ma famille et on était assez mal accueilli. Et là, malheureusement, j’ai pris pour les autres. On ne voit pas l’élève, on voit la famille de l’élève et on dit : “De toute façon, celui-là”… »

À ceux qui tenteraient aujourd’hui d’éviter la question sociale au sein de notre école, Paulette dit clairement : « Je pense que c’est la précarité qui fait que nous sommes différents. Nous ne sommes pas aux normes. Il faut que le papa et la maman travaille et que l’argent tombe. Il faut avoir l’intelligence, le savoir, s’exprimer correctement. Dans ce cas, c’est bon, vous avez votre place. Mais dès qu’il n’y a pas d’argent, que vous êtes au RSA, que vous habitez un quartier où les maisons sont délabrées, ça y est, vous avez une étiquette sur le dos et vous l’avez pour longtemps ».
Et ce n’est pas un hypothétique port d’uniforme dont certains nous rebattent régulièrement les oreilles qui changera quoi que ce soit à « l’étiquette sur le dos » évoquée par Jacqueline.
Le vécu de ces témoins rassemblés par Marie-Aleth Grard donne une image du système et de ses personnels qui n’est pas toujours à leur avantage, c’est le moins que l’on puisse en dire. Mais il y aussi de beaux hommages rendus à des enseignants attentifs et engagés et des portraits d’enseignants formidables avec qui « on accroche bien » qui « aident beaucoup », qui disent « qu’on y arrivera », qui « encouragent ».
Donnons à nouveau à Franck la parole pour conclure cette recension : « …on a la société qu’on mérite. À partir du moment où la majorité des parents d’élèves, qu’ils soient issus de la classe moyenne, de la classe défavorisée ou de la classe supérieure, est satisfaite du fonctionnement du système scolaire, la minorité qui n’en est pas satisfaite n’aura jamais gain de cause. »
Mais disons à Franck que Marie-Aleth Grard et quelques-autres à ses côtés, dont nous sommes, travaillent sans relâche à construire un rapport des forces dans notre pays pour que les pauvres et leurs enfants aient un jour gain de cause. Pas seulement d’ailleurs pour les pauvres eux-mêmes mais pour l’ensemble de la société. Comme le dit la chercheuse Dominique Reuter dans l’ouvrage « partir du plus en difficulté profite à toute la classe ».
En réalité, les inégalités ne nuisent pas à tout le monde. C’est ce qui explique en partie pourquoi il est si difficile en France de bâtir une école plus juste. La question des inégalités à l’école est d’abord une question politique avant d’être une question de dispositifs. Notre pays doit à cet égard répondre enfin à des questions fondamentales qui lui sont posées depuis trop longtemps.
Veut-on des savoirs pour émanciper et qui fassent sens pour tous les élèves ou des disciplines qui se disputent les meilleures places pour servir à la sélection sociale ? Une école de la culture pour tous ou une école qui fracture ? Promouvoir la coopération et le commun qui réunissent ou favoriser la compétition et la sélection précoce qui divisent ? Miser sur le collectif ou sur les parcours individuels ? Ouvrir ou enfermer, scolariser ensemble ou laisser faire un côte à côte qui pourrait devenir un face à face mortifère ?
Selon qu’on privilégie telle ou telle option, on renforce ou on fragilise le pacte républicain, et au final on ne construit pas la même société. Le livre de Marie-Aleth Grard est un cri d’alerte. Puisse-t-il être entendu.
Marie-Aleth Grard "L’égale dignité des invisibles, Quand les sans-voix parlent de l’école" Editions Le Bord de l’Eau. 180 pages 10 €.
Recension écrite par Jean-Paul Delahaye, Inspecteur général de l’éducation nationale honoraire, auteur de « Exception consolante » à la Libraire du Labyrinthe et de "L'école n'est pas faite pour les pauvres" aux Editions Le Bord de l'eau.



