Professeure de droit public à l’université de Cergy-Pontoise,
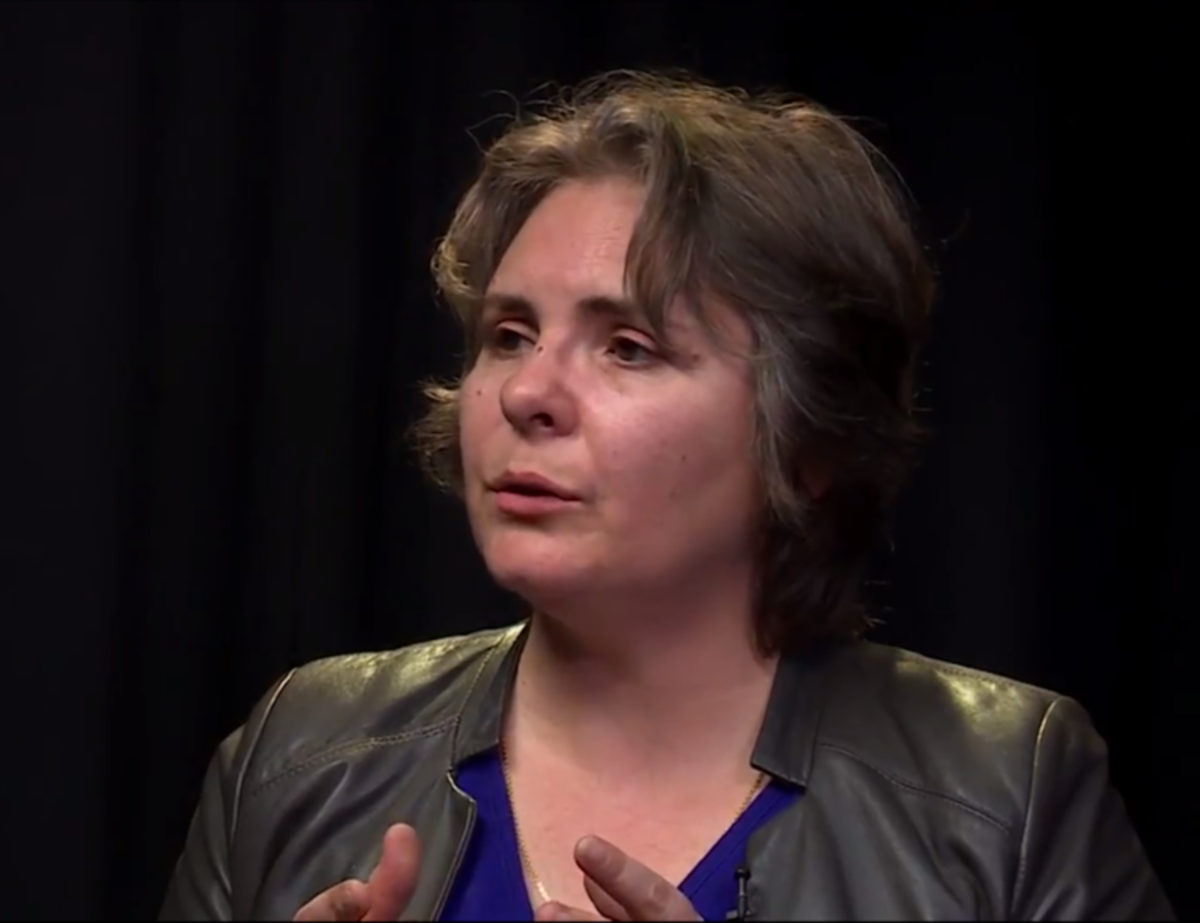
Agrandissement : Illustration 1
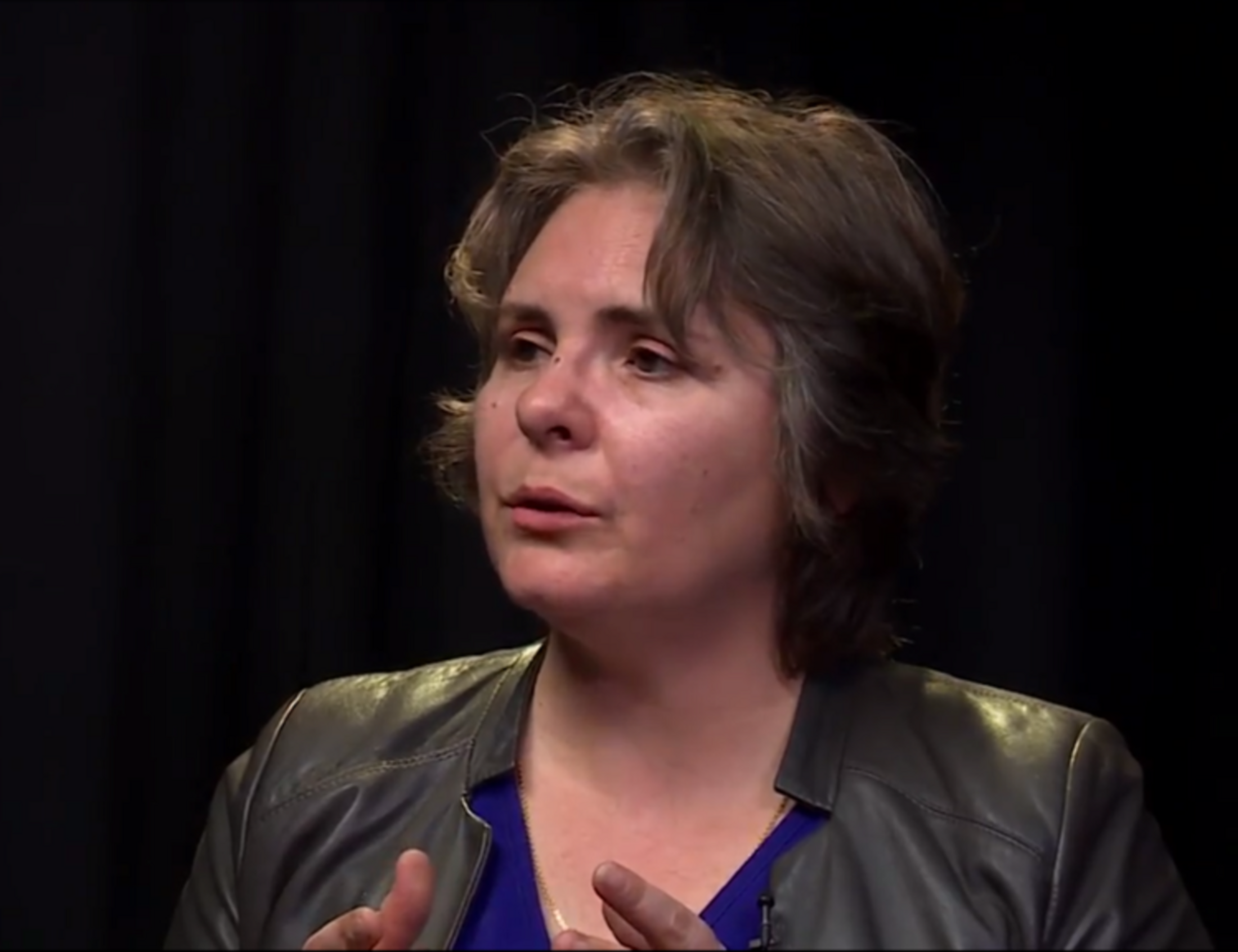
est spécialiste des questions liées aux politiques antidiscriminatoires, aux racismes et à la laïcité. Elle est notamment l’auteure de «Envoyer les racistes en prison? Le procès des insulteurs de Christiane Taubira » (LGDJ), «Territoires disputés de la laïcité » (PUF), « La laïcité » (La Découverte. Collection Repères).
Le processus de discrimination est un processus naturel par lequel chacune et chacun d’entre nous opère légitimement des jugements de valeur, de distinction, de préférence face à d’autres personnes ou groupe de personnes. Dans le langage courant, le mot « discrimination » renvoie de fait à la seule discrimination négative en fonction de choix interdits. La discrimination est juridiquement réprimée lorsqu’elle est opérée par des détenteurs de pouvoir qui refusent par exemple un emploi, un logement, un bien ou un service en fonction de critères prohibés. Une liste officielle recense ces critères, au nombre de vingt-cinq (Sexe, handicap, origine réelle ou supposée, orientation sexuelle…) La politique de discrimination positive s’est progressivement instituée pour faire face à ces situations.
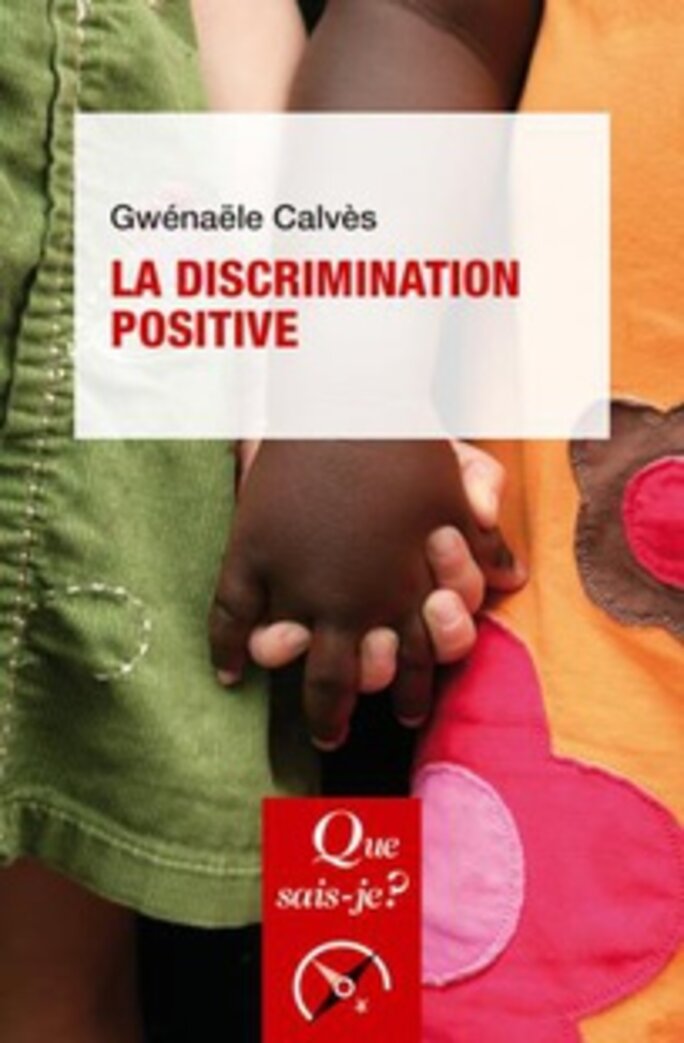
Dans la nouvelle édition mise à jour de son « Que sais-je ? » sur la discrimination positive, Gwénaële Calvès divise son propos en deux grandes parties : l’une sur la définition, l’autre sur l’expérience française. Comme dans ses ouvrages précédents, elle traite avec clarté et franchise son sujet en s’appuyant sur un grand nombre de références précises. De nombreuses confusions, voire hypocrisies, sont ainsi dissipées. Gwénaële Calvès s’appuie sur sa connaissance des politiques de grande envergure menées dans ce registre par les USA, l’Inde et l’Afrique du Sud. La discrimination positive n’est pas une politique de justice sociale à visée redistributrice. C’est une politique de rattrapage à caractère élitiste fondée sur des groupes humains. L’objectif est moins de réduire les inégalités que de tabler sur l’effet de levier ou d’entraînement que produiront sur le reste du groupe des « modèles d’identification positives » activement promus. C’est une stratégie dite « de la locomotive ».
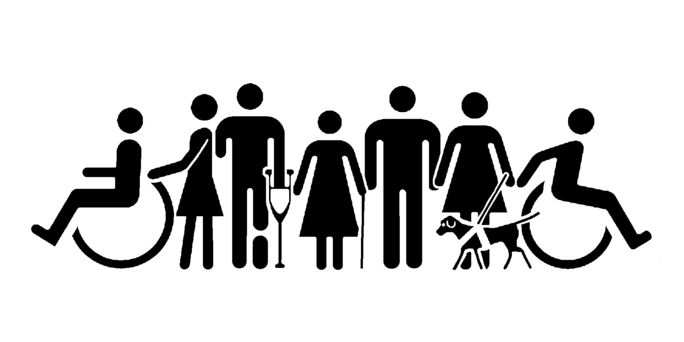
Agrandissement : Illustration 3
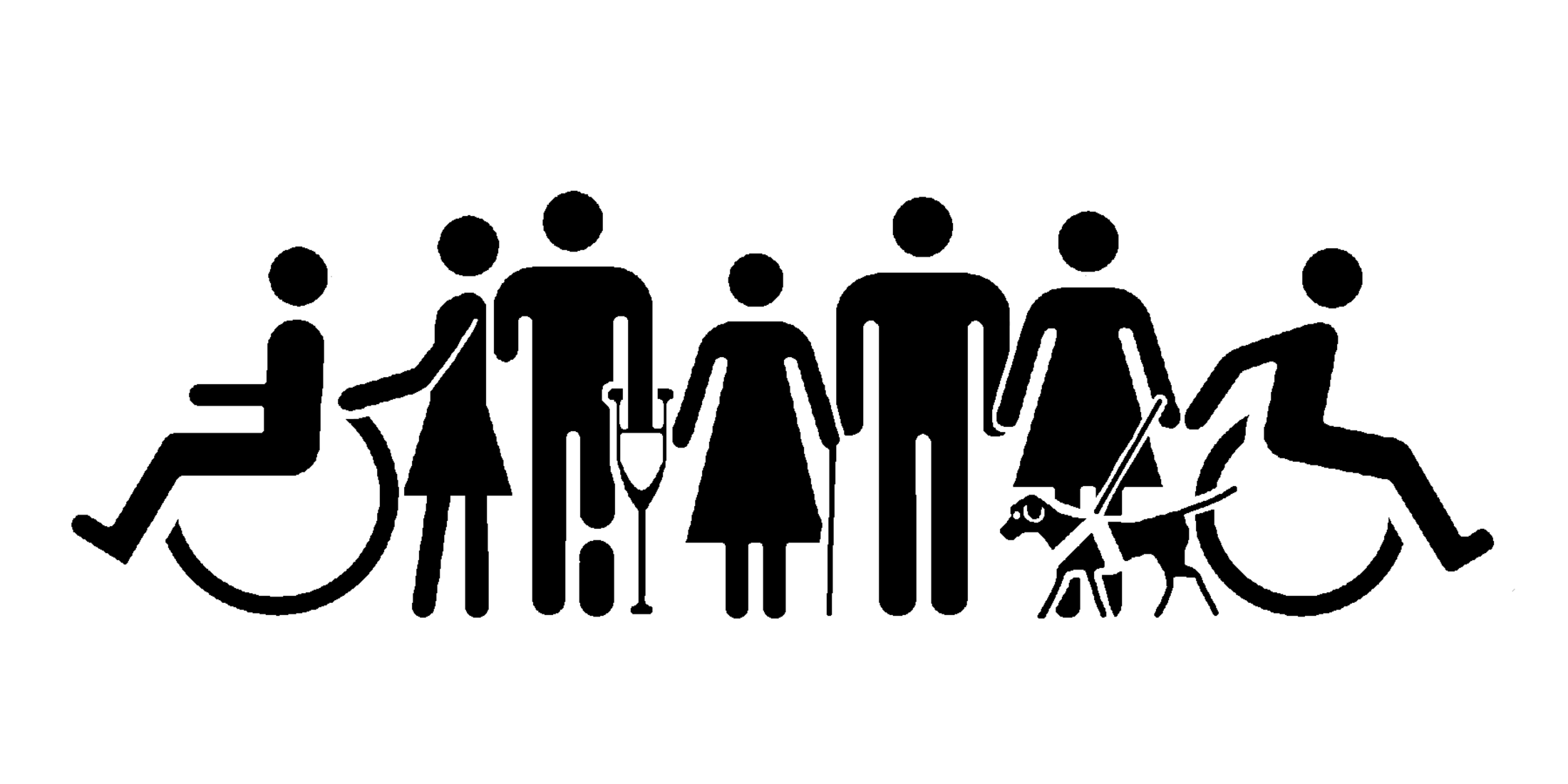
Gwénaële Calvès détaille les nombreux aspects que peut prendre cette mesure préférentielle : quotas, postes réservés, concours distincts, dispense de diplôme… et, plus général, l’ « outreach », effort spécifique en direction d’un groupe pour lui signifier qu’il bienvenu voire attendu. Elle n’escamote pas les critiques de cette politique : « déshabiller Pierre pour habiller Paul », promotion sans compétence, inefficacité par rapport aux moyens humains et financiers engagés… Gwénaële Calvès décrit l’institutionnalisation des politiques de discrimination positive. Elles ont été amenées à perdurer et à s’étendre à de nouveaux bénéficiaires et à de nouveaux domaines. Il s’agit d’une véritable mutation. De moyen destiné à s’effacer une fois le but atteint, la discrimination positive devient une dimension structurelle de l’organisation politique et sociale.

Gwénaële Calvès étudie l’aspect le plus délicat, objet de non-dits, l’ingénierie ethno-raciale mise au point pour lutter contre les diverses formes de racisme, du licenciement au contrôle d’identité sélectifs. Elle constate un « épais nuage d’hypocrisie ». A l’exception de l’Afrique du Sud, tout se passe comme si les sociétés où la discrimination positive s’est imposée n’osaient pas se l’avouer à elles-mêmes. C’est particulièrement vrai en France où notamment les politiques d’éducation prioritaire et de la ville ne se réfèrent jamais à la dimension ethnico-raciale, prohibée par la Constitution. Le critère territorial est devenu un substitut fonctionnel au critère de l’origine. L’usage allusif d’une certaine conception de la « diversité » est caractéristique. Une autre conception, plus inclusive, incluant toutes les populations dans une dynamique de reconnaissance réciproque existe. La profusion croissante de discours sur la race émanant de l’extrême-droite comme, de façon opposée, de certains milieux progressistes complexifie encore la situation.

Agrandissement : Illustration 5

Gwénaële Calvès consacre un chapitre à un autre sujet : la parité entre les sexes dans la sphère publique. Au niveau international elle est perçue comme un apport spécifiquement français. Depuis la revendication d’un quota de femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives en 1975 à aujourd’hui où la moitié de l’humanité n’est pas assimilée à un groupe ou à une catégorie, la situation a bien changé. Sur l’objectif de représentation proportionnelle, Gwénaële Calvès relève que « il n’y a que deux genres, alors que la diversité est… diverse ».
En conclusion, Gwénaële Calvès souligne qu’il faut « établir avec certitude que c’est l’égalité elle-même qui commande et justifie ce détour par l’inégalité ». Son livre est un apport précieux pour ce faire.



