Christine Delphy, Eric Fassin et une douzaine d'universitaires spécialistes des questions de genre s'alarment du recul de l'Education nationale en matière d’action pour l’égalité entre filles et garçons: les outils pédagogiques élaborés pour remplacer l’ABCD de l’égalité « laissent bien souvent place à diverses interprétations, y compris dans le sens d’un renforcement des stéréotypes de genre, voire de leur naturalisation ».
Fin juin 2014, le gouvernement annonçait le lancement d’un plan d’action pour l’égalité entre filles et garçons censé « étendre et amplifier » feu l’ABCD de l’égalité. S’agissait-il, comme on nous l’expliquait alors, de reculer sur le mot, mais non sur la chose, soit une manière d’éviter les malentendus ? Malgré un gros défaut congénital – l’absence d’action sur les programmes scolaires, dont la nécessité est pourtant soulignée dans un récent rapport du Haut conseil à l’égalité –, nous avons voulu croire ce plan potentiellement porteur d’avancées. Nous attendions avec impatience d’en connaître les modalités concrètes. Hélas, les éléments dévoilés le 25 novembre nous ont fait l’effet d’une douche froide.
Vos propos publiés ce jour-là dans Le Monde, Madame la ministre, semblent annoncer une réorientation radicale. Pourquoi déclarer en effet : « Les sexes ne sont pas interchangeables. Il y a une différence, qui ne justifie pas une hiérarchie » ? Alors que le concept de genre est utilisé pour « analyser les processus inégalitaires qui conduisent à créer différentes formes de différenciation entre les sexes » (1), selon vous il serait utilisé « pour démontrer tout ce qui, dans les inégalités, relève de la construction sociale ». Faut-il donc comprendre que les inégalités entre les sexes n’en relèvent pas exclusivement ? Machine arrière, toute !
L’enfermement des enfants dans des trajectoires genrées constitue en soi une inégalité de traitement, et amène notamment à (re)produire des inégalités sociales entre les sexes. S’agit-il désormais de veiller à bien maintenir la différenciation des filles et des garçons, tout en essayant seulement de limiter certaines inégalités ? On peine à croire qu’un projet ressemblant à s’y méprendre à « l’égalité dans la différence » prônée par le mouvement anti-gender se retrouve au cœur de ce plan pour l’égalité. Pourtant, force est de constater que c’est bien cette voie qui est de fait ouverte, voire privilégiée, par les outils mis en ligne sur le réseau Canopé (Réseau de création et d'accompagnement pédagogiques).
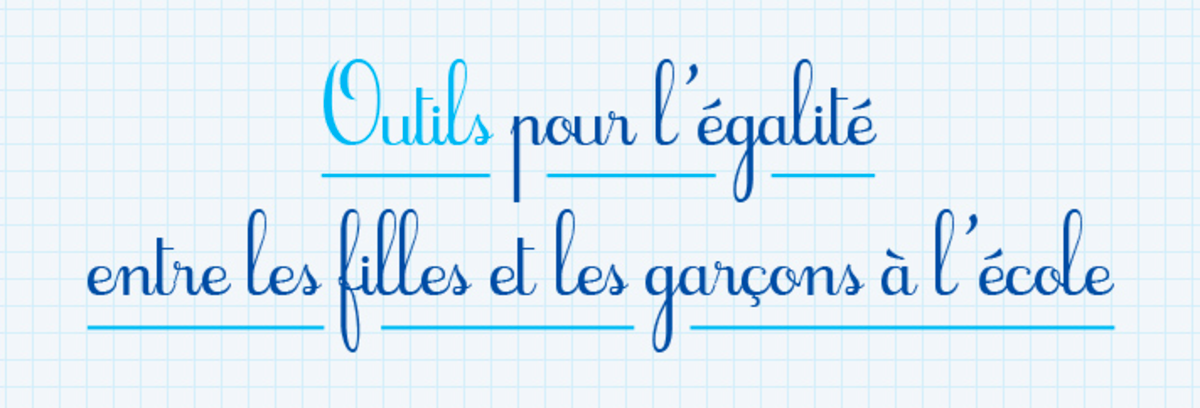
Agrandissement : Illustration 1
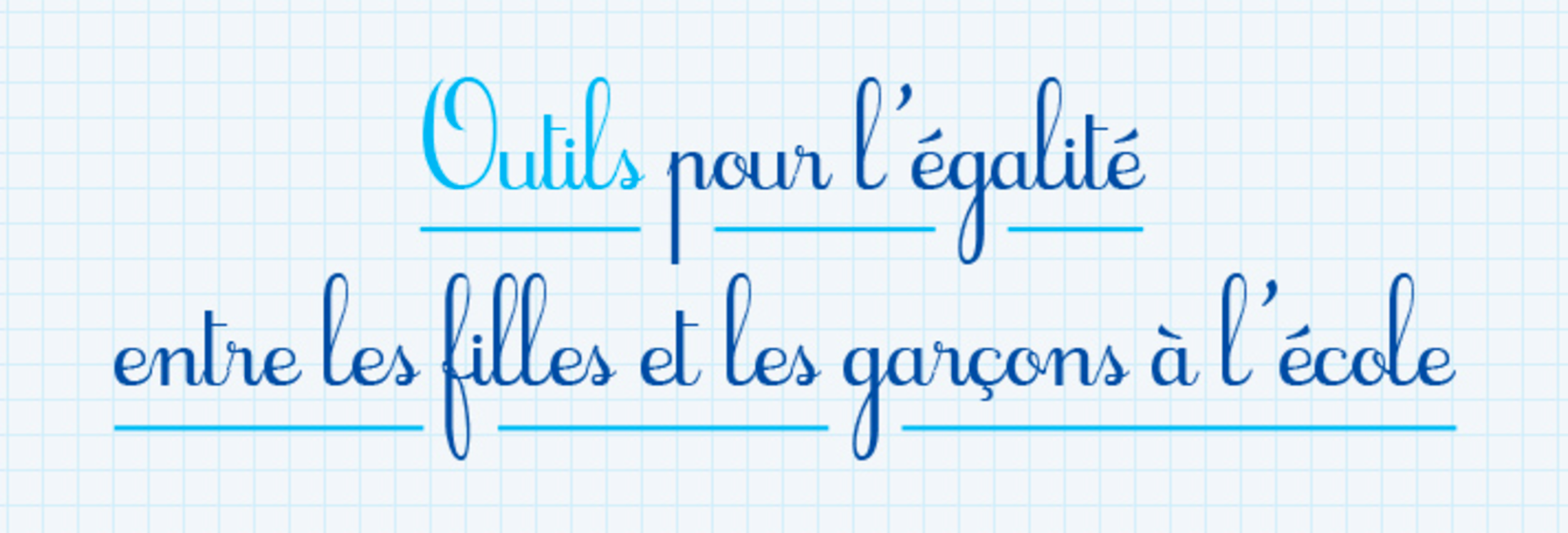
Pourquoi, par exemple, encourager à « se saisir des événements de la vie scolaire » pour faire prendre conscience aux enfants « des différences », et de quelles différences parle-t-on ? Pourquoi insister sur le développement de la connaissance de soi et des autres « en tant que fille ou garçon », et qu’est-ce que cela signifie ? Imaginerait-on faire de même avec les différences d’origine ou de couleur de peau ? Pourquoi dire aux élèves qu’ils se savent « reconnus » comme « garçon ou fille » car leur « différence » s’entend grâce aux pronoms « il » et « elle » ? Hier, on allait desserrer l’étau de la norme et s’ouvrir aux enfants « différents » ; aujourd’hui, on la réaffirme à l’école et on s’apprête à les renvoyer à l’inexistence. Et qu’est-ce que cette curieuse conception de l’intimité ne renvoyant pas à l’individu mais à son groupe de sexe : « la séparation garçons-filles répond au besoin d’intimité de chaque être humain » ? Qu’est-ce donc que la « fonction culturelle et sociale » de cet « interdit implicite de voir l’autre, suscitant un désir de transgression », qu’on souhaite ainsi faire intégrer aux élèves ? Va-t-on se donner pour objectif d’enseigner le désir hétérosexuel à l’école ?
Les outils élaborés par la Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) sont marqués par un tel recul idéologique qu’on en vient à penser que s’ils l’ont été sans recourir aux spécialistes de ces questions, c’était pour ne pas entendre ce qu’ils auraient pu dire. En outre, les pistes pédagogiques proposées sont d’une pauvreté remarquable dans certaines disciplines, et elles laissent bien souvent place à diverses interprétations, y compris dans le sens d’un renforcement des stéréotypes de genre, voire de leur naturalisation. Ce plan d’action pour l’égalité ne sera donc pas seulement inefficace : il est voué à être contre-productif, et c’est désespérant. Tant d’énergie et de moyens consacrés à un dispositif qui renforcera les inégalités en réaffirmant les normes de genre, ainsi que les discriminations vis-à-vis des enfants qui n’y sont pas conformes !
Vous nous direz peut-être, Madame la ministre, qu'il ne s'agit pas d'un revirement, moins encore d'un reniement, mais d’un malentendu et de maladresses dans la mise en œuvre de la politique que vous avez fixée. C'est ce que nous voulons croire ; aussi attendons-nous avec impatience votre réponse. Puisque vous venez de le faire avec les ennemis du genre, qui sont les champions de la différence des sexes, il importe maintenant de dissiper ce nouveau malentendu et de répondre à l'inquiétude de celles et ceux qui s'engagent pour l'égalité. Si vous partagez leur objectif, il est encore temps de faire en sorte que votre plan d’action concoure à l’atteindre.
(1) Qu’est-ce que le genre ?, 2014, Payot, p.9.
Marie Buscatto, Université Paris 1,
Yannick Chevalier, Université Lyon 2,
Isabelle Collet, Université de Genève,
Sigolène Couchot-Schiex, ESPE de Créteil/UPEC,
Christine Delphy, CNRS,
Christine Détrez, ENS de Lyon,
Eric Fassin, Université Paris 8,
Odile Fillod, Allodoxia,
Nicole Fouché, présidente de Réussir l’égalité femmes-hommes,
Catherine Marry, CNRS,
Céline Petrovic, Université de Strasbourg,
Muriel Salle, Université Lyon 1,
Priscille Touraille, CNRS/MNHN,
Mona Zegaï, Université Paris 8,
enseignant-e-s-chercheur-e-s en études de genre et des spécialistes des questions de genre dans l’éducation.
Rejoignez les signataires sur change.org



